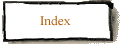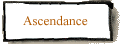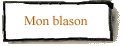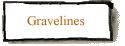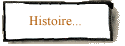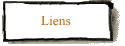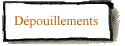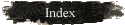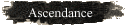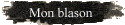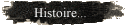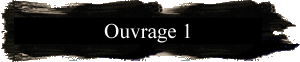
| La ville de Saint-Omer et le port de Gravelines |
|---|
|
JUSTIN DE PAS LA VILLE DE SAINT-OMER & LE PORT DE GRAVELINES
Mémoires de la Société des
Antiquaires de la Morinie TOME 35 1931
INTRODUCTION
L'expansion
commerciale de la ville de Saint-Omer au moyen-âge nécessitait pour elle des
débouchés tant maritimes que fluviaux et terrestres. Sa situation géographique
qui la mettait à portée de nombreux canaux et des hauts plateaux où
s'amorçaient des routes vers les Pays-Bas et vers la France, l'a mise également
à portée de la mer, plus particulièrement de Gravelines où s'écoule l'Aa dans
un cours de moins de sept lieues. C'était
de là que se trouvait l'avant-port naturel de Saint-Omer; aussi était-il de
l'intérêt de la communauté des marchands audomarois, d'une part, des marchands
forains d'autre part, qui venaient de pays étrangers fréquenter l'étape de
cette ville pour gagner les foires de l'intérieur, de trouver un transit libre
pour remonter de la mer par cette voie directe. Ce
privilège de transit, la ville de Saint-Omer l'obtint dans une large mesure :
il se manifesta d'abord par des exemptions de tonlieu, puis, dès le XVe siècle,
par un article de mainmise sur le havre même de Gravelines, à charge de
l'entretenir et d'entretenir également la rivière qui y accède. La ville
obtenait en même temps la concession de certains impôts dont le principal
frappait l'importation du sel, et elle acquérait des terrains et relais de mer
dont le revenu devait servir à l'entretien de la voie navigable, rivière et
havre. Malgré
cette double source de bénéfices, qui aurait pu devenir plus importante qu'elle
ne l'a été par suite probablement, d'une gestion insuffisante, la charge que le
Magistrat de Saint-Omer avait assumée était trop lourde; la guerre de Cent Ans
avait donné à l'activité du commerce audomarois un coup dont il ne devait pas
se relever : il ne cesse de péricliter; le havre de Gravelines, mal orienté,
s'ensablait facilement malgré les travaux de dragage, devenait de moins en
moins praticable et de moins en moins fréquenté; enfin, depuis le milieu du
XVIIe siècle, la ville se trouva, par le fait des guerres, dans l'impossibilité
de l'entretenir; aussi, en 1720, abandonnait-elle d'elle-même ses anciens
privilèges pour laisser au pouvoir central le soin de subvenir désormais, par
les travaux requis, aux besoins de la navigation. Tel est,
tracé en quelques lignes, l'histoire du port de Gravelines dans ses relations
avec la ville de Saint-Omer.
Le cours de l'Aa
avant le XIIe siècle. Dès la
fixation des terrains qui séparent Saint-Omer du détroit et de la Mer du Nord,
la région où se forma l'estuaire de l'Aa a été encore longuement recouverte
d'eau à la suite de la grande invasion marine qui a débuté au IVe siècle et
dont les effets ont été ressentis jusqu'au XIIe siècle. Le dessèchement a été
lent et progressif, et l'écoulement des eaux donna naissance à de nombreuses
petites branches dont les plus petites se sont elles-mêmes peu à peu comblées. Dans ces
conditions, l'effet des marées, s'est longuement fait sentir jusqu'à Saint-Omer.
L'hagiographie mérovingienne nous rapporte que Saint Bertin et ses compagnons
installés d'abord à Saint Momelin à la suite de l'appel de leur compatriote
Saint Omer, se trouvant bientôt trop à l'étroit dans leur installation,
partirent à la recherche d'un lieu plus propice pour y fonder un monastère. Ils
montèrent dans une barque et s'abandonnèrent au gré des flots qui les porta
jusque l'île de l'Aa où s'est élevée depuis l'abbaye de Saint Bertin. Or, en
fait, ils remontaient le courant de la rivière, mais ne voit-on pas que c'est
le flux de la marée qui les guidait ? Plus
tard, au IXe siècle, les habitants qui avaient commencé à peupler la bourgade
de Sithiu virent trois invasions des Normands. Une fois, ils avaient remonté le
cours de l'Yser; une autre fois ils venaient des côtes ouest de la Morinie;
mais, en dehors de quelques points de repère on est loin d'être fixé d'une
façon précise sur les lieux où ils débarquèrent. Peut-on
penser, comme l'ont avancé plusieurs de nos historiens locaux, qu'experts à
manier leurs bateaux à fonds plats et à s'aventurer sur des courants à faible
tirant d'eau, ils aient utilisé la rivière qui, avant de baigner le bas de la
hauteur de Sithiu, avait traversé Wavrans où on avait signalé leur présence et
la vallée que domine Helfaut, lieu d'un de leurs exploits ? À vrai dire, toutes
vraisemblables qu'elles puissent être, on ne peut ici se baser que sur des
suppositions. En tout
cas, cette utilisation n'aura été que partielle et accessoire; et aucun texte
ne nous permet de croire que les pirates aient remonté la rivière par son
embouchure. Dans
aucune de ses parties l'Aa n'était encore canalisée alors, et, de même,
l'estuaire n'était guère praticable aux bateaux de quelque importance; encore
au XIe siècle, selon que nous le rapporte la chronique de Watten, ses eaux
gagnaient la mer par de nombreuses petites embouchures. ( Cf Blanchard : LA FLANDRE, p 277. - Cf aussi ce que dit
le Docteur Dervaux dans le travail publié dans ce présent volume " Les origines de la Morinie " p 78.
) En aval
de Watten, elles se divisaient en plusieurs branches, et ce sont ces branches
qui, peu à peu canalisées, devinrent la Colme, et le canal de Bourbourg et
Dunkerque, ou vieille Colme ( anciennement le Monsterlecht ), d'une part; la
rivière de Ruminghem, le Mardick et la rivière d'Oye, d'autre part. Le cours
principal coulait après Holque, par le lit actuel du Denna, et gagnait
Bourbourg, pour se diriger de là à Gravelines par Saint Georges et dans la mer
par la crique d'Oye, c'est-à-dire à plus d'une lieue à l'ouest du chenal
actuel; et cet ancien lit de la rivière fera plus tard la limite du territoire
conquis par les Anglais dans la Guerre de Cent Ans et qu'ils conservèrent
jusqu'au milieu du XVIe siècle. Quant aux
autres embouchures par lesquelles s'écoulaient les eaux dans la mer, elles
s'ensablèrent progressivement à mesure que s'avançaient les travaux de
canalisation, et surtout à mesure que s'atténuaient la grande inondation,
commencée au IVe siècle avec un soulèvement du niveau de la mer, et qui fit
sentir ses effets jusqu'au XIIe siècle. II a.- Premiers
travaux de canalisation. - Conditions de navigabilité à cette époque. b.- L'ancien port
de Mardick. - Sa décadence. Les
premiers aménagements de la rivière d'Aa nous sont relatés avoir été l'ouvre de
Baudouin VII, Comte de Flandre, qui , en 1114, rendit la rivière navigable.
Mais cette canalisation était encore imparfaite. Vers
1160, Thierry d'Alsace, dans le but de faire passer la rivière le long de
l'agglomération qu'il avait fondée à l'endroit du hameau des Huttes, la
détourna de son cours primitif pour la rejeter au nord-est de Gravelines; mais,
ainsi qu'il a été dit, cette orientation était aussi peu favorable que possible
à l'action des marées qui, au contraire, bien orientée aurait pu dégager
l'entrée de la rivière, tandis qu'au contraire, elle ne cessa de l'ensabler.
Malgré les multiples inconvénients qui se manifestèrent, cet emplacement mal
choisi, ne fut plus modifié avant le XVIIIe siècle. Il faut
donc dater des travaux de Thierry d'Alsace l'origine du port de Gravelines, en
tant que port utilisé pour la navigation transitaire. Tandis
qu'avant le XIIe siècle, les seuls bateaux de quatre tonneaux au maxium
circulaient dans la rivière et les cours d'eau adjacents, nous voyons que, dans
les siècles suivants, les marchandises pouvaient remonter la mer bien avant
dans la rivière sans être transbordées ( Cf : Mémoires de la Sociéte de la
Morinie - Tome 16 p 336 ), ce qui, toutefois ne doit pas nous donner l'illusion
de bateaux de grandes capacités, non plus que d'un tonnage bien important de
marchandises amenées ainsi. Ce pouvaient être des barques de moyenne taille, à
quille, et qui remontant la rivière sans rencontrer de barrage, cherchaient à
profiter de l'afflux de la haute marée pour voguer plus aisément. Et, d'autre
part et plus souvent, la trop fréquente insuffisance du bon entretien de la
rivière, mettait obstacle au passage de lourds chargements, nécessitait, pour
ceux-ci, des transbordements, même en cours de route, et le transport sur les
petits bateaux dont l'emploi et l'exploitation étaient devenus le monopole des
bateliers " navireurs " de Saint-Omer. Or,
suivant les possibilités de navigation de la rivière, ces transbordements
s'effectuaient, soit à Gravelines, où les marchandises étaient protégées par la
juridiction de Saint-Omer, que le Comte de Flandre, Guy de Dampierre, avait
confirmée en 1282, en déclarant que les bourgeois de Saint-Omer y sont
justiciables de leur échevinage en matière commerciale et en matière
criminelle; soit à Nieurlet, ainsi
que nous l'indique la keure de 1127 ( § 16 ), c'est-à-dire en la banlieue de
Saint-Omer. En effet,
si on jette un coup d'oil sur la carte de la banlieue de Saint-Omer, on voit
que sa limite passe au-dessous de Saint-Momelin, lieu dit " Le Bac " et au-dessus de l'endroit
où se jette la rivière de Nieurlet. De plus, à cette limite se déterminaient,
sur chaque rive, les terrains communaux qui avaient été cédés à la ville. Or,
cene peut être qu'à cet endroit que pouvait être le lieu de débarquement dit
" Nieurlet ", cité dans la
charte de Guillaume Cliton. Ainsi
qu'on le verra à la fin du chapitre XX, es premiers travaux de canalisation
n'avaient été entrepris qu'en aval de Nieurlet, et même ce ne fut qu'au
commencement du XVII e siècle que la rivière fut rendue navigable aux grands
bateaux au sortir de la ville de Saint6omer. On pouvait donc prévoir, avant ces
travaux, que beaucoup d'entreeux ne pourraient pas la remonter en amont de
cette localité riveraine. Enfin, il
ne faut pas perdre de vue que, si l'on doit admettre que les bateaux remontant
de la mer étaient à quille, ils ne pouvaient guère avooir accès que sur la
dernière partie du cours de l'Aa, d'une part, et, peut-être sur les canaux de
la région calaisienne qui ne comportaient pas de barrages. Mais dès que les
bateliers devaient fréquenter le Colme ou les canaux qui la continuaient vers
les Pays-Bas, ils étaient arrêtés par des écluses et des " overdrachs
", et nous savons que, pour franchir ces barrages, ils se trouvaient
forcés, au XVIe siècle encore, d'employer des embarcations à fonds plats et
dont la contenance ne devait pas excéder six tonneaux. De même, au XVe siècle,
des bateaux de grand tonnage ne pouvaient pas encore franchir dans toute sa
longueur la rivière de Watten à Saint-Omer : un article du compte de
l'Argentier de Saint-Omer de 1420 - 1421 nous fait connaître qu'en 1421 il ne
fallait pas moins de six bateaux pour conduire à Watten une troupe composée de
50 personnes environ, dont 43 archers. Il ne
paraît pas hors de propos de rappeler ici ces diverses données qui, en fixant
l'idée qu'on peut se faire de la capacité des bateaux employés encore au XVe et
XVIe siècles, avant l'introduction des bélandres au XVIIe siècle ( il est déjà
question dans un acte de nos archives - VI, 13 - du 22 décembre1589, de bateaux
nommés « bilander » ou « bilandres » circulant sur la rivière d'Aa ), nous fixe
en même temps sur la largeur qui suffisait alors à la navigabilité de la
rivière. Avec les
travaux de Thierry d'Alsace, la navigation transitaire dans ce pays utilisait
aussi le port de Mardick, qui avait gardé, de la prospérité, qu'il avait dans
le haut moyen-âge, une importance qui le mettait au premier rang des ports de
cette partie du littoral : mais cette importance ne tardait pas à décliner. En même
temps qu'on achevait le port de Gravelines, on agrandissait, en 1168, celui de
Dunkerque : dès lors, la prospérité des ports voisins anéantit le commerce de
Mardick : son havre, qui n'était plus que l'ombre de celui qu'avaient creusé
les Romains fut abandonné. En 1209 une tempête lança tant de sable dans le
chenal qu'en une nuit il se trouva presque comblé. Ce fut la
ruine complète. D'ailleurs,
tandis que l'on pouvait compter sur les eaux du pays pour maintenir, par le jeu
des écluses, la profondeur du port de Gravelines et de la rivière d'Aa, les
eaux de la petite rivière de Mardick Gracht, qui débouchait dans le port de
Mardick, n'étaient pas assez puissantes pour le creuser. Faut-il ajouter qu'on
ne le releva pas avant le XVIII e siècle, à la suite du traité d'Utrecht ?
Encore accessible à quelques barques de pêcheurs, il avait été rendu, en 1530,
complètement impraticable par les méfaits d'une nouvelle tempête ( Cf. de
Bertrand : Histoire de Mardick, Dunkerque 1852 ). Mais
revenons au port de Gravelines. III
Premiers
privilèges de la ville de Saint-Omer à Gravelines. C'est
également au moment des travaux de Thierry d'Alsace que ce prince, dans une
charte concédée en 1165 aux habitants de Saint-Omer, confirme leur exemption de
tonlieu à Gravelines. Ce
privilège leur est déjà reconnu dans la charte de Guillaume Clinton de 1127, et
il a été maintes fois confirmé dans les concessions subséquentes. Il y est
formellement stipulé que les bourgeois de Saint-Omer sont francs de tonlieu à
Gravelines d'où qu'ils viennent et où qu'ils aillent, quelque marchandise
qu'ils amènent ou emmènent, sauf le cas où ils déchargeraient leurs
marchandises sur place et les y vendraient. ( Je suis obligé de rappeler ici
des faits et des actes déjà connus et analysés; mais je ne le fais que
brièvement, renvoyant, pour ces privilèges, à l'Histoire de Saint-Omer, de Giry
pp. 331 et 335; et à l'Histoire de Gravelines publiée dans le bulletin de
l'Union Faulconnier à Dunkerque pp. 216 et 367 ). Dans un
autre ordre d'idées, c'est-à-dire spécialement sur la question de la pêche des harengs, ces mêmes bourgeois
surent se faire reconnaître un privilège important. En 1279, le Comte de Flandre, Guy de Dampierre, avait
promulgué une ordonnance restrictive, interdisant à une même personne
d'acheter, saler ou exporter en un même jour, plus de 25 000 harengs au port de
Gravelines. Or les Échevins, au nom des marchands de Saint-Omer attaquèrent en
Parlement cette ordonnance comme ne devant pas être applicable à leurs
administrés. Le Parlement fit droit à leur requête, et, en 1282, le Comte de
Flandre, Guy, fit comprendre ce droit dans la confirmation des privilèges des
bourgeois de Saint-Omer en Flandre, leur assurant en même temps la libre
pratique du port de Gravelines avec les garanties requises pour l'usage de la
rivière qui y accède ( Archives de Saint-Omer, 292 1 et 23 ). Il y
était dit, en particulier, qu'ils pourront faire adapter aux besoins de leur
navigation les ponts qui leur seront nécessaires sur tout le parcours, sans que
l'on puisse leur créer quelque empêchement. Malgré ce
privilège, la ville se vit opposer, par le seigneur de Watten, Gilles de
Haverskerque, la prétention d'empêcher la libre circulation sur la partie de la
rivière comprise dans seigneurie. Les contestations sur ces difficultés furent
soumises à des arbitres qui affirmèrent le droit de libre transit de ceux de
Saint-Omer; en suite de quoi, Guy de Haverskerque déclara confirmer ses franchises
( Archives de Saint-Omer, Registre en parchemin, fº 72 vº ). Enfin, la
ville de Saint-Omer était aussi exempte, à Gravelines, du droit de lagan, et,
d'une façon générale, le tribunal échevinal de Saint-Omer avait le droit
d'évoquer devant lui ses bourgeois tant en matière commerciale que criminelle
pour faits commis à Gravelines. Ce dernier privilège, concédé par Philippe
d'Alsace le 21 février 1165, et, en somme, assez exorbitant en raison du
principe général de la territorialité de la justice, s'explique par l'importance
du commerce maritime exercé au XIIe siècle par les marchands de Saint-Omer
utilisant le transit par Gravelines. Dès lors, le port était considéré comme
l'avant-port de Saint-Omer, ce qu'il est devenu réellement depuis, et la ville
de Gravelines un prolongement du territoire soumis, en ce qui regarde les
bourgeois de Saint-Omer, à la juridiction audomaroise. De même
la rivière de Saint-Omer à la mer, comprenant par conséquent le havre de
Gravelines, était sous cette juridiction. On verra toutefois que celle-ci
n'englobait que la rivière seule à l'exclusion des rives. IV XIVe siècle - État de la
rivière - Prospérité de la ville de Gravelines - Sa décadence
après 1385. Le XIVe
siècle ne vit que de nouvelles confirmations de ces privilèges. Nous savons
par un
arrêt du Parlement
de Paris entérinant
un accord sur
un conflit de
juridiction, ( Archives du Nord B 1323, Bulletin de l'Union Faulconnier,
30 juin 1901, p. 215. Cette dernière publication confond ici Robert de Flandre
avec Robert de Bar, qui était le petit-fils de Robert de Flandre et de Jeanne
de Bretagne, et vivait, par conséquent, un demi-siècle après le travail exécuté
en 1335 ), qu'en 1335, Jeanne de Bretagne,
femme de Robert de Flandre, seigneur de Gravelines, avait fait réparer le «
havene » ( havre ) de cette ville. Leur
fille, Iolande de Flandre, Comtesse de Bar, dame de Cassel, Dunkerque,
Gravelines, etc..., conçut, vers 1360, le projet de faire creuser un nouveau
canal de Gravelines à l'Aa, avec une écluse d'échappement et un bassin ( Essai
historique sur Iolande de Flandre, par le Docteur P. J. E. De Smyttere. Lille.
Lefebvre - Ducrocq, 1877, pp 44 - 45 ). On ne
devait pas attendre moins de cette fastueuse princesse dont l'activité s'était
manifestée dans tous les vastes domaines qu'elle possédait. ( L'auteur de la
monographie ci-dessus donne de curieux détails sur les procédés violents
auxquels recourait cette princesse pour faire prévaloir son autorité, en
particulier dans sa lutte contre l'évêque, le clergé et le peuple de Verdun.
Elle fit forger de la fausse monnaie de France, fit incendier un village, et
alla jusqu'à faire disparaître deux chanoines députés vers elle par le Chapitre
de Verdun. Le bruit se répandit et la légende s'accrédita qu'elle les avait
fait jeter dans un puits qu'on appelle la Fosse-aux
Chanoines, au-dessous de son château de Clermont-en-Argonne, forfifié par
ses soins. ) Malheureusement ce nouveau projet ne fut pas exécuté, du moins,
les travaux entrepris ne furent pas amenés à achèvement. C'est ce
projet que reprendra, en 1638, Philippe IV, ainsi qu'on le verra plus loin,
pour une défense stratégique, qui fut bouleversée par les Français en 1644. Quoi
qu'il en soit, nous pouvons dire que les XIIIe et XIVe siècles virent
Gravelines prospère. « Gravelines prospéra beaucoup à cause de son port
jusqu'en 1383 », dit un mémoire
de 1845 ( Waguet.- Notice Historique
sur le Port de Gravelines.-
Saint-Omer, 1845, p. 6 ) : mais à cette
prospérité avait succédé une décadence rapide et complète. De cet
état nous avons conservé un tableau précis dans le rapport produit dans une
enquête de 1441 ( Archives de Saint-Omer, 210 -27. C'est une information
ouverte par ordre du Duc de Bourgogne au sujet des travaux qu'il est nécessaire
de faire à la rivière pour empêcher le passage des Anglais et parer aux
inondations ), par des témoins appelés à déposer dans [ cette ] information.
Nous y trouvons que, encore à la fin du XIVe siècle, le havre de Gravelines
était le meilleur de la Flandre après celui de Lécluse. ( Archives de
Saint-Omer 210,12. Il s'agit de l'Écluse, ancien port ensablé de Hollande,
ouest de l'Escaut. On trouvera plus loin, dans cette étude, mention d'un lieu
dit Lécluse ou l'Écluse à Gravelines,
lieu d'un ancien fort où une écluse barrait le débouché dans l'Aa du canal
venant du Calaisis. Le port de Lécluse sur l'Escaut était très fréquenté, et
des canaux le reliaient au réseau qui sillonne les Pays-Bas jusque Saint-Omer.
C'est à Lécluse que fut amené par mer, de Pise, en 1467, le mausolée en faïence
italienne exécuté pour l'abbé de St Bertin, Guillaume Fillastre, qui l'avait
commandé à Andréas Della Robbia ). Alors la marée faisait sentir son effet
jusqu'au pont de Watten : le flux et le
reflux créaient dans chaque sens un courant assez violent pour empêcher
l'accumulation des sables. Alors aussi, ajoute le témoin, le havre donnait
accès à tous les vins venant de La Rochelle, qui, présentement ( en 1441 ),
arrivent à Nieuport, Dunkerque, Étaples; tandis que, peu d'années après
la prise de Gravelines par les Anglais, ( en 1385 )
et avant la concession faite à la ville de Saint-Omer, le havre était tombé en
telle ruine, c'est-à-dire, s'était tellement ensablé que « quand aucun vaissel
y voloit entrer ou en yssir, depuis qu'il avoit prins son yssue ou entrée,
avant que il fust venu jusques oud. lieu de Gravelingues ou
que il en fust yssu,
il y convenoit pluseurs marées, et
se accargoient ( s'attardaient )
de XV ( sic; mais ce chiffre semble exagéré ) jours ou de plus, par quoy aultre
part y arrivoit marchandise ... ». Et cet
exemple tiré de la même déposition . . . . « trois vaisseaux chargiez de vin de
Poitou furent veus vagans devant led. havene en plaine mer, et samblent que ilz
eussent volentiers entré oud. havene, mais ilz ne savoient l'entrée et si ne y
avoient lesd. de Gravelingues mis enseignes comme faire doivent. Pour quoy un
Franchois estant aud. lieu offry ausd. de Gravelingues, se ilz lui voloient
faire aucune gracieuse courtoisie, que il yroit quérir lesd. trois vaisseaux et
les amenroit oud. havene, dont ilz de Gravelingues eussent eu proufit et le
marché, . . . , mais ilz le reffusèrent du tout : lesd. vaisseaux alèrent pour
entrer à Dunckerke, etc . . . ». Tel est
donc le tableau de ce qu'était le port vers 1380, et de ce qu'il était devenu
vers 1440. À ce moment, le commerce de Saint-Omer ne profitait plus du havre de
Gravelines, et, de plus, l'échevinage Audomarois se plaignait, en outre, que
ceux de Gravelines apportaient toutes sortes d'entraves à l'entrée des bateaux
qui voulaient se diriger sur Saint-Omer. V Première moitié
du 15e siècle. Creusement d'un nouveau lit de la rivière. Décadence du
trafic de harengs à Gravelines. Le XVe
siècle devait voir de grandes améliorations dans cet état de choses. En 1402,
le Comte de Flandre, Philippe le Hardi, fait creuser un nouveau lit de la
rivière, tel qu'il est demeuré depuis, entre Holque et le lieu dit les Hauts
Arbres, où, rejoignant la Hem devenue à cet endroit le Mardick, les eaux
gagnèrent dès lors directement Gravelines par le cours inférieur de cette
rivière. C'était déjà rendre plus directes les communications de l'intérieur du
pays avec l'embouchure de l'Aa : mais il fallait encore que celle-ci fût rendue
utilisable. Alors,
pour compléter cette amélioration, le Souverain résolut de confier la réfection
du havre aux principaux intéressés, c'est-à-dire, au Magistrat de Saint-Omer. On ne
pouvait songer, en effet, à associer à cette entreprise la communauté de Gravelines
elle-même. Gravelines, n'était, au moyen-âge, qu'une bourgade de pêcheurs,
flanquée, il est vrai, d'un château. Il s'y faisait, en particulier, un trafic
important de harengs; mais son importance commerciale et industrielle n'était
pas telle qu'on pût attirer un transit de navigation, et, pour ses pêcheurs,
l'estuaire de la rivière était toujours suffisant en tant qu'accessible à leurs
barques. ( C'est par sa situation militaire, ses fortifications, sa garnison,
et ses gouverneurs que Gravelines acquit plus tard quelque importance ). D'ailleurs,
ce trafic de harengs dont Gravelines fut longtemps le principal centre pour les
Pays-Bas, commença à baisser avec l'invention de la caque, c'est-à-dire dès le début du XVe siècle. Les autres ports,
au nord des Pays-Bas, commencèrent alors à en entreprendre un commerce intensif
( Cf. Pirenne : Histoire de Belgique,
II p. 439.) VI Premiers
pourparlers pour céder le port de Gravelines à la ville de Saint-Omer. Préparatifs de
grands travaux de réfection. Déjà l'on
voit qu'en 1426 la Duchesse douairière de Saint-Pol ( Mme de Bar, dame de
Gravelines ) ( Bonne de Bar, fille de Robert de Bar, seigneur de Cassel,
Bourbourg, Warneton, Dunkerque, Gravelines, fils d'Henri, Comte de Bar et
d'Iolande de Flandres, dame des mêmes lieux - voir précédemment . Bonne épouse,
le 2 juin 1400, Wallerand de Luxembourg, comte de Ligny et de Saint-Pol, qui
était veuf de Mahaut de Roux, et mourut lui-même en mai 1413. Douairière de
Saint-Pol, dame de Gravelines, Bonne mourut après 1426, laissant la seigneurie
de Gravelines à sa petite-nièce Jeanne. Celle-ci épousa, en 1435, Louis de
Luxembourg, qui devint, en 1455, connétable de France et avait, de son côté,
recueilli dans la succession de son père, Pierre de Luxembourg, les seigneuries
de Ligny et de Saint-Pol ) fait proposer au Magistrat de
Saint-Omer d'acheter sa ville ( c'est-à-dire sa seigneurie ) de Gravelines « et
il fut résolu d'en parler à M. le Duc de Bourgogne » ( Archives de Saint-Omer
d'après le Registre aux délibérations Échevinales
A. fº 175 année 1426.- Le registre ne nous est pas parvenu; nous n'en avons que
l'analyse dans la « Table des délibérations Échevinales » registre du XVIIIe
siècle p. 337. Nous n'avons donc de ces pourparlers préliminaires que la brève
mention donnée ici. ) Les
pourparlers traînèrent encore en longueur; en attendant, l'urgence des travaux
s'accentuait; aussi, le 5 juillet 1440, des lettres-patentes du Duc de
Bourgogne, Philippe le Bon, furent concédées aux abbayes de Saint-Bertin et de
Clairmarais, au Prévôt de Watten et aux Magistrats des Villes de Saint-Omer et
de Gravelines, sur la représentation de ces Corps, imposant une contribution
aux habitants de Flandre et Artois pour participer au « nettoie-ment » de la
rivière et du havre ( Archives de Saint-Omer, 212, 3 et 260, 3 ); mais il
arriva que les habitants des pays de Brédenarde, de Langle, de Ruminghem et de
Watten refusèrent de la payer sous prétexte que les nouveaux travaux ne
suffisaient pas à empêcher le passage des ennemis ( c'est-à-dire les Anglais ).
Par lettres des 15 décembre 1441 et 7 février 1442, Isabelle, fille du Roi de
Portugal, Duchesse de Bourbourg et Comtesse d'Artois, s'attacha à terminer
amiablement ce différend, et établit ( Ibid. 171, 9 et 210, 24. III, 13 et 14
), à la charge des villes et villages riverains, une répartition de la
cotisation qui devra être payée entre les mais des Mayeur et Échevins de
Saint-Omer et employée par eux à l'amélioration si attendue. Cette
cotisation devait être perçue en deux annuités et deux termes annuels. D'autres
lettres de la même Princesse et du même jour, 7 février 1441-42 ( Archives de
Saint-Omer, 3,13 ) établissent une série de redevances à percevoir sur les
diverses marchandises qui voyageront sur la rivière, afin de procurer à la
ville de Saint-Omer la somme de 12 000 F nécessaire pour faire face aux travaux
qu'elle s'était engagée d'exécuter. Ces perceptions sont accordées les unes
pour deux, d'autres pour quatre ans, sauf prorogation qui pourra être décidée,
au cas où les recettes n'aurant pas atteint, dans ces délais, le montant prévu. C'est
dans cette concession que nous trouvons pour la première fois création de
l'impôt sur la rasière de sel et de celui sur la chaux, qui seront repris
quelques années plus tard pour pourvoir d'une façon régulière à l'entretien de
la rivière. VII
1440.- Convention entre le seigneur de Gravelines, le duc de Bourgogne, et la ville de Saint-Omer. Celle-ci moyennant certaines cessions, s'engage à refaire le havre et à l'entretenir. Entreprise des Anglais de Calais contre les nouveaux travaux. D'autre
part, intervenait, le 16 août 1440, un contrat conscrant un accord du 14 avril
précédent, par lequel Jean de Luxembourg, Comte de Ligny, seigneur de
Gravelines et propriétaire des terrains le long desquels passait l'ancien
canal, cédait au Mayeur et Échevins de Saint-Omer, cent soixante mesures de
pâtures « pour parmi iceulx pasturages, fouyr et faire prendre cours le havre
dudit Gravelinghes qui, de présent est comme tout atterry et de petite valeur .
. . le Comte aud. lieu de Gravelinghes commenchans ung peu dessobz de son
castel ung fossez nouvel ouquel entreroit la rivière qui flue dud. lieu de
Saint-Omer audit havene de la largeur de LVI pies et de longueur IIII c XXXV
vergues ou environ de XIII piez la vergue en alant à droit cours si avant que
lesdites pastures sont verdes, à partir d'illec sur le sablon où le mer couvre
et descouvre chascun jour en rentrant ou cours de lad. rivière et havene assez
près de la mer du costé de la justice dud. lieu de Gravelinghes; et, de l'autre
costé, seroit délaissé le cours tors et long que le dicte rivière et havene a
de présent . . . ) La ville
de Saint-Omer s'engage à faire tous les travaux de préservation : « que sur
icellui sablon et les dicques dud. havene soit fait, assiz et entretenu ores et
en temps à venir tel ouvrage, estaques ou jettée de bois et de terre que
mestier sera pour le salvacion et communicacion d'icellui havene . . . ». La vente
est consentie moyennant une rente annuelle de 70 « salus d'or » ( Salut,
monnaie qui portait l'empreinte de la vierge recevant la salutation angélique )
que la ville racheta du reste, au bout d'un an, suivant la faculté qui lui en
était laissée, au prix de 1 500 saluts. ( Archives de Saint-Omer 211, 1 - Archives du Nord B 1 325 nº 15 749 - Archives de Gravelines AA 3. Voir
aussi aux Archives de Saint-Omer un mémoire judiciaire sans date - fin XVIIe -
213, 13. ). Cette
convention fut ratifiée par le duc de Bourgogne par lettres données en son
château d'Hesdin le 22 août 1440 : il est à noter que cette obligation de
préservation n'est pas applicable strictement au havre mais doit être étendue à
la rivière qui y accède. C'est une charge générale d'entretien qu'assume la
ville sur toute la rivière qui va de Saint-Omer à la mer. De plus,
une clause de retrait était prévue dans le contrat, « . . . s'il advenoit »,
était-il stipulé, « que led. havene se rompit ou advint en non valloir, nous (
Jean de Luxembourg - fils aîné de Jeanne de Bar et de Louis de Luxembourg )
pourrons reprendre en nos mains et à notre domaine, s'il nous plaist, les
pastures, en tenant quitte lesd. premiers ( Mayeur et Eschevins de Saint-Omer )
de lad. rente de 70 salus ou leur rendre, si rachetée estoit; lad. somme de 1
500 salus . . . ». ( Cette faculté de retrait était primitivement subordonnée à
l'inexécution des travaux dans le délai d'un an; ce délai, bientôt jugé trop
bref, fut prorogé par lettres subséquentes du duc de Bourgogne des 6 juin 1441
et 21 juin 1442 ( Archives de Saint-Omer, 211,1 ). Ce sont
ces terrains, considérablement accrus par la suite, ainsi qu'on le verra, que
l'on connaît sous le nom de hems, hemps ou hems de Saint-Pol, du nom des seigneurs dont ils formaient, du
moins à cette époque, le domaine : le de Luxembourg, comtes de Saint-Pol et de
Gravelines. ( La seigneurie de Gravelines était, en effet, en ce moment, dans
les mains des comtes de Saint-Pol par suite du mariage, conclu, le 16 juillet
1435, de Jeanne de Bar avec Louis de Luxembourg, qui devint connétable de
France et mourut sur l'échafaud en 1475, condamné pour crime de lèse-majesté.
Le père de Jeanne de Bar, Robert, avait été tué en 1415 à la bataille
d'Azincourt, laissant à sa fille ses droits éventuels à la seigneurie de
Gravelines. Celle-ci était alors détenue par Bonne de Bar, tante de Robert, qui
avait épousé, le 2 juin 1440, Wallerand de Luxembourg, comte de Ligny et de
Saint-Pol, dont elle fut la seconde femme. Décédée après 1426, veuve depuis
1415, elle laissa ses seigneuries à sa petite nièce Jeanne. Donc à deux
reprises différentes, dans le cours du même siècle, les dames de Bar, dames de
Gravelines, épousèrent des Luxembourg, comtes de Saint-Pol ). Les
travaux de réfection imposés par le Souverain à la Ville de Saint-Omer
paraissent avaoir été effectués assez rapidement, bien que des difficultés se
soient présentées dans le cours des travaux. Ce fut
d'abord, à deux reprises, la rupture du barrage qui retenait l'eau de l'ancien
lit avant son déversement dans le lit nouvellement creusé. ( Voir la mention de
ces ruptures, plus loin, au § j des articles et dépenses particulières engagées
par la Ville de Saint-Omer pour ces travaux ). Ce fut
ensuite une expédition montée par les habitants de Calais et Oye qui, redoutant
les conséquences d'une entreprise qu'ils estimaient devoir se résoudre en une
concurrence pour le port de Calais et le transit par la rivière de Calais à
Gravelines, avaient commencé à s'organiser au nombre de 3 000 hommes dans le
but de venir démolir les ouvrages. ( Cf. Archives de Saint-Omer, 210, 7 - C'est
une lettre de l'échevinage de Saint-Omer, adressée à un intermédiaire de
Calais, et le priant d'intervenir auprès du Gouverneur pour les protéger dans
leurs droits, et donner toutes assurances sur le caractère d'intérêt général
que présente l'achèvement du havre de Gravelines. ) L'intervention du
Gouverneur de Calais, sollicitée par le Grand Bailli de Saint-Omer, arriva
néanmoins à arrêter cette menace. Les
dépenses engagées portèrent à plus de 13 000 livres ( Archives de Saint-Omer
210, 12 et 26 ), et une enquête du 19 novembre 1441 ( ibid 210, 27 ) pouvait
constater que, depuis que le Magistrat de Saint-Omer avait fait approfondir le
dit havre de huit pieds, il avait atteint un tirant d'eau de 18 pieds « de
manière que à la basse eau ung navire ayant chargié le pesant de IIII XX tonneaux de vin y peut flotter ». Toutefois,
des différentes données que nous ont laissées les documents parvenus jusqu'à
nous, données parfois un peu confuses, il ne nous est pas permis d'affirmer si
le creusement du havre nouveau a bien été fait, comme le prévoyait la
convention, « en alant à droit cours si avant que les pastures sont verdes, etc
. . . », ou bien si l'on ne s'est pas contenté de creuser et d'aménager
l'ancien havre. En effet,
d'une part, si l'on consulte les plus anciennes cartes de notre région, et,
pour n'en citer qu'une, l'intéressante carte de l'Artois en 1570, dont M. C.
Hirschauer nous a donné une reproduction dans le second volume de sa thèse sur
les États d'Artois, on y voit très exactement le tracé de l'estuaire conforme à
la description donnée ci-dessus, c'est-à-dire aux travaux de Thierry d'Alsace.
La ville de Gravelines forme une presqu'île contournée par la rivière qui vient
en effet passer au hameau des Huttes et continue à suivre la direction
Nord-Est. D'autre
part, la convention de 1440 nous fait connaître que les 160 mesures cédées
tiennent « du lez vers Calais au cours que a de présent ladite rivière . . . (
On verra plus loin que les hemps qui s'étendirent à l'ouest jusqu'à la limite
du Calaisis firent l'objet de cessions ultérieures ) et, d'autre costé, tenant
à la dicque des fossez de la forteresse de ad. ville de Gravelinghes jusques à
l'opposite ou assez près d'une tour nommée la tour de Drinckamp... ». Il semble
que pour comprendre et concilier ces divers documents, il faille admettre que
c'est au niveau de la ville de Gravelines et en amont que l'ancien lit de la
rivière se trouvait plus à l'ouest et a été ramené plus près de la ville. En tout
cas, nous savons de façon certaine que cet ancien lit formait de nombreux
méandres qui ralentissaient le cours de l'eau en favorisant l'ensablement, et
que les travaux effectués depuis tendaient à les réduire. VIII Nouvelles
cessions à la ville de Saint-Omer qui s'engage à améliorer l'état de la rivière
depuisWatten. Accroissements postérieurs et successifs de hems cédés à la ville moyennant
annuités. On verra
plus loin que le résultat de ces travaux ne donnèrent pas le résultat attendu
et que, dès 1451, la Châtellenie de Bourbourg prétendait avoir à se plaindre de
l'insuffisance du remède apporté par le nouvel état de choses. Quoi
qu'il en soit, pour assurer la préservation et l'entretien des travaux, le Duc
de Bourgogne faisait abandon au Magistrat de Saint-Omer des « sablons et rejets
de mer » qui s'accumulaient entre les « hems de Saint-Pol » et la mer. Les
lettres patentes du 18 mars 1445, qui consacrent ces donations, stipulent,
comme condition, que les produits qui en résulteront seront consacrés à
l'entretien du havre, et, s'il reste de l'excédent, il sera réservé à
l'appronfondissement et à l'endiguement de la rivière en aval de la seigneurie
de Watten. Quelques
années plus tard, à la suite d'une contestation qui s'était élevée entre ceux
de Saint-Omer et les ayants cause et héritiers de Jean de Luxembourg, seigneur
de Gravelines, Louis de Luxembourg, Connétable de France, délaissa à la ville
par tarnsaction du 21 juillet 1466 ( Archives de Saint-Omer, 211, 11 ), datée
de son château de Vendeuil, 75 mesures de terres dites « hemps » et pâtures à
tenir de lui en censives, moyennant une rente de 72 livres, toujours avec la
condition que les recettes qui en proviendront sernt consacrées à l'entretien
du canal de Gravelines et la rivière d'Aa. Or ces
lettres furent encore complétées par d'autres du 26 mai 1467 ( Ibid. 211, 11 et
210, 23.- Voir aussi Compte de
l'Argentier de Saint-Omer. Registre de 1467-68. Fº 143 vº et fº 144 r º ),
de Simon de Luxembourg, Prévôt de la Collégiale de Saint-Omer, qui sanctionne
la délivrance de la cession ci-dessus consentie par son oncle ainsi que le
bornage qui vient d'en être fait. Par
contre, il est stipulé que la rente annuelle à payer par la ville sera
désormais de 80 livres, soit en augmentation de 8 livres sur les 72 livres
précédemment convenues. Enfin,
nous savons, par les comptes de l'Argentier postérieurs à 1485, ( cf. en
particulier le registre coté 1515-16 - fº 218 vº ) qu'un bornage, effectué en
1485, a révélé, sur les déclarations antérieures, un accroissement de 90
mesures « portant icelluy bournaige et augmentation de IIIIX mesures ». Ces 90
mesures, soit qu'elles soient provenues de relais de mer, soit de parties de
terre non comprises dans les précédentes déclarations, seront désormais
comprises dans l'arren-tement payé chaque année par la ville aux ayants cause
des Comtes de Saint-Pol. ( Parmi ces ayants cause, on rencontre, en 1520 et
années suivantes, la Gouvernante des Pays-Bas, par suite de la confiscation
dont la seigneurie a été l'objet pendant plusieurs années. ) Les
comptes consignent chaque année le paiement de l'annuité d'arrérages : nous y
voyons que c'est la dernière acquisition qui a porté les possessions de la
ville de Saint-Omer jusqu'aux limites du pays occupé par les Anglais. « ... Au
recepveur de très illustre dame et princesse Madame l'archiduchesse d'Austrice,
régente et gouvernante ayant la
jouissance ( au compte coté 1521-22, il est ajouté ici « par confiscation » )
de la ville de Gravelinghes appartenant à lad. dame de Vendosme par cette
ville, paiables au jour Saint-Martin à cause de pastures et ries, tant à l'ung
lez comme à l'aultre de la rivière lez lad. ville de Gravelinghes quy ont été
acquises et gaingnées tant au moyen des ouvrages factz par cestedite ville ausd.
rivière et havre, comme celles que premièrement furent acquises de ( alias « à
» ) feu monseigneur le comte de Ligny, et aussy celes prinses à rente au comte
de Saint-Pol, connestable de France, comme les 90 mesures prinses à rente par
le louaige et augmentation faicte en l'an IIIIc IIII xx et chincq et toutes
autres pastures, rietz, mollières, advenues et gaingnées depuis le commencement
des prinses, bournages, limitations et augmentations en allant depuis ladite
rivière jusques aix palles des Anglois et jsuques aux grosses estacques et
palles qui y furent mises et plantées en l'an XVc et XV pour adresch sur lesd.
pastures du costé des Angloys et, en retournant au travers de lad. rivière aux
aultres pastures du costé de Flandres aultre et par dessus VIII livres monnaie
d'Arthois déduictes pour les cinquante trois mesures XXXIIII verghes dont
procès est indécis en la Chambre du Conseil de Flandres d'entre deffinct
Monseigneur le Comte de Saint-Pol d'une part, et feu Guillaume de Heuchin,
d'aultre ...... LIII livres IIII sols ... » ( Compte coté 1527-28 fº 227 vº ). Cette
annuité se paie ponctuellement en ces termes et se retrouve dans chaque compte
( Toutefois la fin de la mention du compte de 1527 n'est pas très claire, et
cette obscurité provient dee ce qu'au cours des transcriptions successives
qu'en ont donné les comptes annuels elle a subi des déformations ). Voici,
d'après un compte antérieur, comment elle peut être rétablie : « ... chascun an
au terme Saint-Martin d'Iver LIII livres IIII soles monnaie courante en Arthois
dont se déduit VIII livres dicte monnaie pour le procès indécis etc ... pour
raison de partie desd. pastures estans du costé de Flandres; et, depuis, par
appointement fait, pour toutes icelles pastures jusques aux grosses estacques mises
oud. an XVc XV ... aincoires VIII livres monnaie d'Arthois paiables an aud.
jour Saint-Martin d'Iver, qu'y font ensemble .... LIII livres IIII sols. (
Compte coté 1 516-17 fº 201 vº ). Ainsi
d'une part, on retranche de l'annuité 8 livres pour une partie de pâtures, du
côté Flandre, sur la propriété desquelles il y a litige pendant; d'autre part,
on rétablit une somme identique pour arrentement des augmentations de terrain
provenant de relais de mer. Toutefois,
elle ne fut pas toujours égale. De 1485, date du premier bornage, elle porte à
45 livres 4 sols jusqu'en 1515, lorsque fut fait un nouveau bornage ( on trouve
plus loin, avec les autres extarits des comptes de l'Argentier, la mention
relative à ce bornage ), et constaté un nouvel accroissement des terrains
conquis sur la mer. Elle est portée à 53 livres 4 sols. Pourquoi, dans les
comptes postérieurs à 1539, l'article porte-t-il le double, soit 103 livres 8
sols, tandis qu'en réalité le ville ne continue à payer que 53 livres 4 sols ? Ainsi que
je l'ai dit précedemment, je ne puis voir là qu'une déformation du scribe
provenant d'une erreur matériel dans les transcriptions successives, erreur qui
s'est terminée sans contrôle, et ainsi jusqu'en 1639. À partir
de cette année, la mention demeure, mais le débours de la ville est remplacé
par le mot « mémoire ». Cette cessation des paiements s'explique en ce qu'elle
correspond à la période de l'invasion et de la conquête progressive du pays par
les troupes françaises, période de cessation de jouissance de la ville. Il en
est ainsi jusqu'en 1683, et jusqu'à cette date les mentions se poursuivent
immuables ( on verra toutefois plus loin, mention d'un acte par lequel le
Fermier général des Domaines de Flandres réclamait à la ville de Saint-Omer le
montant des arréages impayés de 29 années. D'après les comptes, le nombre des
années où les paiements n'eurent pas lieu fut plus considérable. Pour faire
correspondre les indications, il faudrait penser que l'action intentée par le
Fermier des Domaines ait remonté à un certain nombre d'années. Mais, d'autre
part, je suis plus porté à voir dans ce terme de 29 années le respect d'une
prescription trentenaire, au-delà de laquelle les années n'étaient plus
exigibles. La ville obtint, d'ailleurs, main-levée de cette dette en 1686 ), et
continuent avec une persistance touchante à consigner la défalcation pour la
partie de pâtures litigieuse entre les ayants cause des seigneurs de Saint-Pol
et ceux de Guillaume de Heuchin ( Il faut plutôt voir ici une survivance d'une
ancienne formule qui, depuis longtemps, ne correspondait plus à une réalité.
Notre ancien droit est ainsi plein de survivances analogues de formules qui ne
font que rappeler des institutions surannées et tombées en désuétude ). Ce
procès, pendant devant le Conseil de Flandre, fut-il jamais vidé ? Dès la
conquête française, l'ayant cause de ces parties est le Roi de France, et c'est
au Receveur des Domaines Royaux que la Ville recommencera, à partir de 1683, à
payer un droit de reconnaissance de 66 livres 10 sols. Mais alors le libellé de
l'article est tout simplifié, et il n'y est plus question de commentaires ou de
restriction. Mais
l'accroissement provenant de relais de mer et qui s'élevait déjà, en 1485, à un
nombre respectable de mesures, ne pouvait aller qu'en augmentant.
Malheureusement, des lacunes de nos archives nous empêchent d'avoir sur ce
point des précisions. Un
mémoire judiciaire sans date ( Archives de Saint-Omer 212, 13 ) dressé vers
1684 à l'occasion d'un procès intenté à la Ville et dont il sera parlé à la fin
de cette étude, dit que les terres délaissées en 1466 par Louis de Luxembourg,
Connétable de France, à la ville de Saint-Omer, « pour les tenir de luy en
censive » étaient de « 7 à 800 mesures . . . » Or s'il
s'agit du bornage de 1466 qui ne comprenait, on l'a vu, que 75 mesures, il y
aurait erreur flagrante; mais si le mémoire vise l'état actuel, ( en 1684 ) des
hems, on pourrait penser à un
accroissement qui paraît évidemment énorme au premier abord, mais qui se
comprend néanmoins, si l'on considère le travail qui, sur certaines de nos
côtes, prend parfois des proportions plus considérables encore. Mais alors, les
assertions du mémoire seraient également fausses, sinon sur la superficie des hems, du moins sur leur provenance, puisque
l'on a vu que la cession des relais de mer à la ville de Saint-Omer résulte,
non de la donation du du de Bourgogne en 1445 ? On voit
par là combien il est difficile de concilier ces textes de dates différentes. Pour
corser encore l'évaluation du Mémoire de 1684, nos Archives nous donnent
l'indication d'un arrêt de François de Mardrys, Intendant de la Flandre qui
prétendait que le Ville de Saint-Omer lui devait la somme de 6 960 florins,
montant de 29 années d'un redevance due pour 12 cents mesures de terres «
vulgairement appelées les Hemps de Gravelines ». Enfin,
sur une requête présentée le 8 juillet 1689 ( Archives de Saint-Omer, 213, 9.
Cette pièce ne se trouve plus à sa place indiquée, aussi nous ne pouvons en
connaître le contexte que par l'analyse qui en est donnée dans l'inventaire )
par le Magistrat de Saint-Omer à l'Intendant contre le fermier des domaines qui
prétendait percevoir 4 gros de chaque mesure des « hemps » qu'il évalue à 15 cents mesures, surséance est de nouveau accordée
à toute contrainte. Évidemment,
ces diverses évaluations, qui présentent des variantes, bien que faites à très
peu d'années de distance, ne peuvent
être considérées que comme approximatives : elles nous édifient néanmoins sur
l'importance des accroissements survenus aux superficies primitives. IX Concession à la
ville de Saint-Omer de la « cueillotte » du sel au havre de
Gravelines et d'une autre « cueillotte » sur chaux, grains et marchandises
descendant la rivière par Watten. Ces
ressources n'étaient pas les eules sur lesquelles la Ville pouvait compter pour
entretenir de son port. À la
suite de la première donation, le Duc de Bourgogne consentit à la ville de
Saint-Omer une autre source de revenus dans la concession du droit de percevoir
sur les navires amenant du sel par le havre une redevance dont le montant
variait, suivant la qualité, de 12 deniers à 1 sol, à la rasière. Ce droit que
nous trouvons avoir été concédé pour la première fois en 1451 ( Lettres du Duc
de Bourgogne datées de Terremonde : juillet 1451. Cf. Compte de l'Argentier.
Année 1457, fº 135.- On a vu que la concession d'Isabelle de Portugal du 7
février 1442 avait établi un impôt exceptionnel pour 2 ans, sur les denrées,
dont le sel, transportées sur la rivière ) pour dix ans, était désigné
dans nos Comptes sous
la rubrique « Cueillotte du sel
». ( Voir dans le dictionnaire de Godefroy au mot cueillette qui est employé dans le sens de collection de tailles, perception
d'impôt, les différentes formes qu'il reçut « coulloitte, cuelloite, coillote, cueulotte » etc ) : il était renouvelable et, de fait, a toujours
été renouvelé; mais le taux de perception a varié; en 1690, nous le trouvons
porté à 1 sol 3 deniers la rasière; en 1701, à 2 sols 6 deniers. Pendant
quelque temps, ces diverses sources de recettes se complétèrent encore d'une «
Cueillotte sur grains,cauch et autre marchandises passans par le dam de Watenes
et yssans par le havre de Gravelinghes » que l'Échevinage eut le droit de
percevoir sur les « denrées chargées et levées au dehors de cette ville » et
exportées par la rivière. Cet impôt que nous voyons avoir rapporté près de 500
livres en 1449 ( Exactement 493 £ 8 s de 40 gros de Flandre. Compte de l'Argentier 1448-49, fº 181 vº ) devint vite impopulaire, et
contribua à éloigner la navigation de cette voie. Dès 1455, nous voyons que sa
perception se heurta à des oppositions qui ne purent être vaincues et qui le
firent abandonner. Voici ce
que contient le compte de cette année : « De la
cueillotte de le cauch et autres denrées passans au dam ( Dam : digue, batardeau, barrage ) de Watenes et
yssans par le havenne de Gravelingues, laquelle cueillotte at esté accensé à
Aleame de Lomprey ung an commenché le 1er jour de juillet l'an mil IIII c LIIII
et fini le derrain jour de juing l'an mil IIII c et LV pour XII livres de gros
monnoie de Flandre, dont dud. Aleame ne at esté receu aucune chose pour ce que,
pour le contredit que ont à ce baillé et baillent le procureur de monsieur le
bastard de Bourgogne, Jehan Brusset, Pierre le Brasseur, Ansel et Simon de la
Mor et autres, lesquels font et ardent leur cauch des bois de mond. seigneur le
Duc et d'icelles monsieur le Bastart à cause de sa terre de Tournehem, à
laquelle cause ilz ne vueillent rien paier; led. Aleame ne a peu jouir ne
quelque chose cueillir ne lever de lad. cuillotte : Duquel contredit Messieurs
Maieur et Eschevins sont bien avertis, come dit Led. Alleame et pour ce icy . .
. . nénat.». Dès lors,
la Ville abandonna cette recette, d'abord en fait : ce ne fut qu'au bout de
quelques années, ainsi qu'on le verra plus loin, que le Duc de Bourgogne
consacra, en droit, le retrait de cet octroi. Voici, en
tout cas, ce qu'on lit dans les comptes dès après 1455 : « De la
cueillotte de la cauch. et autres denrées passans au dam de Watenes et yssans
par ledit havenne de Gravelingues, ne a esté aucune chose cueillie pour ce que
par mesdi sieurs maieur et eschevins pour certaines causes à ce se mouvans
ladicte cueillotte a esté délaissié. Et pour ce, pour l'an de ce compte ...
Néant. ». Et cette
même mention de carence se répète consciencieusement dans tous les comptes
subséquents pendant plus de 250 ans. X Autres impôts
pour l'entretien du havre et de la rivière. Droit d'étape de
la ville de Saint-Omer sur les marchandises arrivant par mer
à Gravelines. Une autre
recette plus positive provenait à la Ville d'une taxe intérieure, plus pesante
pour les bourgeois, d'une maille parisis pour chaque lot de cervoise consommé
dans la ville et les faubourgs, et dont le produit devait être appliqué aux
travaux du havre de Gravelines ainsi qu'au renforcement des fortifications. Elle
avait été concédée le 3 mai 1467 par Philippe le Bon ( Archives de Saint-Omer,
111, 20 ) et confirmée par Charles le Téméraire ( ibid, 111, 21 ) le 17 juillet
suivant; mais elle se révéla impopulaire à un point tel qu'elle compta pour une
bonne part dans les causes de mécontentement qui provoquèrent la sédition
bourgeoises de 1467 ( Cf. Mén. Soc. Ant. Mor. T 15, pp. 325 et suiv. ). On sait
que cette sédition fut suivie d'une régression sévère. En tout cas,
l'Échevinage dut refuser d'en envisager la suppression, pour la raison que,
déjà obérée par l'obligation de payer l'amende de 20 000 ridders à laquelle
était condamnée le Communauté, la Ville ne pouvait se passer de cette recette
pour faire face à l'entretien du havre. Il sollicita, au contraire, qu'elle
soit raffermie par de nouvelles lettres patentes, et Charles le Téméraire les
lui accorda le 6 juin 1468 ( Archives de Saint-Omer, 111, 22 ) en insérant dans
les considérants de la concession que, sans cette aide pécuniaire, « led.
supplians ne pourraient furnir et entretenir, nredicte ville ... ne autres
mises qu'il convient nécessairement faire pour ledit havene de Gravelingues,
qui est le principal bien et entretement d'icelle nre ville . . . ». Désormais,
au lieu de cette assise exceptionnelle de une maille par lot de cervoise, la
Ville pourra lever pendant 6 ans un denier pour chaque lot de cervoise et 4
deniers sur chaque lot de vin qui se vendra et consommera dans la ville et la
banlieue. L'impôt rentre dès lors dans la catégorie des assises dont
l'Échevinage demande régulièrement la prorogation. Il faut
enfin rappeler ici deux mesures qui, ayant fait l'objet de concessions
postérieures, tendaient à assurer à la Ville la récupération de profits qui
devaient lui provenir du fait de l'utilisation du havre et de la rivière, et
qui finissaient par lui échapper par suite de fraudes commises à son détriment. C'est
d'abord un acte de Charles le Téméraire du 17 septembre 1470 d'après lequel le
Magistrat aura le droit de récupérer certains droits d'assise sur le blé
traversant la Ville de Saint-Omer et que les marchands trouvent le moyen de
frauder, en faisant contourner par leurs bateaux l'enceinte des fortifications
par des rivières détournées. Or la lettre du duc spécifie que les bateaux qui
passeront ainsi en dehors de la Ville, par telles voies, paieront à leur entrée
en la grande rivière qui conduit au havre de Gravelines la même assise de 4
deniers sur chaque rasière de blé et sur les autres grains comme on paie en la
Ville de Saint-Omer « pour convertir à l'entretennement et reparacion desd.
rivière et havre ». ( Lettre de « nre Chastel le XVIIe jour de septembre 1470.
Archives de Saint-Omer, III, 23. Voir pièce justificative VII. ). C'est
ensuite et surtout la reconnaissance à la ville du droit d' « estaple » des
marchandises arrivant par mer au havre puis dans la rivière de Gravelines. Elle
est consentie pour la première fois par Philippe de Crèvecour, seigneur
d'Esquerdes, maréchal de France, capitaine général de Picardie et Artois, le 22
janvier 1487-88. ( Archives de Saint-Omer, XXXII, 10. Voir aux pièces
justificatives ) au cours de son éphémère occupation de notre ville. Confirmée,
le 27 octobre 1490 par l'Empereur Maximilien ( Archives de Saint-Omer, IV, 4 )
après le retour de la Ville au Duc de Bourgogne, elle fut l'objet de lettres
patentes de Charles Quint du 4 août 1520 ( Gand, 4 août 1520.- Lettres patentes
accordant aux bourgeois de Saint-Omer « que toutes manières de biens, denrées
et marchandises qui arriveront ou seront amenées au havene de Gravelinghes,
estre vendues et distribuées comme il appartiendra ... ». ( Archives de
Saint-Omer, Gros Registre en parchemin, fº 221 vº. ) ) renouvelées encore dans
les premières années du XVIIe siècle. Or ces différents actes spécifiaient que
cette mesure se justifiait par les abus qui s'étaient introduits du fait des
habitants des localités voisines de la rivière, qui avaient pris l'habitude de
décharger, en cours de route, au détriment de l'étape de Saint-Omer, les
marchandises qui leur étaient destinées. Mais la restriction qui leur est
imposée par la nouvelle ordonnance leur semble préjudiciable et provoque de
leur part des violentes protestations. Elles
aboutirent à une convention du 30 avril 1532 ( Cf. Archives de Saint-Omer,
XXXII, 14. ) d'après laquelle la Ville de Saint-Omer reconnaît aux habitants de
Bourbourg et Gravelines la faculté d'acheter au havre des marchandises, mais exclusivement
pour leurs usages personnels, et sans pouvoir les revendre. Un arrêt du
Grand Conseil de Malines du 26 novembre
1532, homologue cet accord et prévoit, à la charge des bénéficiaires, la
production des certificats qui doivent accompagner la marchandise ( Cf. Ibid.
Gros Registre parchemin, fº 221 vº et fº 100 rº. ). XI Mode de
perception des divers revenus que la Ville percevait à Gravelines. Dans les
premières années de l'exploitation du havre de Gravelines, nous voyons la Ville
faire percevoir par un agent la « cueillotte du sel » : les Comptes de
l'Argentier consignaient alors le détail, mois par mois, de la recette. Mais ce
mode de perception dut bien vite révéler ses inconvénients, car, désormais, la
recette de cet impôt fut affermée et mise annuellement en adjudication. Les
prix en furent très variables : mais l'augmentation qui s'est manifestée dans
le cours de deux siècles et demi provient de l'augmentation du droit perçu à la
rasière, conséquence de la diminution de la valeur de l'argent. Les hems étaient de même affermés : ici l'on
trouve de nombreux occupeurs : l'étendue était, en effet, assez considérable
pour subir un lotissement, et le rapport n'a pu d'ailleurs qu'augmenter soit
par la majoration appliquée aux tarifs par suite de cette diminution
progressive de la valeur de l'argent, soit par l'accroissement de la superficie
conquise sur la mer au cours des deux siècles que nous parcourons. Mais on
percevait, sur les pâturages qui s'y trouvaient, des recettes essentiellement
variables en louant à l'année, à la saison, ou même pour des périodes plus
courtes, le droit de pacage pour les troupeaux, le bétail ou même les chevaux. Comme
cela se pratiquait dans certains des immenses terrains communaux que la Ville
de Saint-Omer possédait autour de son enceinte, un garde était préposé au
contrôle de l'entrée des bêtes dans les pâturages. Enfin le
Magistrat devait nommer un représentant résidant à Gravelines, chargé de
veiller à l'entretien du havre ( Délibération Échevinale du 17 novembre 1441 -
d'après le Registre aux Délibarations Échevinales A. perdu. Cf. l'analyse de la
Table ). Voici
donc établi un régime de mesures conservatoires administratives et financières
dans lesquelles l'on pouvait espérer trouver des garanties sérieuses et
durables. La Ville
de Saint-Omer, la première intéressée à favoriser le transit par sa rivière,
aura désormais son port maritime. C'est dans ce sens que l'on peut lire dans un
grand nombre de textes que la Ville est propriétaire de la rivière et du havre
de Gravelines. XII Nature des droits
respectifs de la Ville de Saint-Omer et de la Ville de Gravelines au havre de
Gravelines. Le droit du « Capitaine » prétendu par ceux de Gravelines. En 1605,
le Magistrat produit à la Chambre des Comptes de Lille une attestation
établissant que le havre et la rivière de Gravelines appartiennent à la Ville
de Saint-Omer et sont entretenus à ses frais, et une sentence du Conseil de
Malines lui reconnaissant cette propriété. ( Archives de Saint-Omer. Gros Registre
en parchemin, fº 71 vº. Cf. Mén. Soc.
Ant. Mor. T 15, p 206, nº 351. V. aux pièces justificatives, pièce X. ) Quant à
la ville de Gravelines, elle conservait pour ses habitants le libre usage du
havre, ainsi que le droit de lever tonlieu sur les bateaux et marchandises que
n'exemptaient pas les privilèges de la Ville de Saint-Omer. Ces
droits étaient d'ailleurs antérieurs à la mainmise de la Ville de Saint-Omer
sur le havre et le régime nouveau n'y avait en rien dérogé. Toutefois
une difficulté s'était élevée entre les deux villes à la suite de la prétenton
de Jehan de Sainte Aldegonde, lieutenant du capitaine de Gravelines pour Jehan
de Luxembourg, d'exiger des bourgeois de Saint-Omer, sous le nom de droit du capitaine, un impôt sur
certaines marchandises passant
par le havre. Un arrêté du 21 août 1481 du Grand Conseil ( Archives de Saint-Omer, Grand Registre
parchemin, fº 220. Mém. Soc. Ant. Mor; T 15, p. 180, nº 268 et T 16, p. 118 )
le déboute de cette prétention, reconnaissant en cette matière, comme ailleurs,
les privilèges et franchises de ceux de Saint-Omer. Par
contre, on trouve à diverses reprises que la Châtellenie de Gravelines est
comprise dans les Châtellenies de West-Flandre qui participent à certains
travaux de préservation contre les inondations. Enfin, je
cite, plus loin, un texte qui nous montre la coopération de l'Échevinage de
Gravelines dans les frais d'éclairage de l'entrée du port, dont la
signalisation nocturne devait, en effet, être aussi utile aux petits bateaux de
pêche qu'aux autres navigateurs. XIII Malgré ces
travaux le havre de Gravelines n'acquiert pas de notable
activité commerciale. Peut-on penser que la mainmise sur le havre de
Gravelines ait suscité pour la Ville de Saint-Omer une augmentation notable
dans l'activité du commerce maritime ? À vrai
dire, les textes ne nous permettent pas d'émettre une telle conclusion. Au
moment où s'élaboraient les conventions qui ont favorisé l'exploitation de ces
privilèges, on se trouvait à la fin de la guerre de cent ans et l'on pouvait
espérer que la prospérité commerciale d'antan, c'est-à-dire des XIIe et XIIIe
siècles allait renaître. Malheureusement
on sait qu'il n'en fut pas ainsi; l'industrie de la draperie et, par suite, le
commerce des laines avec l'Angleterre ne se relevèrent pas : d'autre part, les
textes continuent à nous montrer que, même pour les vins, l'importation
continua à se faire, pour une forte proportion, par les ports de Lécluse et de
Calais. D'autre
part, nous ne trouvons pas que des bourgeois de Saint-Omer se soient livrés à
l'armement de navires pour la navigation maritime. Tous les textes, règlements
et témoignages divers d'associations organisées ne nous parlent que de la
navigation fluviale. J'avoue
n'avoir rencontré, dans cette période d'exploitation par la Ville du port de
Gravelines, qu'une seule mention d'un bourgeois de Saint-Omer, armateur, et
encore est-ce à une époque avancée, en 1622, au sujet de la proposition de
l'espagnol Diego Lhermite de venir prendre du service avec quatre navires de
l'escadre du roi Philippe IV ( Lettre de l'Infante Isabelle à Philippe IV du 10
novembre 1622, publiée dans la « Correspondance de la Cour d'Espagne sur les
affaires des Pays-Bas au XVIIe siècle » Tome 2 p. 111 - Publication de l'Académie
Royale de Belgique, in 4º, 1927 ). Or on trouve que ces navires appartenaient à
Nicolas Van Merstraeten, bourgeois de Saint-Omer, et à Corneille Janssen
Lisbon, bourgeois d'Anvers. Mais, encore ici, on voit bien qu'il n'y avait pas
à Saint-Omer même de centre d'opérations d'armement. Ce Nicolas Van Merstraten,
riche bourgeois avait vraisemblablement engagé une partie de ses capitaux dans
une entreprise qui fonctionnait, en réalité, dans un grand centre maritime,
Anvers. L'association, dans ce texte, de sa qualité de bourgeois de Saint-Omer
à celles de ses fonctions d'armateur, ne peut vraiment permettre de tirer
d'autre conclusion. XIV LA RIVIÈRE D'AA a.- Travaux
effectués par la Ville de Saint-Omer à la rivière d'Aa depuis le XIIIe s. b.- Personnages
de marque qui passèrent par cette rivière dans la première moitié du XVe s. c.- Contributions
des Châtellenies et Seigneuries riveraines aux travaux de la rivière. d.- Projet
non réalisé d'un nouveau havre ( 1519
- 1529 ). Il n'a
été parlé jusqu'ici que des travaux du « havre » de Gravelines; mais le havre
lui-même ne pouvait être utilisable et profitable à la Ville de Saint-Omer
qu'autant que la rivière qui y accédait était maintenue en bon état
d'entretien. Il y
avait intérêt pour elle à la maintenir en état navigable et à parer aux
inondations des terres riveraines : endiguements, coupage des herbes qui
envahissaient les rives; curage, dragage, etc ... Mais
déjà, avant d'en prendre définitivement la charge, elle avait été amenée à y
pourvoir pour permettre aux bateaux des marchands de l'utiliser et de remonter
jusque chez elle. L'urgence
de cette intervention est exposée dans une requête du Magistrat à la Comtesse
d'Artois dans laquelle il lui remontre à la date du 8 mai 1316, « les frais et
cous qu'il leur a tenu de nécessité fere pour fouyr, pour rejeter et retenir
net et délivré le cours de la rivière qui y vient de Gravelingues, pour ce que
plus seurement li bien et li marchandises y puissent venir et aler, qui autrement
sans grant travail et coust, et, aucunes fois pareille desdites marchandises
n'y pooient mie boinement venir, pour les empeschemens qui en ladite rivière
estoient creu et multiplié pas eslavaisses et par autres accidents . . . » (
Archives de Saint-Omer, XXXIII, 10. ). En conséquence il demandeà augmenter le
tarif du droit perçu sur les marchandises arrivant par eau, comme cela été fait
précédemment en vertu d'un octroi semblable concédé par le Comte d'Artois, père
de Mahaut, et qui remontait donc à la fin du XIIIe siècle. Le 16
juin 1353, Jean, roi de France, sur une requête analogue des Mayeur et Échevins
de Saint-Omer, consent à la Ville, pour une période de dix ans, la prolongation
du droit d'assise qui lui a été accordé précédemment et le porte même au
double, à condition que le produit en soit appliqué intégralement à la
réparation de la rivière qui a été très endommagée dans son cours du fait des
guerres ( Archives de Saint-Omer, I, 8. Original parchemin, daté de Vincennes,
« apud Nemus Vincenarum », Latin. ). Le 30 mai
1441, Jean sans Peur, duc de Bourgogne, confirme cette concession « tant comme
nous serons vivant » ( Archives de Saint-Omer, II, 20 ), ajoute-t-il. Enfin, le
31 décembre 1428, Philippe le Bon, duc de Bourgogne, dans un renouvellement de
concession d'octrois pour une période de 12 ans, comprend dans les travaux à
exécuter par la Ville « grandes et hastives réparacions tant pour la forteresse
qui est en grandt ruyne comme pour la rivière qui est le principal bien
d'icelle nre ville laquelle en grande partie n'est encore curée ne nettoyée ...
en quoy convendra faire très grant mise ... » ( Archives de Saint-Omer, III, 11
). En fait
donc, avant d'assumer l'entretien du havre de Gravelines, la Ville pourvoyait,
ou était censée pourvoir à celui de la rivière au moyen de concessions
temporaires d'impôts. Ces
travaux de curage et de nettoyage, elle avait d'ailleurs un intérêt particulier
à les faire, d'abord en vue de l'importance qu'il y avait pour elle à trouver
une voie d'eau utilisable pour ses débouchés, puis pour favoriser sa
corporation de Bateliers ou navireurs qui exploitait, à l'exclusion de tous
autres, le service des transports sur la rivière. Cette
corporation, puissante par son influence ainsi que par le nombre de ses
membres, ( Un document postérieur, il est vrai, puisqu'il est de 1602, nous
fait connaître qu'à cette époque le nombre des compagnons bateliers était
supérieur à cent vingt - Cf. Archives
de Saint-Omer, Correspondance du
Magistrat. Liasse des années 1602 - 1603, nº 197 ) avait bien qualité pour
réclamer de l'Administration municipale des mesures favorisant la navigation :
et c'est ainsi que la Ville ne pouvait se désintéresser de l'industrie de ses
bourgeois, et, par suite, de l'état de la rivière, même avant d'en avoir
expressément la charge. Mais,
désormais, l'engagement qu'elle prend est plus large et plus définitif. Dans les
documents, comptes et chartes, les travaux de la rivière se trouvent alors
mêlés à ceux du port auquel elle accédait, de sorte que l'historique des
travaux qui y ont trait ne peut guère être séparée de l'historique même du
havre. Il offrait ceci de particulier que, suivant les endroits où se
manifestait l'urgence d'une réparation, ceux de Saint-Omer demandaient ou
faisaient demander le concours financier des riverains intéressés. C'étaient,
d'une façon à peu près constante, l'Échevinage de Bourbourg, le prevôt de
Watten, et, en raison de leurs seigneuries et de leurs possessions, les Abbayes
de Saint-Bertin et de Clairmarais, et, enfin, les Chanoines de Saint-Pierre
d'Aire ( Ceux-ci avaient, en particulier, près de Watten, la seigneurie de l'Overdrach - Cf. Mém. Soc. Ant. Mor. X, 2e
partie, p. 76 ). C'était
là, comme on peut le penser, une source intarissable de contestations, de
procès et de transactions ou appointements. On en trouve des traces dans nos
Archives, particulièrement dans la première moitié du XVIe siècle ( V. en
particulier Archives de Saint-Omer, nº 208, 5; la Table des Délibérations Échevinales, fº 110 et fº 121; et dans la Table alphabétique ( en 3 volumes ) des
Archives de Saint-Omer à l'article Gravelines.
). Nous
savons toutefois que, dans les années qui précédèrent la prise en charge par la
Ville de ces travaux, la rivière était suffisamment navigable jusqu'à
Saint-Omer pour que l'on y fasse passer des personnages de marque. Le 25
décembre 1438, la duchesse de Bourgogne, qui était allée à Gravelines prendre
part à des négociations d'un traité avec l'Angleterre, vient en bateau à
Saint-Omer où elle arrive le soir et est reçue à la lueur des torches ( Bull.
Soc. Ant. Mor. T XII, livre 221. ). Le 14
novembre 1440, Charles d'Orléans, de retour d'Angleterre où il avait été retenu
prisonnier depuis la bataille d'Azincourt, arriva par la même voie de Gravelines
à Saint-Omer ( Chronique d'Alard Tanar. Cf. Bull.
Soc. Ant. Mor. T XV,
livre 282 ). Il y fut reçu à l'abbaye de Saint-Bertin, et c'est dans l'église
du monastère que fut célébré, le 17 du même mois, son mariage avec Marie de
Clèves. En 1441,
peu après la réfection du havre, l'on se préoccupa de travaux à faire à la
rivière du côté de Gravelines pour compléter le travail et, aussi, pour raisons
de défense militaire. En effet, nous connaissons par une enquête ( Archives de
Saint-Omer, 210, 27. V. aux pièces justificatives la trancription in extenso du texte. ) ouverte par ordre
du duc de Bourgogne sur la nécessité de travaux à effectuer, que ceux-ci
étaient prévus dans le but d'empêcher le
passage des Anglais en même temps que de parer aux inondations. On avait,
en effet, lieu de redouter l'invasion, en Flandre, de ces voisins de l'ouest
qui occupaient le Calaisis, et il est dit qu'il serait avant tout nécessaire de
« drechier la rivière qui maine dud. Saint-Omer à Gravelinghes depuis un lieu
que l'en appelle Mardicquehoucq où
sied molin jusques ou passage où passent les cars lez le chastel dud.
Gravelingues ... ». Il
s'agissait de supprimer un passage qui se trouvait guéable à basse mer.
L'expert consulté ajoute qu'après
avoir ainsi redressé
la rivière et facilité le cours rapide de l'eau il « ... convenroit
parfaire l'ouvrage de ducres ( un ducre
- en flamand duiker - est un aqueduc. ici il doit évidemment s'agir de fossés
latéraux pour l'écoulement des eaux qui pouvaient déborder ) et veldams ( veldam - en flamand veld (d,am) : digue
protectrice contre l'incursion des eaux d'inondation. ) ... afin que ladicte
eaue douche venant d'amont ne se peuist esparder et prendre long cours; et, ce
fait, il s'oserait bien faire fort que n'y porroit-on paser à pie[d] ne à
cheval sans noer ( se noyer ). » On a vu
précédemment qu'à ce moment les riverains avaient été « cotisés » sous la forme
d'un impôt spécial sur le transit, pour participer aux dépenses. Mais,
déjà en 1451, nous trouvons traces de plaintes de la Châtellenie de Bourbourg,
plaintes se basant sur ce que les travaux effectuées par la Ville de Saint-Omer
au havre de Gravelines n'avaient abouti qu'à endommager les digues que les
habitants de cette Châtellenie avaient fait élever contre l'envahissement des
eaux et à favoriser de nouvelles inondations. Agissant
alors d'une commune main, les Châtellenies de la West-Flandre intentèrent un
procès à la Ville de Saint-Omer devant le Grand Conseil pour obtenir réparation
des dégâts. Et c'est dans l'exposé de leurs doléances ( Lettres de Philippe le
Bon, duc de Bourgogne, du 17 juin 1451, mandant à ses Maîtres de Requête
d'évoquer devant le Grand Conseil les représentants des Châtellenies de
West-Flandre, d'une part, et ceux de la Ville de Saint-Omer, d'autre part, pour
vider un procès en réparation des dégâts d'inondation intenté par les premiers,
contre les seconds. Cf. aux Pièces justificatives, pièce IV. ) que nous
les voyons accuser cette ville d'avoir fait effectuer ses travaux de
1441 « par gens que nullement en telz ouvrages ne se cognoissoient ne
congnoissent » et « ... sans ce que ilz aient fait entretenir ne acomplir lesd.
ouvrages, testes, veldams ne ducres lors fais ou devisés, ne que lesd. passages
et avenues desd. Anglois par led. havre soeint rompus ... ». Enfin ils
constatent que c'est du côté de la terre d'Oye, occupée par les Anglais, que
les terres se sont trouvées exhaussées du fait des travaux effectués par la
Ville de Saint-Omer, et que, par suite, les eaux se sont répandues du côté est
de la rivière, ont raviné, abattu et emporté les digues et « ducres » et par
suite envahi les terres dont bon nombre étaient cultivées. Ils demandent en
conséquence que la Ville de Saint-Omer répare le dommage et ne néglige plus,
comme auparavant, d'entretenir les ouvrages de défense contre les inondations
du côté de la Châtellenie de Bourbourg. Il est
probable que l'enquête prescrite par le Duc et la poursuite des requérants
durent suivre leur cours, et que satisfaction fut donnée, au moins dans une
certaine mesure, à la partie lésée. Quelques
années plus tard, vers 1467, à la suite de la convention du 16 juin 1466 qui
laissa à la Ville une nouvelle superficie de Hems, il est encore question de travaux analogues. Ce sont encore
les riverains de Bourbourg, puis ceux du pays de Langle et de Ruminghem qui
requièrent un redressement de la rivière à ce même endroit où on a travaillé en
1441 : ils demandent cette fois que « soit trenchiet, entre Mardichoucke et Gravelinghes,
l'angle nommé le Zwaelwehouc et que plusieurs regets de mer à l'un et l'autre
lez de la rivière soient ostés, etc ... » ( Archives de Saint-Omer, 210, 8. -
La terminaison houc et houcke dont ces noms de lieux de forme
flamande signifie protubérance dans
la rivière causée par les alluvions. ) Il y aura
encore lieu de construire, comme précédemment, des travaux d'endiguement par le
moyen de testes ( pieux maintenant la
rive ), ducres, ( aqueducs ), veldams ( digues ) : le Magistrat de
Saint-Omer offre de payer le quart de la dépense à condition que le reste soit
supporté par les requérants ci-dessus et l'abbaye de Clairmarais. Ceux-ci
acceptent cette cotisaton à condition qu'ils soient déchargés de l'impôt dont
le duc de Bourgogne avait frappé les blés, grains et marchandises transportés
de la Châtellenie de Bourbourg par le dam
de Watten et le havre de Gravelines. Cela leur fut accordé d'autant plus
facilement que la perception de ce droit avait été, en fait, suspendue depuis
1456, par suite des oppositions qui s'étaient manifestées. Nous
voyons ensuite qu'en l'an 1500, à la réquisition des Abbés de Saint-Bertin et
de Clairmarais, du Prévôt de Watten, des Chanoines de Saint-Pierre d'Aire et,
enfin des Échevins de Bourbourg, la Ville consent
à employer 800
livres à réparer
le havre ( Délibération
échevinale du 6 mai 1500. Registre F. Fº 116 et suiv. ); mais les requérants
n'ayant pas consenti à payer leur quote-part, on fit cesser les travaux (
délibération échevinale du 19 novembre 1500. Registre F. fº 121 et suiv. ) En
septembre 1508, une forte tempête, accompagnant une haute marée, causa de
grands ravages qui endommagèrent les digues de la rivière et du havre, et
eurent leur répercussion sur toute la région côtière qui fut inondée. Le
Magistrat de Saint-Omer fut invité à participer, par ses représentants, à une
grande enquête qui se fit à Gravelines devant les délégués du Conseil de la
Chambre en Flandre « pour visiter les infractions et romptures des dicques et
dunes de la rivière et havene de Gravelinghes »; après quoi des Commissaires
échevinaux furent convoqués à Bruxelles par ordre de la régente, Marguerite
d'Autriche, pour comparaître devant le Lieutenant Général des pays de Flandre
et d'Artois, Monseigneur de Fiennes, assisté d'autres Conseillers de
l'Empereur, arrêter devant eux les travaux nécessaires de réparations et fixer
l'appointement à apporter par les localités riveraines ( Cf. Registre de l'Argentier de Saint-Omer,
cote 1508 - 09 - anc. st. - fº 163 et fº 165 ). Le Compte
de l'Argentier de l'année 1518 - 1519, nous fait voir encore ( fº 227 à fº 232
) qu'à la suite d'avaries nouvelles, une enquête analogue fut provoquée par
ordre de la Régente. Des experts appelés ne parlent-ils pas déjà d'un « nouveau
havene et fouich que veulent faire ceulx du West-pays de Flandre ? ». Ce projet
d'un havre nouveau demeura encore en suspens, et, pendant quelques années, à la
base des difficultés soulevées par les Châtellenies de la West-flandre.
Particulièrement, en 1529, elles le réclamèrent, prétendant que les
préservations contre l'inondation de leurs digues entre Gravelines et Mardick
ne pouvait être assurée qu'en reportant le havre bien à l'ouest, du côté même
des « limites des Anglais » ( Comptes 1529 - 30 fº 226. ) La Ville
de Saint-Omer accepta cette suggestion, ( Délibération échevinale : Analyse
d'après le registre G. perdu, fº 164 : « Difficulté avec ceux de Bourbourg par
rapport au havre de Gravelines. Il est résolu d'en faire un nouveau entre le
Vierboute et le Nordporte de cested. ville en allant de droit fil au travers
des pâtures et hemps de St-Pol appartenans à la Ville de Saint-Omer jusqu'au
lieu nommé Valkenhil, qui seroit de moindre entretenue et dépense, puisqu'il
n'aurait que 900 evrges et qu'il y viendrait toutes sortes de navires qui n'y
arrivent qu'à haute marée et à grand danger. Le Magistrat consentit à faire led. nouveau havre sans
préjudice à ses privilèges » - Table des
Délibérations du Magistrat, p. 340, d'après le Registre G. perdu, année 1529
fº 119, fº 124 et fº 128 - ) mais en subordonnant cette acceptation au
consentement, par ceux qui la sollicitaient, d'une contribution à la dépense.
En effet, par ses députés envoyés à ces fins, elle prétendit « induire iceulx
des pays de Flandres, Furnes, Dixmude, Bourbourg et Berghes Saint-Winocq à
contribuer aux despens pour le nouveau havene, qui lors estoit mis en terme de
faire à Gravelinghes sur les limites et marches des Engletz, etc ... » ( Comte
1529 - 30 ). Mais ces
Châtellenies refusèrent toute subvention entendant par lesdis impétrans que
c'estoit à faire ou y contribuer par cesd. Ville de Saint-Omer, sur laquelle
contribution ne fut persisté ... » ( Archives de Saint-Omer, 208, 5. V. aussi
Grand Registre en parchemin fº 201. ) Finalement,
le règlement de cette difficulté se fit en un accord intervenu en 1530 par
lequel les Magistrats de Saint-Omer et de Bourbourg établissaient leurs
interventions réciproques dans l'entretien du canal, de la dune et digue entre
Gravelines et Mardick et, généralement, dans les travaux destinés à préserver
des inondations le pays à l'est de la rivière. ( Compte de l'Argentier, 1529 1530, fº 228 vº ). Une
délégation de l'Échevinage Audomarois dut se rencontrer avec des députés de
Bourbourg pour « estre présens à mettre et planter ung bourne d'un gros
tronchon de quesne sur et au bout du Zoodicq, faisant fin de la monstre et
longheur de l'entretement que mesd. Srs ( de Saint-Omer ) sont tenus et submis
faire aud. havene ... » Et, bien
entendu, il ne fut plus question d'un havre nouveau. Enfin, en
1594, à la suite d'avaries survenues à la digue de Gravelines, nous voyons le
Gouverneur et le Magistrat de cette ville prétendre contraindre ceux de
Saint-Omer à contribuer aux dépenses de réparations. Mais l'Échevinage
Audomarois, arguant de la charge qu'il avait assumée de l'entretien de la
rivière et du havre, répondit que, par contre, ses privilèges devaient
l'exempter de cette contribution, et que c'était « aux quatre Membres de
Flandre », c'est-à-dire aux Châtellenies de la Flandre Maritime que la ville de
Gravelines devait s'adresser. ( Cf. Correspondance
du Magistrat de Saint-Omer, année 1594, pièces cotées 7 319 - 7 458 - 7
488. ) L'affaire
fut portée devant le Conseil Privé et résolue dans ce sens, mais toutefois sous
forme de transaction par laquelle la ville de Saint-Omer apportait tout de même
une modeste contribution, toujours sans préjudice du principe de
non-intervention qui devait demeurer intact. XV Droit de
juridiction de la Ville sur la rivière. Comme
conséquence de la propriété qui lui fut reconnue sur le havre et la rivière, la
Ville avait sur celle-ci un droit de juridiction, mais il avait ceci de
particulier qu'il ne s'appliquait qu'à la rivière, et non à ses rives : c'est
ainsi qu'on verra plus loin, ( p. 32 ) dans la suite des extraits de comptes de
l'argentier relatifs à la rivière, au paragraphe i, la ville faire un exploit
de police sur les rives de la rivière contre des malfaiteurs qui rançonnaient
les malheureux bateliers : or ils ne peuvent aller au-delà de la Morquines
c'est-à-dire des limites de la banlieue de Saint-Omer. Au-delà, ce sont les
seigneurs riverains qui ont la juridiction. S'agit-il au contraire d'exploiter
la rivière elle-même, ( c'est dans l'espèce, un « escauwage », reconnaissance
judiciaire du corps d'un noyé ), la ville est compétente. Un arrêt du Grand
Conseil de Flandre du 22 août 1431, à la suite d'une difficulté avec les
religieux de Watten, reconnaît formellement que l'Échevinage de Saint-Omer a «
droit d'eschauwage et du gouvernement de la dicte rivière jusques en la mer ...
» ( Archives de Saint-Omer. Registre parchemin, fº 131 vº. Mém. Soc. Ant. Mor.
XV p. 165 ). XVI Droit de « cueillote » et de
tonlieu perçus au lieu dit l'Écluse sur les
marchandises arrivant de Calais au havre de Gravelines par Marck, Oye et l'Écluse
qui a donné son nom au fort et au lieu sis à cet endroit.- Voyages royaux en
1480 et 1520 de Calais à Saint-Omer par cette voie. En raison
de son droit de propriété sur les hems
et le havre de Gravelines, la Ville de Saint-Omer obtint de se faire
reconnaître un droit analogue sur l'écluse qui faisait déboucher dans le havre
la rivière d'Oye, laquelle, d'autre part, donnait accès aux bateaux venant de
Calais par le canal de Marck. Ces rivières avaient été ouvertes à la navigation
par les Anglais pendant leur occupation du Calaisis pour relier, sur leur
treritoire, Calais à Gravelines. C'est de
là que beaucoup de bateaux arrivèrent de Calais pour remonter ensuite le cours
de l'Aa, et le lieu appelé dans les textes l'Écluse ou ( Lécluse )
était celui de l'ancien fort de l'Écluse, où se trouvait l'écluse qui séparait
de l'Aa le cours d'eau venant de Calais, Marck et Oye et débouchant à
Gravelines. Quand, en
août 1480, Marguerite, douairière de Bourgogne alla en embassade chez son
frère, le roi d'Angleterre, négocier, de la part de Maximilien d'Autriche, un
traité d'alliance en même temps qu'un projet de mariage entre la troisième
fille du roi et Philippe d'Autriche, Comte de Charolais, fils de Maximilien,
elle revint par Calais et de là en bateau par Watten et Saint-Omer. Or, c'est
vraisemblablement la voie Oye, Lécluse, Gravelines qu'elle dut suivre comme
étant alors la plus fréquentée entre Calais et Saint-Omer. De même,
en 1520, Marguerite d'Autriche, qui était allée avec Charles-Quint à Calais
pour assister à l'entrevue avec Henri VIII d'Angleterre prit la même voie. À
Calais le 13 juillet, elle arriva à Gravelines le 14, et, après y être restée
jusqu'au 16, arriva à Saint-Omer. ( Son neveu Charles-Quint y arrivait le même
jour. Elle en repartit le lendemain 18 pour aller souper et coucher au Mont
Cassel. ) En tout
cas, nous voyons que, pour ne pas perdre les perceptions de droits sur les
bateaux qui évitaient le port de Gravelines pour entrer dans un port voisin,
les Échevins exigeaient à l'Écluse la « cueillote » du sel, au débouché du
canal venant de Calais; et, de leur côté, ceux de Gravelines y percevaient le
tonlieu de ceux qui n'en étaient pas exemptés. Ce
débouché formait donc en quelque sorte le complément du havre. Il fut, en 1605,
l'occasion d'un procès intenté par ceux de Saint-Omer contre le Gouverneur de
Gravelines à l'effet de lui faire interdire de lever tonlieu au lieu de
l'Écluse sur les bateaux à destination de Saint-Omer, par assimilation aux
bateaux venant directement de la mer. Or, le
Grand Conseil de Malines fit droit aux prétentions de la ville de Saint-Omer
dont il consacre les privilèges, et lui reconnaît, sur le dit lieu de l'Écluse
et sur le petit canal qui le traverse, le même droit que sur la rivière et le
havre de Gravelines, déclarant, de plus, que « le dict lieu de Lescluse est «
Arthois ... » ( L'Aa canalisée formait, de Saint-Momelin jusqu'aux abords de
Gravelines, la ligne de démarcation de Flandre et Artois, ligne qui se continue
en s'incurvant, à l'ouest de la rivière, jusqu'à la mer. Cette limite a été
conservée entre les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Le lieudit L'Écluse et le Grand-Fort-Philippe - qui
est une agglomération moderne - sont compris dans l'étroite bande du
département du Nord à l'ouest de l'embouchure actuelle de la rivière. Pourtant,
s'il faut prendre à la lettre le texte qui déclare que « led. lieu de Lescluse
est Arthois ... », il faudrait admettre, tout au moins, qu'il était sur la
frontière ). On trouvera plus loin aux pièces justificatives, cet acte in extenso. XVII Autres affluents
navigables de l'Aa. Entre
Watten et Gravelines, la navigation s'alimentait non seulement des bateaux
venant de la mer ou de ceux venant de Calais par la rivière d'Oye et L'Écluse;
mais aussi des apports des autres affluents navigables, soit, sur la rive
droite, la Colme, qui communiquait avec les voies d'eau de la Flandre, et, sur
la rive gauche, la rivière de Ruminghem, débouchant au Ruth, qui, par
l'ancienne Vonna ou Robecq, allait rejoindre la rivière de Guînes; puis le
Mardic, qui traversait le pays de Langle depuis Hennuin où il communiquait par
d'autres rivières avec l'Ardrésis et Calais. Ce canal était barré au lieu dit «
Hauts Arbres » ou les « Grands Arbres », par une écluse très anciennement
construite pour empêcher l'intrusion des eaux de la mer. Ces rivières étaient
déjà navigables à partir de Calais au XIIIe siècle; mais il ne faut pas oublier
qu'au moyen-âge, les travaux de navigabilité, rendus nécessaires par l'absence
de routes carrossables dans le bas Pays, étaient singulièrement facilités par
le faible tonnage des bateaux employés sur les rivières. Nous
savons que les habitants de Saint-Omer employaient couramment, notamment pour
les transports de vins, des bateaux qui pouvaient charger quatre tonneaux. On
sait aussi que les overdrachs
utilisés en Flandre pour hisser à sec les bateaux qui devaient franchir un
barrage nécessitaient l'emploi de bateaux à fonds plats, de six tonneaux au
maximum. Ce , n'est qu'au milieu du XVIIe siècle, que l'on vit apparaître les
bélandres. XVIII Relevé de
dépenses diverses engagées par la ville de Saint-Omer pour l'administration et l'entretien du
havre, de la rivière et des hems ..., balisage et feux du port, bornage des hems ... On peut
relever, dans les Registres annuels des comptes de l'Argentier, les recettes,
soit de la location des « hems », soit de la « cueillote » du sel. Comme elles
étaient, les unes et les autres, affermées, elles donnent lieu à des articles
aussi peu détaillés que possible. D'autre
part, le compte des dépenses comporte un chapitre pour les travaux du havre et
de la rivière de Gravelines. Mais on peut vraiment dire que ces chapitres sont
d'une étendue et d'une importance très inégales au point de vue des détails que
l'on peut en tirer. D'abord,
les premiers comptes de 1440
et années suivantes sont des plus laconiques. ( 1439 -
40.- Messageries à cheval et à pié. ... Audit Huguet ( Gamel ) pour un voiaige
par lui fait du command. de Messrs pour aller quérir Wille Witersonne, maistre
ouvrier et conduiseur de l'ouvraige du nouvel havenne lequel, si que rapporté
fu à mesd. srs, avoit proposé de soy partir brièvement et aler en Zélande à sa
demeure sans cy retourner, laquelle chose eust pu tourner à grant dommaige, car
l'ouvrage estoit imparfait et le amena ledit Huguet par devers mesd. srs comme
ordonné lui estoit ouquel voiage il vaca III jours commencés le VIIe jour de
mes - mai - oud. an XL . . .
. pourX s. . .
. . XXX s. 1440 - 41
( in fine ).- Despen à cause du
nouvel havene de Gravelinge. ... À
l'argentier pour despen fecte à cause du nouvel havene dess. dit depuis le
compte particulier qui, en l'an de ce compte ou mois de juillet, fu rendu par
mandatement de monsgr le duc ... ( Aucune détail de dépenses n'est relaté )
. .
. . Ve LXViii L. XI s., VIII d. 1441 -
42.- Despen pour messageries à cheval et à pié. ... À
Pierre de Bauffremez, bastart messagier de pied, pour, au commandement de
mesdissrs, avoir porté lettres closes à Willame d'Utrecht à Neufport, afin
qu'il venist devers eulx pour conférer avec lui du fait du fouich et nouvel
ouvrage que icelli Willame a emprins de faire parmy les pastures de Relligieux
de Clermares et de Denis de Fiennes lez Gravelinghes pour l'adrechement et
apparfondissement de le rivière où il vaca III jours finez le XXVe jour de
juing derrain passé pour jour . . .
. IIII s. ... 1442 -
43.- Chapitre intitulé : « Autre despen. » - à la fin du registre. À
l'argentier de ceste ville qu'il a paié de ses deniers pour la fection du
havenne de Gravelingues . . .
. VII e XXIII Livres IX sols VIIII den. de XI gros monnoie de Flandres
le livre, dont des parties il a autreffois fait apparoir par les comptes de
l'impost qui, de l'ordonnance de monsr le duc de Bourgogne se cueille sur
grains et autres marchandises widams et entrant par ledit havenne, le derrenier
d'iceulx comptés finans le premier jour de mars mil IIIIe XLiii et rendu le IX
jour dud. mois par devant monsr le gouverneur d'Arras et les receveur et
contrerolleur de Gravelingues à ce commis par mondit sgr le duc; en la fin et
conclusion duquel compte entre autres aucunes parties est portée ladte somme et
lesdis commissaires présens et de l'ordonnace de messrs les maieurs de ceste
ville dud. an ordonnée estre alouée par led. argentier en ses comptes de ceste
dte ville, comme par icelli compte de l'impost
est apparut à
la reddition de ce compte. Pour ce cy lad. somme de VIIe
XXIII L. IX s. Viii d. Pour les
travaux du creusement du nouveau chenal, ils renvoient à des comptes
particuliers qui ne nous ont pas été conservés. Dès 1460, ils sont plus
complets. Il est vrai que les articles qui les composent, affectant la forme
d'énumérations de fournitures de matériaux, décomptes de journées d'ouvriers,
etc, ... n'ont pas la précision suffisante qui nous permettrait de nous
représenter la physionomie générale des travaux. Peut-être y eut-il, à côté,
pour chaque entreprise particulière, des comptes partiels et spéciaux qui ne
nous sont pas parvenus. Bien plus, certains de ces comptes annuels sont, sans
raison apparente, plus concis que d'autres : c'est ainsi que l'on trouve
parfois un seul article de quelques lignes pour tous les travaux de l'année. D'autre
fois, en pleines périodes de travaux, les dépenses occupent plusieurs pages et
de nombreux articles. Il y a
d'abord les rétributions, largement comptées, des déplacements de personnages
députés par l'Échevinage pour visiter l'état de la rivière et du havre, les
travaux entrepris, examiner ceux qu'il y a lieu d'entreprendre et en faire
rapport. Ces envoyés sont, pour la plupart, des Échevins, parfois le Grand
Bailli lui-même avec le Mayeur, des bourgeois notables, des bateliers et « maresquiers
» spécialistes en travaux de rivières, etc ... Puis vient le décompte plus ou
moins détaillé de journées d'ouvriers. Si quelques travaux d'entretien sont
parfois désignés, tels que frais de dragage et de balisage, extraction de
roseaux, faucillage ( Compte de 1693, fº 152 : dépense de " fossiliages
". ), gazonnement des rives avec des gazons que l'on va chercher dans les
" hemps ", ( ... à Martin Riet, bouchier, fermier des pastures que la
ville a lez Gravelingues, lequel avoit requis estre récompensé des intérestz
qu'il disoit avoir en ses moutons et bestes à layne qu'il avoit tenu pour en
graisser esd. pastures es années LXVI, LXVII et LXViii, au moien de ce que, en
icelles années, mesdissrs avoient fait fouir et prendre excessivement wasons
pour la réparacion et ouvrages dudit havene
en diminuant grandement
les herbes et pasturages desd. bestes . . . . XXXiii L. - ( Compte 1467 - 68, fº 147 vº
), fournitures de bois, piquets ou planches, outils, achats et transports de
pierres; et, le plus souvent, on ne trouve pas indication du genre de travaux
auxquels les journées payées ont été consacrées, et c'est ce qui doit nous
confirmer dans cette assertion que ces comptes ne suffisent pas pour permettre
de reconstituer exactement l'ouvre accomplie dans le cours de l'année. Ce n'est
pas, toutefois, qu'on ne trouve, dans le cours de ces articles, des
particularités ou précisions dont voici quelques exemples : a).- Renvoi à des comptes annexes donnant le détail des travaux. « ... À
sires Jacques le Mezemacre et Guille Maes, eschevins et commis ausd. ouvraiges,
pour les causes et parties au long déclairées en ung cayer contenant XV
foulletz escriptz de deux costez, leur a esté baillé la somme de 1936 l. 10 s.
9 den. ob., le tout emploié aux ouvrages, réfection et entretenement dud.
havene, dont les noms des ouvriers et jours par eux emplyés et en quelz lieux
sont au long déclairés oud. cayer ... ... À
Jehan Jespersoenne de Remerswalle en Zeelande, pour avoir venu en ceste ville
au mandement des mesd. srs pour faire marchié à luy de continuer l'ouvraige
encommenché dès l'an passé aud. havene, lequel marchié se feit selon le teneur
de certain escript fait en double, par lequel icellui Jehan doit avoir pour ses
despens et vaquacions tant de sad. venue, comme du séiour et retour ... cs. -
Compte 1510 - 1511, fº 177 vº et fº 178 vº. b).- Travaux de dragage. Le compte
de 1508 - 1509 énumère ( fº 164 rº ) un certain nombre de journées d'ouvriers
employés à des travaux de « greppe ». En 1695 (
fº 106 - 107 ), plusieurs articles sont comptés à Jean Look et Thomas Delis
pour travaux de grepage de la rivière d'Aa - alias pour avoir grepé lad.
rivière d'Aa - ( Le mot « greppe » doit désigner l'instrument dont on se
servait pour retirer la vase du fond de la rivière : " .. pour avoir
nettoyé le wez à Saint-Bertin à le greppe
et le terre menée sur les estaboins au Haut-Pont ... " ( Compte de l'Argentier 1501 - 02, fº 144
vº ). On remarque que ce mot est employé dans un tout autre sens dans le
Registre aux Bans municipaux du XIIIe siècle : " On a commandé ke nus ne greppe terre en autre terre ne en fosses
qui est communs d'une part et d'autre, se n'est par le volentei de chaus ki li
yrretages est, sour LX s. ( Archives de Saint-Omer AB, XVIII, 16.- Cf. Giry, Histoire de Saint-Omer, p. 543, art. 525
). Ici le mot est certainement pris dans le sens de jeter ) pour avoir " tiré de lad. rivière ", d'une part,
deux cent soixante et onze, d'autre part, trois cent quarante-six, de troisième
part, dix-huit cent soixante-quinze bateaux de terre. Les sommes payées furent
respectivement 138 livres 5 sols; 177 livres; 714 livres 7 sols. c).- Balisage du havre. On peut
rapprocher des dépenses de balisage
celles relatives aux feux à
entretenir pour éclairage nocturne de l'entrée
du port. Mais comme le document recueilli sur ce point n'est pas extrait
des comptes municipaux, je renvoie à la fin de ce chapitre l'indication qui y
est relative. Voici les
extraits qui se rapportent au balisage proprement dit : ... à
Jehan Appelman, marchand de bois, pour, par luy, avoir vendu et livré sur led.
havene ...l.Viii bastons nommez bacques pour les bollebacq(ues) dud. havene,
assav. les Viii de longheur environ XXViii piedz, et le surplus de longheur
environ XXViii piedz, chacun baston au pris de Vi s. ... Pour
l'achat de XXVIII grandes pierres blanches à manière de bertines ( Pour les
pierres dénommées ainsi, voir Bull. Soc. Ant. Mor. T XIV, livre 273, p 451.) de
deux pieds de long, pied et demi de large, et ung pied d'espez ( épaisseur )
livrées à la rivière au haupont pour mettre au bollebacque et bacques à les
tenir droitz en la mer : au pris led. achat de . . . . l. XXii s. ... à la
femme Micquelot Parmentier pour ( avoir ) voiturié de batteau lesd. pierres de
bollebacq qu'elle admena de cested. ville de Saint-Omer, et les deschergea au
passage dud. Gravelinghes. ( Compte 1530 -31, fº 222 et 224 ). ... à
Georges Janzonne pour quatre grandes pierres, les deux mises à la seconde
bolbacque de dehors, et les deux autres à la dernière bolbacque aussi dehors,
pour ce . . . . VI s. ( Compte 1520 -
21, fº 268 vº ). ... à
Jehan Loys, mandelier, de avoir vendu et livré trois douzaines de paingniers
d'oziers nommez bollebacques ( le mot bolbacque
est formé des mots flamands, Bol, Boule,
rond; Back, balise, bouée )
tous enterquiez ( le verbe enterquer
signifie enduire - Godefroy. ), et à l'employ de en servir et mectre sur
perches à enseignier les mariniers la parfondeur de yssir et entrer à sceureté
oud. havene. Et ce au ris accoustumé, l'achat de chacun desd. paingniers,
comprins livraison du tercq et fachon d'iceilx . . . . VIII s. qui aud. pris ensamble sont la
somme de . . . . XIIII . VII s. (
Coompte 1547 - 48, fº 172 r º ). ... à
Charles Loys, mandelier et futaillier, par luy avoir vendu et livré ... le
nombre de trente-huict mandes entercquées nommées bollebacques, servants à
mectre sur haultes perches du long ledit havene pour enseignement aux mariniers
des lieux périlleux, ici du prix de huict solz la pièche, qu'y aud. prys faict
. .
. ., XV l. iiii s. ( Compte
1565 - 66, fº 217 vº ). ... À
Jacques Tant, cordier ... avoir livré une trousse de grosse corde pour loier (
lier ) et faire tenir les ballières droictes du loing led. havene de Gravelines
pour servir d'enseignement aux bateliers des lieux périlleux . .
. . XVii l. Xi s. Vi d. ... À
Charles Loys, mandelier, pour avoir faict et levé pour l'employ dud. havene le
nombre de vingt-quatre mandes d'ozières nommées bolbacken enterqué pour mectre
du loing du dit havene sur haultes perches pour servir d'enseignement aux
mariniers de l'entrée d'iceluy .
. . . IX livres 18 sols. ( Compte 1574 - 75, fº 149 r º ). ...À
François Darthe, mre plombier, a esté ( payé ) la somme de 60 sols pour six bolbacques
qu'il a enterquiés, servant d'enseignement aulx mariniers arrivans au hable de
Gravelingues. ( Compte 1634 - 35, fº 157 rº ). d).-
Bornage des hemps. 1515.-
Nouveau bornage « ... pour cause d'aucunes acrustures que le receveur de lade
Dame ( Comtesse de Saint-Pol et dame de Gravelinghe ) disoit estre augmentées
es pastures dud. Gravelinghes ... ... à
Guill. Maes, eschevin commis aux ouvraiges dud. Gravelinghes pour led. havene,
pour avoir, de l'ordonn. des mesd. srs, accompagnié de Anselot du Chocquel,
clercq desd. ouvrages, allé aud. lieu de Gravelinghes, et illecq fait planter
trois bournes de bois quesne à potences par desoubz, sur les pastures et hemps
prins à rente par contrat à Mme de Vandosme, lesquelz bournes ont esté mis
l'une contre le desoivre de le terre occupée par les Anglois et les autres
venant à la ligne d'icelle séparation de ce que appartient à lad. ville ...
contre les acrustures et terres que l'on pourra gaignier sur la mer, et pour
monstrer que jusque à icelles bournes le tout appartient à icelle ville ... (
Compte 1514 - 15, fº 210 rº et vº ). 1548.-
... À Jeahan Foucart, marchand de grés à Béthune, pour avoir vendu et livré par
batteau depuis led. Béthune jusques au rivaige près la ville d'Aire trois
grandes pierres de grés, chacune
en longueur de
dix pieds; de large ( blanc ) pauch ( pouces ); et,
d'espesseur ( blanc ) pauch; et à chacune y entretaillie ung escuchon à la
double croix estans les armoiries d'icelle ville; et lesd. pierres servans pour
bournes à les mectre et planter en terre sur les hemps au lez west de la
rivière et havene de Gravelinges pour limitacion, et faisant l'entre deux de ce
pays et du plat des Anglois. Au priz
l'achat de chacune pierre de IIII l. X s. À Martin
Thirant, carton de lad. ville d'Aire, pour la voicture de car desd. trois
pierres depuis led. lieu du Ryvaige d'Aire jusques au Hault pont en ceste
ville; en ce comprins leur aide de les avoir chargié et descergié dudit car;
dont il en demande pour tout ensamble .
. . . LX s. ( Compte 1547 - 48, fº 172 vº et fº 173 rº ). e).- Travaux courants ( Entretien,
réparations ). ... pour
avoir rompu les wars ( Il existe un mot flamand war qui signifie embrouillement,
obstruction. Serait-ce mot qui serait
employé ici dans le sens d'objets obstruant la rivière ? ) estans es
rivière entre Mardicqhoucque et ceste ville ... ... pour
ung cent de gluy ( Glui, botte de
paille ou d'herbe liée avec de la paille ) de blé livré sur le nouvaeu delst (
delft ) ( Delst, peut-être pour deelst, du verbe flamand deelen, diviser, partager, séparer.
Mais, dans quelques autres comptes, je trouve écrit delft. Alors, il faudrait chercher le sens dans le verbe flamand delven - ik delf, dolf -, qui
signifie creuser, fouir. Il s'agirait alors d'un creux, fosse ou bassin dans la
rivière. Ce sens serait plus vraisemblable. Cette
constation que, suivant les comptes, on trouve les deux formes, et, en général,
l'incorrection avec laquelle les mots dérivés du flamand, ne peuvent que nous
confirmer dans la pensée que ces scribes de XVIe siècle ne connaissaient plus
cette langue et n'employaient qu'une orthographe phonétique tout
approximative. Quoi qu'il en soit, la forme et le sens de « delft », creux,
bassin, semblent être confirmés par les deux textes ci-après. 1º.- Dans
la Correspondance du Magistrat de l'année 1602, on trouve ( nº 23 ) une lettre
adressée à Nicolas Michiels " mestre des ouvrages du havre et mendelf de Saint-Omer aud. lieu (
Gravelines ). Il s'agit de garnir de « fachines » le « mendlf », car on craint
toujours un débarquement des ennemis. 2º.- Dans
la même Correspondance, année 1569 ( pièce 3372 ), une visite de la rivière
pour la prévision de travaux à faire « pour l'entretenement du havene de
Gravelinghes » signale les faits suivants « ... sur la haie dud. havene
commenchant au borne vers la mer venant vers le mendelf est requis estre faict en divers lieux entre les testes le
nombre de CXXVIII verghes de
nouvelle haie de
XIIII piets chacun
verghe de II à III fachines de
hault ... ». Il
résulte bien du sens de ces différents textes que ces mots nouveau delf, mendelf désignent
une certaine partie du havre en amont de la partie qui débouche dans la mer. Enfin, il
ne faut pas oublier que l'impôt de fouage
ou fouich, perçu par le Magistrat de
Saint-Omer pour approfondir et curer
la rivière était appelé en flamand delfghelt.
) pour cramer les travaux qui ont esté fais et rompus de la tourmente de la mer
et de la glaiche sur l'enwazonnage de la haye et en le dicque d'entre le
Nortporte et le grande Crecque .
. . . XXXii s. ( Compte 1522 - 23, fº 213 vº ). ... pour
avoir reffaict la première teste contre le grande crecke ou nouveau delft ... ... audit
Malin pour le menaige de deux carées de rozel pour crammer ( Cramer, crammer verbe que l'on ne trouve dans aucun dictionnaire, et que je
vois souvent employé dans les comptes de travaux de cette époque dans le sens
de combler, boucher ) le enwazonnage du hauchement de le haye à II s. chacune
carée . . . . IIII s. ( Compte
1520 - 21, fº 265 vº et fº 268 rº ). ... à
Hector le Decre, mestre maresquier ... avoir à la doléance des maresquiers et
aultres manans et habitans tant de cested. ville que dehors, mesmes de ceulx de
Watenes et à l'environ de la rivière allant d'icelle ville à Gravelinghes,
copper et nettoyer atout VI faucilles que l'on nomme wietzeere, les herbes et
hazois croissans es rivières et eaues ... ( Compte 1530 - 31, fº 222 vº ). ... à
Symon Neudz, demourant à Reminghem, neuf cens soixante sept livres dix sols,
pour livrison faict durant l'an de ce compte pour l'entretement du havre de
Gravelinghes du nombre de quarante-sept mil de faschines à XXI livres, X sols
le mil ... ( Copte 1607 - 1608, fº 121 vº ). ...
vaquiée a copper et nettoier atout les six faucilles que l'on nomme witdisere,
les roseaulx et hazoix d'herbes croissans ... ( Comptes 1547 - 48, fº 172 rº ). Cet engin
tranchant, nommé witdesere, devait
être manouvré en bateau, à en juger par la note suivante : « ... à Willemet,
cordier, pour courdail pour tirer les bateaux dud. widezere . .
. . II lib. de fil de commande
à Xii den. le lib. : fait II sols. » ( Compte 1527 - 28, fº 228 vº ). f).- Fournitures de matériaux. « ... À
Baltazar l'Esprit, adjudicatre de la livraison des pierres de Boulogne, pour la
réparation du canal de Gravelinges » ( Compte de 1688, fº 205 vº ). g).- Dépense pour drap de robe à un adjudicataire des travaux. « ... À
Jehan Jespersoenne ( voir ce nom à la fin du premier article de ces extraits de
compte ) la somme de VI l. cour. qui ordonnez lui ont esté par Mesd. srs pour
la convertir au paiement du drap d'une robe partie de la parure livrée des
officiers de cested. ville à luy consentie pour porter le jour saint du
Saint-Sacrement, temps d ec compte et es jours enssievans comme l'en est
acoustumé et en ensievant le traité fait avec luy pour l'ouvrage dud. havene
. .
. . Vi livres. ( Copte 1510 -
11, fº 178 rº ). h).- Dépense pour entretien de lumières indiquant l'entrée du port. Nous
n'avons à ce sujet qu'un document. c'est une lettre de l'Échevinage de
gravelines du 9 octobre 1501 sollicitant la participation de celui de
Saint-Omer à l'entretien de deux falots qu'il vient de faire installer sur la
dune, et qui sont destinés à replacer des lanternes que ceux de Saint-Omer
avaient fait mettre l'année précédente. la contribution de ces derniers devait
consister en la fourniture de torches. Ici la
ville de Gravelines manifestait l'intérêt qu'elle y avait elle-même, au moins
égale à celui de la ville de Saint-Omer, puisque l'indication nocturne de
l'entrée du port devait servir autant aux pêcheurs de harengs qui formaient la
majorité de la population maritime, qu'au transit commercial qui devait
remonter la rivière. On
trouvera aux pièces justificatives la lettre des Échevins de Gravelines. Je
dois toutefois dire que je n'ai pu trouver la réponse qui y fut faite. i).- Police de la rivière. Avait-on
au moins songé, en ces temps où la sécurité des routes n'était que bien
relative, à assurer celle des abords de la rivière et à protéger les mariniers
dont les bateaux n'avançaient qu'à marche lente, contre la cupidité des
maraudeurs tentés par l'appât des marchandises transportées par eau ? Cela est
bien peu probable; et bien que nous ne possédions pas de documents pour donner
une réponse précise et générale à la question, voici, tout au moins, un texte
assez suggestif qui nous montre les pauvres mariniers en butte aux attaques des
détrousseurs qui guettaient, pour les piller, les navires chargés de
marchandises. 1453.- «
... À Ernoul le Prevost, connestable des grans archiers de ceste ville pour
lui, Hanneque du Moulin et son frère; Jehan Drinquebier, Pierre le Portre et
Jacques le Vindre, archiers, pour ung jour que, de l'ordonnance des mesdis srs,
ilz allèrent, habilliés et armez, en la compaignie de Guillme de Rabodenghes,
lieuten. de monsgr le bailly de Saint-Omer, à intention de prendre et
appréhender pluseurs compaignons que on disoit estre logiés à Mourquines et
ailleurs sur le grant Rivière entre ceste ville et Gravelingues afin de rober
et pillier les marchandises et ceulx qui conduisoient icelles par ledicte
rivière, comme desia avoit esté fait; lesquelz robeurs ne furent ne peurent
estre trouvez; mais retourna led. lieutenant et ceulz de sa compaignie sans
aucun exploit faire. Pour ce, par mandement du XXViie jour d'avril mil iiii c
et LIII et quict. cy rendue . . .
. XX s. » ( Compte de l'Argentier 1452 - 53, Desp. Commune, fº 98 rº et
vº ). L'exploit
de police a été effectué à Morquines, c'est-à-dire dans les limites de la
juridiction du Magistrat de Saint-Omer : mais il est certain qu'en dehors de sa
juridiction il n'eût pas eu autorité pour le faire. On ne peut donc conclure de
ce texte que la Ville eut à assurer la police des rives de la rivière : cela
incombait, à n'en pas douter, aux Châtellenies et aux Seigneuries riveraines.
Ici donc la juridiction de la Ville ne pouvait franchir les limites de la
banlieue. Mais ce
qui était limitatif pour les rives de la rivière ne l'était pas pour la rivière
elle-même et l'on peut dire que la rivière de Saint-Omer à Gravelines comme le
havre de Gravelines, étaient sous « le gouvernement » des Échevins de
Saint-Omer. En 1431,
un arrêt du Grand Conseil de Flandre homologue un accord entre l'échevinage de
Saint-Omer d'une part, les religieux du monastère de Watten, d'autre part, au
sujet d'empêchements et de travaux que ces derniers avaient faits, mettant de
ce fait un obstacle au libre cours de la rivière. « La
Ville s'est fait reconnaître le droit d'eschauwage ( escauwage, écouage ) et du
gouvernement de ladite rivière jusques en la mer ... ». ( Mém. Soc. Ant. Mor. T 15, p 165 ). j).-
Prières pour la réussite des ouvrages. Tout
imprévu qu'il nous paraisse, cet article de dépenses n'était pas inopportun,
car la Ville éprouva de véritables déboires dans l'exécution des premiers
travaux. Il arriva en effet que le barrage qui retenait les eaux de l'ancien
lit de la rivière, avant son déversement dans le lit nouvellement creusé, céda
à deux reprises. L'Échevinage
jugea opportun d'implorer, par des aumônes pieuses, l'intercession divine. 1441.-
... pour quatre kennes ( Rappelons que la kenne - cane mesure - était de un lot
et demi : le lot était d'une capacité de 2 litres, un décilitre et demi ) de vin
moictié franchois de iii s. et moictié de ii s. le lot, prinses à Baudin de
Mussem XV s.; et pour le moictié d'un vel acaté en le Boucherie, XV s., donné
par osmone en pitance, et par Artus de Morcamp, du commandement des mesd. sgrs
maieurs et eschevins, le IXe jour de may l'an mil CCCC XLI présentez aux
Cordeliers, leur recommandant à prier que Dieu voulsist maintenir l'ouvrage qui
se faisoit pour le prinse et estaquement du cours anchien de le rivière pour le
faire courir ou nouvel fouich à la répa(ra)tion du havene de Gravelingues,
lequel estanquement estoit tant difficile que par deux fois à grant dommage
avoit failli. Valent
lesd. deux parties . . .
. XXX s. ( Compte 1440-41 «
Despen pour dons d'omosnes ». ). En 1620,
l'Échevinage se trouvait embarrassé dans la gestion et l'entretien du havre et
fit venir un ingénieur d'Ostende, Jean Sprutz « ... À Jehan Sprutz, Ingéniaire
demt à Oostende at esté payé la somme de 45 florins pour le voyaige qu'il a
fait exprez dud. Oostende en ceste ville, y appellé par mesd. srs pour avoir
son advis touchant ce que serait requis pour l'entretement dud. havre à moindre
fraiz de ceste ville que faire se poroit, et s'il ne seroit meilleur baillier
led. entretement au rabat; auquel voyaige led. Sprutz at vaqué tant en allant
qu'en séiournant et retournant sept jours que lesd. srs ont taxé à l'advenant
de six florins par jour par dessus ses despens de bouche, estant compris, en
ladicte somme de quarante cincq florins, 60 solz que mesd. srs ont faict donner
au joune homme ayant accompaingné led. Sprutz ... ... À
Franch. Godart, hoste du Chevallier au Cingne at esté payé la somme de 28
florins Arthois, at quoy a esté trouvé porté la despense de bouche fait au
logis dud. Godard, par led. Jehan Sprutz, Ingéniaire ... ... À
Anthoine Lenoir, demt en la ville d'Oostende at esté payé la somme de
trente-cinq florins à quoy s'est trouvé porter le voyage par luy fait en ceste
ville pour conférer avec luy ( le Magistrat ), pour emprendre, sy faire se
pooit, l'entretement dud. havre de Gravelinghe, pour le plus grand prouffict de
cested. ville, etc ... ... À
Adolphe Marmin, concherge de la Scelle, at esté payé la somme de cincq fl. pour
la despense fecte aud. lieu le dernier jour de mars XVIc vingt par aulcuns
eschevins commis par mesd. srs pour traicter et conférer avecq led. Le Noir
affin d'apprendre une bonne manière pour entretenir led. havre ... »), pour
avoir de lui une consultation sur les moyens à prendre pour arriver à faire les
travaux à meilleur compte, et à en obtenir l'entreprise au rabais. Comme
suite à cette consultation, la Ville dut essayer de s'adresser à un seul chef
de travaux, et, en particulier, le compte de 1630 - 1631 nous montre ( À
Antoine Crawe, marchant, pour l'entretenance par lui empris d'entretenir le
hable, hayes et testes quy sont à la charge de ceste ville séantz lez
Gravelinghues, par accord faict entre Messrs du Magistrat de ceste dicte ville,
ensamble d'entretenir de cordages, balize et bolbacques nécessaires à
enseignier le chemin pour entrer en la rivière sans danger, at esté payé . .
. . IIm XLVII Livres. ( Compte
1630 - 31, fº 145 vº ) qu'un certain Anthoine Crawe en a pris une entreprise
globale; mais néanmoins, il ne nous apparaît pas que ce mode de gestion ait
continué à être adopté comme règle, et, dans les années suivantes, nous voyons
qu'on recourut de nouveau à des entreprises multiples. Parmi les
derniers comptes qui sont, il faut le dire moins détaillés que ceux des siècles
antérieurs, je prends, comme exemple, celui de 1690, qui est un de ceux qui
contiennent le plus de dépenses relatives aux travaux de la rivière et du
havre. Les
articles portent, pour la plus grande
majorité, sur des fournitures de « fascines », « pilots », piquets pour
consolider les rives, journées d'ouvriers, dont on ne nous dit que le nombre,
frais de visites, etc..., etc..., rien, en somme, qui nous fixe sur les détails
techniques des ouvrages. C'est certainement dans cette période et même depuis
la fin du XVIe siècle, que les registres sont moins intéressants à parcourir,
ce qui laisse supposer qu'il y eut d'autres comptes particuliers qui ne nous
sont pas parvenus. Plus
loin, au chapitre dépenses concernant les hems, on relève des frais de
recettes, d'arpentage, frais de garde, voyages d'échevins pour inspecter l'état
des lieux, dépenses afférentes à la reddition des comptes. XIX a).- Recettes de la « cueillote du sel » et de la location des hems. b).- Récapitulation des dépenses affectées par la Ville aux travaux. Voici,
d'autre part, quelques relevés des produits de la ferme de la « cueillote du
sel ». Année
1452 - 53 . . .
. 503 livres, 3 deniers ( Compte de L'Arg. fº 126 et suiv. ) Année
1465 - 66 . . .
. 669 livres fº 138 et suiv. Année
1484 - 05 . . .
. 464 livres, 10 sols fº 149 Année
1506 - 07 . . .
. 522 livres fº 158 Année
1571 1ère 1/2 a. . 700 livres 2ème 1/2 a. . 320
livres f º 112 Année
1589 - 90 . . .
2 452 livres, 8 sols Année
1594 - 95 . . .
2 561 livres Année
1595 - 96 . . .
2 050 livres, 8 sols Année 1598 .
. . 1 484 livres Année
1600 . . . 2 561 livres Année
1652 environ . 800 livres Année
1670 1ère 1/2 a. . 982 livres 2ème 1/2 a. . 960 livres Année
1688 . . . 1 833 livres, 6 sols, 8 deniers Année
1690 . . . 1 410 livres Année
1701 . . . 4 033 livres, 6 sols, 8 deniers Mais, en
1701, le droit était porté à 2 sols 6 deniers la rasière, et la somme est
comptée en monnaie commune alias de
France, tandis que, précédemment elle l'était en monnaie de Flandre. On verra
comment, depuis 1721, de même que pour la location des Hems, cette perception
cessa. Mais on
sait que la précieuse collection que l'on a conservée de nos registres de
l'Argentier n'est pas complète : les lacunes, quoique peu nombreuses, suffisent
à nous empêcher de connaître la suite ininterrompue de ces recettes. Par
contre, nos Archives ont conservé un tableau complet, dressé au XVIIIe siècle,
des recettes des Hems et des dépenses du havre et de la rivière, qui devaient
normalement correspondre aux recettes des hems et de l'entrée du sel. C'est ce
document qui nous révèle de la façon la plus précise l'importance des sommes
qui entrèrent de ce chef dans le budget de la ville, de même de celles qui en
sortirent. a).-
Recettes des Hems. De 1441 à
1470 . . . . 1 823 livres De 1471 à
1500 . . . . 2 463 livres, 15
sols De 1501 à
1530 . . . . 2 939 livres, 5 sols De 1531 à
1560 . . . . 3 310 livres, 12
sols, 6 deniers De 1561 à
1590 . . . . 5 503 livres De 1591 à
1620 . . . 12 698 livres, 17
sols, 6 deniers De 1621 à
1650 . . . 14 152 livres De 1651 à
1680 . . . 23 157 livres, 10
sols De 1681 à
1710 . . . 115 396 livres, 2 sols,
2 deniers De 1711 à
1720 . . . 65 438 livres TOTAL : 246 879 livres, 11 sols, 8 deniers b).- Totaux, par périodes de trente ans, des dépenses affectées par la Ville
aux travaux. De 1441 à
1470 . . . . 20 572 livres, 18
sols, 4 deniers De 1471 à
1500 . . . . 55 747 livres, 15
sols De 1501 à
1530 . . . . 38 108 livres, 3 sols, 2 deniers De 1531 à
1560 . . . . 41 356 livres, 3 sols, 1 deniers De 1561 à
1590 . . . . 54 356 livres, 10
sols De 1591 à
1620 . . . 108 436 livres, 15
sols De 1621 à
1650 . . . . 76 075 livres De 1651 à
1680 . . . . 8 296 livres, 15 sols, 7 deniers De 1681 à
1710 . . . . 71 597 livres, 8 sols, 3 deniers De 1711 à
1721 . . . . 12 261 livres, 9 sols, 9 deniers TOTAL
: 487 164 livres, 16 sols, 9
deniers. Comme la
Ville devait consacrer aux travaux tout le produit soit des hems, soit de
l'impôt du sel, nous trouvons dans la différence entre les deux totaux qui précèdent
le montant approximatif de la recette de la « cueillote » du sel. On ne peut,
en effet, ainsi qu'il a été dit, trouver ce total dans les comptes de
l'Argentier à cause des lacunes qui se trouvent dans la suite des Registres. La
reddition des comptes des revenus des Hems et des dépenses engagées par la
Ville pour les travaux de Gravelines dut se faire, suivant un ordre du duc de
Bourgogne, devant des gens à ce « connaissant ». En fait, elle avait lieu,
chaque année, devant un commissaire délégué à cet effet, en présence du Bailli
et de deux Échevins de Gravelines. XX Coup d'oil sur
les résultats apportés par les travaux de la ville de Saint-Omer à la navigabilité
de la rivière. Malgré
les vicissitudes des guerres et des rivalités dans cette région qui était
frontière, de trois côtés différents, aux Anglais, à la France et à la Flandre,
il ne paraît pas que les ouvrages de la navigation aient subi des dommages
sérieux, soit du fait d'opérations ennemies, soit du fait d'inondations,
pendant les deux siècles qui ont suivi leur remise en état par la ville de
Saint-Omer. Celle-ci semble vraiment les avoir entretenus, durant ce long
espace de temps, de façon à donner satisfaction, et cela ne pouvait se faire
qu'en ne se départissant pas d'une surveillance constante. Les événements
prouvaient qu'une incurie un peu prolongée devenait nuisible, tellement les
causes diverses d'ensablement et d'obstruction du cours de l'eau agissaient
rapidement. Toutefois,
il n'est que juste de rappeler que ces travaux de préservation ne furent
parfois obtenus de la ville de Saint-Omer qu'à la suite d'injonctions plus ou
moins pressantes des voisins menacés. N'a-t-on pas vu en particulier qu'entre
1520 et 1530, la Ville fut sur le point d'être contrainte de construire un nouveau
havre déplacé à l'ouest et mieux orienté ? Pour les raisons qui ont été dites,
il y fut sursis, de sorte que l'on peut constater que, tout imparfait qu'il ait
été, ce débouché sur la mer ne subit pas, pendant près de deux siècles et demi,
de transformation autres que des travaux de consolidation et d'entretien
partiels. On peut
toutefois rappeler ici qu'en 1610 fut effectué le creusement du nouveau canal,
depuis les fossés des fortifications de la ville, en ligne droite jusqu'au delà
des Quatre-Moulins, ce qui améliora singulièrement, pour la navigation, l'accès
et la sortie de la ville. À vrai dire, cette partie de la rivière avait déjà
reçu des améliorations progressives dans son aménagement, mais ce n'était
encore qu'exceptionnellement que les bateaux venant de la mer parvenait à
remonter jusqu'à Saint-Omer. ( V. Mém.
Soc. Ant. Mor. T 16 pp. 336 - 337 ). XXI Le havre de
Gravelines pendant les guerres du XVIIe siècle. Au milieu
du XVIIe siècle, l'urgence dut se faire sentir d'une réfection des travaux de
1441. Mais, ici, la ville de Saint-Omer n'eut pas à intervenir; et nous voyons
que c'est un fait de guerre qui, en écartant cette intervention, prépara la
mainmise de l'État sur la rivière et l'embouchure de l'Aa, mainmise qui devait
devenir définitive au XVIIIe siècle. En effet,
il ne s'agissait plus de question commerciale, mais de défense du pays. On se
préoccupait de fortifier Gravelines du côté de la mer et d'appronfondir le port
afin de procurer un écoulement plus facile des eaux de l'intérieur, et,
surtout, de ménager un port de relâche aux navires espagnols auxquels ne
pouvait suffire l'ancien havre qui commençait à s'ensabler. Mais la
première entreprise dans ce sens fut interrompue par suite des violentes
protestations de la France. Voici ce qu'en dit notre chroniqueur Hendricq : « On
commença, cette année 1618, à creuser le havre de Gravelinne, autrement un
canal qui s'extent jusqu'à la mer au travers des hems : il y avoit plus de 5 à 6 cens travailleurs. La France s'en
plaignit, prétendant que c'était contrevenir aux traités de paix qui portoient
de ne faire aucune nouvelle fortification sur les frontières, ils s'en
plaignirent à M. de Guernonval, le gouverneur de Gravelines, qui leur répondit
qu'il ne faisoit ( qu' ) exécuter les
ordres de la Cour. Les
Francois défendirent à tout sujet de travailler audit canal sous de grièves
peines. On fit mettre plusieurs canons sur les remparts de Gravelines à cause
qu'on craignoit que les franchois ne vinsent incomoder les travailleurs. Le Roy de
France, étant informé de cet ouvrage, en fit faire des plaintes à leurs
Alteses, protestant qu'il ne souffrirait que cet ouvrage s'achevât, de sorte
qu'on se croiroit menacé par là d'une nouvelle guerre. Le tout se termina par
un assemblé ou Conférence. Le 5 ou le 6 vint un ordre de la Cour de stater
l'ouvrage et de congédier les travailleurs. ». Ce ne fut
pas pour longtemps. En 1635, éclataient les hostilités entre l'Espagne et la
France. Ordre fut donné de reprendre les travaux; le plan était de ramener le
lit de la rivière dans un chenal qui s'avancerait en ligne droite de la ville
vers la mer dans une orientation du sud-est au nord-ouest, et d'y construire un
sas ou bassin auquel on accéderait par une écluse défendue sur les deux rives
par des forts dont le fort royal de Saint-Philippe ( dénommé ainsi en l'honneur
du roi Philippe IV dont c'était le patron ), alias fort Philippe. Dès 1637,
les travaux furent poussés avec activité par de nombreuses équipes soutenues
par un Corps d'armée. On
entreprit enfin les fondations d'une grande écluse pour barrer la rivière
elle-même à l'entrée de la mer ( V. sur
ces travaux le Bulletin de l'Union
Faulconnier du 31 mars 1902, pp. 60 et suivantes ) et y tenir, à marée
basse, les navires à flot. Mais ces
ouvrages de défense, en même temps que d'amélioration de l'estuaire, furent
anéantis par les Français qui, dans le courant de l'hiver 1638 - 1639,
envahirent et bouleversèrent les chantiers, engloutirent les fondations tant de
l'écluse que du fort Philippe, comblant le canal du côté de la ville. Rien ne
subsistait de ces travaux considérables pour l'époque. La ville
de Saint-Omer n'y avait pas participé : mais si son havre continuait à
subsister, il était bien abîmé. Il est vrai qu'elle continuait de percevoir les
recettes des Hems et de la cueillote du sel; mais que pouvait-elle
entreprendre pendant la période de guerre qui ne vit pas moins de trois sièges
de la ville de Gravelines ? Et voilà qu'après 1659, quand le traité des
Pyrénées eut consacré l'annexion définitive de Gravelines à la France, cette
ville se trouvait sous domination étrangère, sinon ennemie de la domination
Espagnole qui conservait Saint-Omer et l'Artois réservé jusqu'en 1677, soit
encore dix-huit ans. On ne
pouvait vraiment compter que, dans ces conditions, le port français de
Gravelines, susceptible de recevoir une utilisation militaire, ait été l'objet
d'améliorations de la part d'une administration espagnole. L'entretien
seul de la rivière et la lutte contre les dangers d'inondations pouvaient
d'ailleurs suffire à absorber les revenus dont le produit était, en ces temps
troublés, singulièrement amoindri. De cet
abandon, il résulta que le havre, ensablé et dont l'accès avait été presque
bouché aux gros navires par des épaves de grands bateaux coulés à dessein,
n'était plus fréquentté que par de petites barques de pêche. Mais la rivière
continuait de servir de centre au trafic intérieur; et, en temps de guerre, ce
trafic portait pour une bonne part sur les approvisionnements en vivre et
munitions des places menacées : de plus l'entretien des cours d'eau était
nécessaire pour l'assainissement du pays, puisque l'on prévoyait que le
débordement aurait inondé les terres limitrophes sur une espace de plus de cinq
lieues. XXII Dernières
tentatives et dépenses de la Ville de Saint-Omer pour remettre en état le havre de
Gravelines. Décadence
définitive de ce port. En 1678,
après la paix de Nimègue, on songea naturellement à la réfection des travaux et
écluses qui avaient été endommagées : les habitants du Bas-Artois furent tenus
de payer la moitié de la dépense et taxés à 45 200 livres. ( Cf. Mémoire « à
l'appui du recours de la Commission administrative de la 1ère Section des
Wattringues du Pas-de-Calais, contre les arrêtés de 1858 et 1859 concernant le
Mardick ». par A. Courtois, avocat. Saint-Omer. Fleury-Lemaire 1861. - Cf.
aussi Bulletin de l'Union Faulconnier
du 13 septembre 1903 p. 369 ). Sur ces
entrefaites, la ville de Saint-Omer eut à soutenir un procès « entre Louis de
Gomer, escuier, sieur d'Hinneville, estant aux droits du sieur Mayet, donataire
du Roy appellant ». Louis de Gomer se trouvait substitué aux anciens droits des
seigneurs de Gravelines - ( Après l'exécution, en 1475, du Connétable Louis de
Luxembourg ses biens furent confisqués au profit du Roi de France, mais, au
bout de quelques années, ils furent restitués à ses héritiers. Mais à
Gravelines, la possession ne cessa de leur être contestée. Sous Charles-Quint, Marie de Luxembourg procéda pour faire
valoir ses droits à cette seigneurie. À sa mort, Antoine de Bourbon fut mis en
possession des domaines de son aïeule, et confrmé, après la paix de
Cateau-Cambrésis ( 1559 ) dans les domaines de Dunkerque, Bourbourg et
Gravelines; mais on l'empêcha d'en jouir à cause de l'état de guerre entre la
France et les Pays-Bas qui sévissait alors et se prolongea jusqu'à ce que Louis
XIV se les eut annexés par la force des armes. - Cf. Union Faulconnier, Bulletin T VI fasc. I 31 mars 1903 ) - par
brevet et lettres patentes du 31 mars 1683, et, en cette qualité, avait mis la
Ville de Saint-Omer en demeure de réparer le havre ou canal de Gravelines. Sa
demande avait été admise par le Conseil d'Artois qui, par sentence du 27
octobre 1684, avait condamné la Ville à faire les réparations nécessaires,
faute de quoi le demandeur pourrait exercer le droit de retrait et réversion
des Hems prévu par ses auteurs de
1441. La Ville tenta de parer à cette menace par une réplique que nous trouvons
développée dans un « Factum pour les Maires et Eschevins de
la ville de
Saint-Omer contre Louis de
Gomer, escuyer, sieur d'Hinneville » ( Bulletin
de l'Union Faulconnier du 31 mars 1903 p. 13 ). Nous
savons seulement que, par lettres du 5 octobre 1683 ( Archives de Saint-Omer.
Registre parchemin fº 76 ), le Roi déclare que la ville sera déchargée des
réparations de la digue du canal allant au Fort Philippe. Mais, pour le reste,
nous ne connaissons pas la suite de la procédure, et, par conséquent, ce qui
est résulté du procès. Peut-on supposer que c'est en vertu de cette injonction
que la ville dépensa, pour une même année, vingt mille livres. ( De 1674 à
1679, la Ville n'a rien dépensé, ce qui s'explique par l'état de guerre où
était le pays. De même en 1683, 1684, 1685, années correspondant à celles du
procès. Dans
l'intervalle nous trouvons les sommes suivantes : pour 1680, 1 211 livres; pour
1681, 1 153 livres; pour 1682, 2 506 livres. Enfin pour 1686,
1 133 livres pour 1687, 20 691 livres, 10 sols,
9 deniers pour 1688, 14 103 livres, 6 sols, 6 deniers pour 1689, 14 103 livres pour 1690, 13 064 livres. Puis,
l'on retombe à une moyenne approximative de 1 000 livres. ( Archives de
Saint-Omer, 213, 14 ) pour sa part de réparations ? Toujours
est-il que l'on se remettait sérieusement à l'ouvre pour remédier à
l'ensablement et à l'envasement, mais, le 19 février 1699, une violente tempête
venait rompre les écluses et la digue, ce qui ne fit qu'aggraver l'obstruction
de la rivière. Il ne
faut d'ailleurs pas oublier de signaler aussi que s'était manifestée
l'intervention de Vauban, et que les travaux de fortification de Gravelines en
1680 - 1681 devaient avoir une répercussion sur la défense du pays contre
l'inondation. Les
fossés qui entourèrent les fortifications furent complétés par de vastes
bassins qui recevaient les eaux de tous les terrains avoisinants et formaient
eux-mêmes une protection. Les plans
de Vauban avaient même été beaucoup plus vastes. N'avait-il pas entrevu le
projet de faire de Gravelines un grand port de commerce ? Mais Louis XIV lui
préféra Dunkerque. Il nous reste les lettres et le rapport que l'Ingénieur
adressait au Roi; il rend compte de la visite qu'il a faite de la rivière «
d'Ha », dont il a trouvé l'entretien défectueux, particulièrement en ce qui
concerne « les fascinages qui conduisoient le courant de la rivière jusqu'à la
mer ». ( Cf. Bulletin de l'Union
Faulconnier du 13 mars 1903, p. 13 ). L'avortement
de l'entreprise de réfection et le rejet du projet de Vauban furent pour la
ville de Gravelines une double déception : et, pour consommer sa ruine, voici
que l'on ouvrait, en 1682, le nouveau canal de Calais qui débouchait au Ruth.
S'il apporta une nouvelle activité à la navigation sur l'Aa, en amont de ce
lieu, ce ne pouvait être qu'au détriment du port de Gravelines, d'où le transit
s'était complètement détourné, et pour cause, puisqu'il était devenu
inaccessible aux navires de grande dimension. C'était également au détriment de
l'ancienne voie qui, de Calais, passait par Marck, Oye et l'Écluse. XXIII La ville de
Saint-Omer consent à se déporter de ses droits sur le haver de Gravelines et de la
possession des hems, à condition d'être dégagée de toute obligation d'entretien. Il faut
arriver à 1721 pour voir surgir et aboutir une solution énergique et définitive
qui pût assurer le rélèvement de ce port, solution qui fût menée à bonne fin
sans être contrariée soit par des événements de guerre, soit par des
perturbations d'ordre naturel. Cela ne se
fit toutefois qu'en consacrant la déchéance, au profit du pouvoir royal, tant
des droits que des obligations de la Ville de Saint-Omer. Le
Magistrat de Gravelines exposait, dans un mémoire, que le Magistrat de
Saint-Omer, par sa négligence d'entretenir le havre, avait causé la ruine de
terres qui se sont trouvées submergées par de fréquentes inondations. Le Roi, à
la suite de cette plainte, chargeait d'une enquête les Directeurs des
fortifications de Flandre et Artois qui, après expertise, relatèrent, par
procès-verbal, que le canal se trouvait presque entièrement comblé et que le
seul moyen de remédier à un mal qui augmente tous les jours serait de changer
le cours de la rivière pour l'orienter différemment. Sur quoi, le Magistrat de
Gravelines aurait demandé que le Magistrat de Saint-Omer soit tenu de «
déguerpir des terres et octrois qui lui ont été accordés pour l'entretien dudit
port. » L'Intendant,
M. de Chauvelin, fut chargé de communiquer ces plaintes au Magistrat de
Saint-Omer « lequel auroit répondu qu'on pouvoit avec justice l'obliger à
déguerpir des terres et octrois, pourvu qu'en même temps on le déchargeât de
l'entretien dudit havre ». C'était
vraiment là la solution souhaitable, et ceux de Saint-Omer ne pouvaient être
plus conciliants. Ils auraient pu trouver plusieurs motifs de chicane. Ne
pouvaient-ils pas invoquer dans les troubles des guerres une excuse suffisante
au mauvais état du havre ? Ne pouvaient-ils justifier par leurs comptes que,
depuis 1678, date de la réunion de leur ville à la Couronne de France, ils
avaient dépensé de grosses sommes pour le seul entretien de la rivière d'Aa ? Ne pouvaient-ils enfin prétendre
qu'on ne pouvait les forcer de se
déporter de leurs droits sur les hems et le havre de Gravelines qu'en
appliquant la clause de « réversion » prévue dans la concession de 1441 au cas
où « le havre se rompit on advint en non valloir » ? Or, en ce cas, la Ville avait droit au remboursement des
sommes avancées pour l'acquisition des Hems. L'esprit
de conciliation des Audomarois fut apprécié en haut lieu, car, le 8 juillet
1721, intervenait un arrêt du Conseil d'État
( Archives de Saint-Omer. 213,
15 ) qui consacrait
l'acquiescement en question
et édictait « que
du jour de la signature d'iceluy ( arrest ) il ( le
Magistrat de Saint-Omer ) sera tenu de
déguerpir tant desd. terres ou hemps et de deux octrois sur barques qui
naviguent dans la rivière d'Aa, moyennant quoi le Magistrat de Saint-Omer
demeurera valablement déchargé etc ..., ordonnant, au surplus, ledit arrest, la
vente desdites terres et octrois pour les deniers en provenant être employé(s)
à la construction d'un nouveau canal ». ( ... « la vente et adjudication
desdites terres et octrois sera incessament faite au plus offrant et dernier
enchérisseur pour les deniers en provenant estre employez à la construction
d'un nouveau canal de treize cens toises de longueur sur quatre toises de
largeur d'une rive à l'autre et de dix pieds de profondeur commençant près de
l'Écluse et finissant à la Basse Mer proche du fort Philippe, à condition
néantmoins que toute la dépense du canal n'excédra point le montant de la vente
desdites terres et octrois. Veut sa
Majesté que le surplus, si aucun y a, soit employé à faciner le nouveau
canal, enjoint au sieur intendant et commisssaire de party dans la province de
Flandre de tenir la main à l'exécution du présent arrest quy
sera exécuté nonobstant oppositions ou autres empeschemens quelconques ... ». ( Arrêt du Parlement du 8 juillet 1721. Archives de
Saint-Omer. 213, 15 ). D'une
note jointe à la relation de ces pourparlers, ( Archives de Saint-Omer. 213,
15. - V. aussi Bulletin de l'Union
Faulconnier du 31 mars 1903 p. 21 ) il résulterait que plusieurs lettres
missives montrent le Magistrat de Saint-Omer faisant après coup plusieurs
tentatives pour rentrer en propriété des hems,
alléguant que le susdit arrêt aurait été rendu par surprise. Mais cette
opposition tardive ne fut pas admise : le résultat de l'acquiescement définitif
demeure bien acquis et les travaux nécessaires, entrepris aux frais de l'État,
furent exécutés sans retard : le chenal actuel, formant le débouché de la
rivière, fut creusé, on construisit une écluse de chasse, etc, etc ... Désormais,
l'intervention de la ville de Saint-Omer dans l'aménagement et les travaux du
port de Gravelines a cessé : il n'entre pas dans le cadre de cette étude de
poursuivre l'historique de ce port au-delà de cette date, cela a été fait
ailleurs; mais, pour toute la période antérieure, l'ensemble du rôle qu' a
rempli notre Ville méritait d'être étudié, dégagé même de l'histoire de la
ville de Gravelines avec qui elle devait avoir, de ce fait, des relations et
même des frottements constants. Il y a là, pour l'histoire économique de la
Ville de Saint-Omer, un chapitre qui ne doit pas être négligé.
|

Copyright (c) 1996-2000 Namo Interactive Inc. Tous droits réservés.
specqueux@free.fr