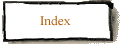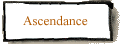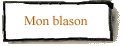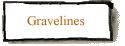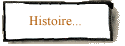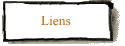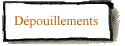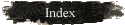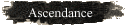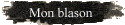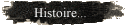| Titre |
|---|
|
Votre texte ici. LE MATELOT ISLANDAIS de GRAVELINES par
Le Docteur DELBECQ
Mémoires de la Société
Dunkerquoise 39e Volume 1904 Parmi les
matelots qui se livrent la grande
pêche, c'est-à-dire qui quittent leur pays pour un laps de temps de plusieurs
mois, il en est une catégorie qui tranche nettement sur l'ensemble : c'est
celle des matelots islandais de Gravelines. Je
laisserai au charmeur Pierre Loti tout le côté sentimental, je laisserai la
Paimpolaise à Paimpol, et me conterai de disséquer le matelot islandais de
Gravelines : 1.- dans
sa personne; 2.- dans
son travail; 3.- dans
sa vie à bord au point de vue hygiénique. I.- Le matelot
islandais. La
vocation du matelot islandais est le fruit d'une véritable hérédité. Dès que la
première communion est faite, parfois après l'obtention du Certificat d'Études
Primaires au plus tard, le jeune mousse cherche un embarquement. Souvent à
douze ans, il part pour sa première campagne dans les mers boréales. On lui
fait un sac, et soit avec son père, soit avec un frère ou un oncle, si la
grande marâtre qu'il adore déjà, lui a ravi ses soutiens naturels, il embarque
pour un salaire proportionné aux services qu'il rendra à bord. Il trouvera là
les types divers pour lesquels, humble chrysalide, il passera pour arriver à
éclore brillant papillon, c'est-à-dire pêcheur recherché, officier du bord, qui
sait peut-être, maître de pêche, ou maître au cabotage. Tandis
qu'il ne sera, dans son premier voyage, que le servant des officiers avec lesquels
il loge à l'arrière, il ne laissera pas de rendre quelques services à ces
novices, à ces pêcheurs de l'avant moins bien logés que lui sans doute, mais
dont il envie le sort : les vieux eux-mêmes ne demandent-ils pas toujours à
vieillir ? Le mousse
allume et entretient le feu à l'arrière, surveille la cuisine, grimpe sur le
pont pour descendre bientôt allumer la pipe de quelque matelot qui ne peut y
parvenir sous la grande brise. Il joue parfois, lorsque le temps le permet, et,
lorsqu'il est bien sage, il doit recevoir sa bonne part du jus de réglisse que
renferme la boîte aux médicaments. Il apprend à aimer le métier, et il ne
manquera pas, lorsque le temps le permet de s'essayer à pêcher des morues,
ambitieux de monter au grade de novice,
dès que son âge et son développement physique le lui permettront. Le mousse
est l'introduction au type de l'islandais qui, du novice au vieux pêcheur, se
détache bien net dans notre pays, sur l'ensemble de la population maritime. Du jour
où il embarque pour Islande, le matelot renonce à connaître la belle saison
dans son pays. Il partira au 1er mars, alors que l'hiver sévit encore, pour
aller chercher l'hiver plus rigoureux, plus dur que dans son pays. Et quand il
rentrera en septembre, le soleil aura déjà baissé sur l'horizon et n'éclairera
plus que de rayons pâlis les fêtes retardées auxquelles il pourra prendre part.
Dans cet avenir de privation de joies de famille, de joies de la patrie, de vie
civile, une seule éclaircie se présente : le service militaire. Lorsque les 20
ans sonneront, au retour de la campagne, parfois à peine débarqué de quelques
jours, il sera levé et s'en ira loin du foyer payer sa dette à la Patrie.
Libéré, il cherchera un embarquement pour repartir encore à Islande. Et ce ne
sera que vieux déjà, car la pension de demie solde n'est gagnée qu'après 25, 30
campagnes là-bas, qu'il restera dans son pays pour y voir briller le soleil
d'été, pour y voir fleurir la campagne qui l'entoure, et pour aider à porter
sac à bord les fils qui auront pris sa place dans la flottille. De cette
vie si spéciale découlent forcément des mours et des goûts spéciaux. Sept mois
par an isolé des siens, l'islandais aime en jouir pendant le peu de temps qu'il
passe à terre. Sept mois par an privé des plaisirs des terriens, il aime à se
les octroyer, autant qu'il peut, pendant le temps de relâche. Si la campagne a
été bonne, il profitera pour faire sa provision de joies de la famille, pour
s'amuser, de la période de travail que comporte le déchargement du navire, et
ne se pressera pas trop à chercher un embarquement pour la pêche côtière qui
doit lui permettre de totaliser les 300 mois de mer nécessaires pour arriver à
la demie solde. Mais si,
et c'est la cas le plus fréquent, l'argent manque au logis, si quelque nouveau
poussin, éclos pendant l'absence du père, ouvre un petit bec affamé, si la
maladie a ravagé la santé de la mère ou d'un enfant resté à terre, il repartira
aussitôt, afin de pouvoir par son travail, par son salaire, si maigre qu'il
puisse être, remplir un peu les joues déjà creuses, remettre un peu de rose sur
des pommettes trop pâlies. Et le cercle recommencera chaque année jusqu'au
jour où le maigre trimestre de la demie solde permettra de se contenter du
maigre gain de la pêche côtière. Un pâle
rayon d'adoucissement, pâle comme ceux du soleil de janvier pendant lequel il
se produit, va luire dans la maison de l'islandais : il s'embarque et un peu
d'argent entre au logis. Il va toucher une prime d'embarquement, une
gratification, des avances, et le plus souvent, le mois qui précède le départ
se passera à dédommager par avance des rudes privations de la campagne future,
celui qui va partir. Certes, un moraliste sévère y trouverait à redire; soyons
indulgents, et disons nous bien que, s'il prend des avances, l'islandais songe
peut-être que ces joies seront les dernières qu'il aura ici-bas et que leur
souvenir, après avoir bercé ses rêves pendant la campagne, sera impuissant à
réchauffer son cadavre que gardera peut-être la banquise glacée. Moralement,
l'islandais est un homme résistant, sachant endurer l'épreuve, et le plus
souvent l'enveloppe physique correspond au moral. Trapu, bien bâti, bien
membré, plutôt arrondi de formes, à cause de l'alimentation, du manque de
marche, il est armé pour le rude labeur que si vous le voulez bien nous allons
examiner ensemble. II.- Le travail de
l'islandais. S'est-on
parfois demandé quelle était la somme de travail fournie par le matelot
d'Islande ? Non peut-être. Eh bien, j'espère arriver à démontrer qu'elle est
considérable. À peine
débarqué, tandis qu'il navigue à la pêche côtière, il a chez lui un supplément
de travail qui occupe ses moindres loisirs. On le voit réparer ses bottes
lui-même, mettre ici un morceau de cuir, là un morceau de bois. Il rapièce ses
cirés, vêtements en toile de coton enduite d'huile de lin bouillie. Il remplace
par des pièces neuves les pièces qui ne peuvent plus servir, découpe dans la laine les gants à deux
pouces dont chaque face protégera alternativement ses mains glacées contre
l'âpre morsure du sel de la mer et le frottement de la ligne, tandis que le
suroît, le chapeau avec son large bord, protégeront son corps et sa tête contre
le baiser glacé de la bise. Avec quel soin il coud lui-même chaque pièce ! Il
sait bien que c'est lui qui souffrira
du moindre défaut dans cette cuirasse qui le doit défendre dans sa lutte contre
les éléments contre l'air et contre l'eau. Les femmes se chargent du dessous :
chemises de grosse laine rouge, caleçons de molleton, bas de laine qui
adouciront le dur contact des bottes toujours humides. Il se déploie dans ce
travail des trésors d'ingéniosité qui m'ont surpris et charmé. Puis
arrive l'époque de l'embarquement. Il gèle, il neige et on va à bord arrimer
les tonnes d'eau, les tonnes de vivre, disposer au mieux les logements. L'heure
du départ a sonné. Depuis quelques jours le sac est prêt. À côté des vêtements
on a amassé quelques provisions personnelles : des oeufs, du chocolat,
quelques-uns des remèdes antiques qu'on préfère encore aux médicaments du
coffre : tous les lambeaux du bien être des terriens qui permettront d'adoucir
quelque peu les moments des plus dures épreuves, et de rompre la monotonie d'un
ordinaire qui, pour n'être pas malsain, à en juger par la santé de ces hommes,
n'en présente pas moins une uniformité vraiment désespérante. En route,
on prépare le bateau pour la pêche. Chacun prend son poste. On arme les lignes
et on se demande combien de morues il faudra aller arracher aux entrailles de
la mer glacée par 30 brasses ( la brasse correspond à 1,60 m. La ligne a donc
50 m de longueur ) de profondeur, à la force des bras pour remplir toutes ces
tonnes, pour user tout ce sel et gagner le salaire déjà payé en partie, mais
qu'il faudrait grossir pour rapporter, avec une ample moisson de poissons, une
modeste part d'aisance. Le
matelot d'Islande prend la morue à la ligne. Cette ligne mesure 30 brasses
environ et se termine par un plomb auquel se rattache une lame métallique,
l'arbalète. C'est à celle-ci que se fixent les hameçons qui, garnis de l'appât
pêché dans la région, serviront à accrocher les morues. Quand le poisson donne,
quand on est dans le banc, on pêche, on pêche toujours. Point de repos, point
de cesse, car demain, tout à l'heure, peut-être, le poisson aura disparu.
Représentez-vous un homme appuyé sur le bord de cette goélette qui dérive avec
sa seule grand-voile, qui danse sur ces lames parfois longues, parfois courtes
et cassantes. Représentez-vous le travail de ce corps dont tous les muscles se
contractent pour maintenir ou rétablir l'équilibre que roulis et tangage ne
cessent de compromettre. Représentez-vous ces bras raidis pour tenir la ligne,
la filer, la hisser à bord avec son poids mort et sa charge de poisson.
Représentez-vous la joie qui dédommage un peu de l'effort quand le coup de
ligne a été bon et le désespoir qui
rend la fatigue plus pénible quand l'effort n'a servi à rien. Et à cela ajoutez
une brise qui glace, des embruns qui détrempent tout, toutes les rigueurs du
climat le plus rigoureux et l'abîme là, sous les pieds, au-dessous de quelques
planches, guettant sa victime que le vent, la mer, la banquise ou quelque
pointe de rocher va livrer à sa voracité. Et le vent chante son glas funèbre.
Et la nuit rarement étoilée, souvent sombre, étend son voile de crêpe sur ce
champ de travail qui semble plutôt être un champ de mort. Ce supplice durera
non pas huit heures, non pas dix heures, mais seize, dix-huit même tant que le
poisson donnera. On glisse sur le pont humide et gelé, on se meut difficilement
au milieu des cordages, des tonnes, du poisson, et on peine, on peine toujours
: ce n'est qu'au prix de ces coups de force que la pêche pourra être bonne. Il faut
travailler partout. Le travail de l'usine peut avoir ses moments pénibles, mais
on plaint plutôt le mineur qui travaille dans le fond de la terre sous le coup
d'un danger continu. Pourquoi donc la pitié publique oublie-t-elle trop et trop
souvent nos marins d'Islande ? Le mineur remonte chaque jour, le matelot
islandais est sept mois sans quitter l'abîme. Le mineur a son travail réglé, le
matelot ne le connaît pas, et ses efforts peuvent être stériles. Car il doit
toujours lancer sa ligne, il doit la retirer toujours. La fatigue est à peu
près la même, qu'il pêche ou ne pêche pas : seul le salaire se ressentira de
l'insuccès. Ne vous
êtes-vous jamais aperçu que plus le cadre est riant, moins le travail est pénible
? Voyez l'homme des champs : son caractère se ressent du milieu dans lequel il
vit. Et dites-moi maintenant si le travail, si surmené soit-il, du moissonneur
qui veut sauver sa récolte sous la menace de l'orage, peut être comparé en
quoi que ce soit au labeur du matelot islandais ? Quand le
poisson ne donne plus, on travaille le produit de la pêche. On se presse toujours,
car il faut fléquer ( c'est-à-dire
éventrer et nettoyer avec un couteau spécial appelé flegmesch ) les morues au plus tôt, il faut saler et plonger ses
mains crevassées par le froid dans le sel qui les ronge. Sans cela le poisson
n'aura pas la qualité et le salaire encore en souffrira. Ensuite on arrimera
les tonnes dans la cale tandis que le navire, toujours secoué par les flots,
rend ce travail très pénible et très dangereux. Et durant sept mois, avec une
relâche de quelques jours dans une baie plus ou moins sauvage, le matelot
islandais recommencera à pêcher et à saler, à trembler sous les efforts des
éléments qui veulent déchirer les quelques planches qui l'abritent contre eux
ou à se désespérer d'un calme qui le ruine. Épuisé
physiquement et moralement, où ira-t-il se reposer ? Où ira-t-il et quels aliments usera-t-il pour refaire son corps
fatigué ? Dans le
capot de l'avant où il n'aura même pas une couchette pour lui seul, où il ne
pourra même pas rester longtemps, chassé par l'air irrespirable que chargent de
buée ses vêtements qui sèchent. Nous allons l'y suivre en examinant maintenant
la vie à bord au point de vue hygiénique III.- La vie à bord
au point de vue hygiénique. Le nombre
de matelots à bord des goélettes islandaises est le plus souvent de dix-huit.
Quatre ou cinq logent à l'arrière; ce sont les officiers, et ils ont chacun
leur couchette. Les autres au nombre de douze ou quatorze logent à l'avant et
sont obligés de partager leur lit avec un camarade auquel le matelot qui
descend de quart succède. Sur un espace de quelques m², dans une pièce à peine
assez élevée pour s'y tenir debout, aérée par un panneau qui s'ouvre sur le
pont, et par un petit volet qui donne sur la cale, ces hommes devront manger,
dormir, sécher leurs vêtements. S'ils n'avaient pas le grand air de la mer sur
le pont, ils ne pourraient y vivre huit jours, et c'est un grand problème à
résoudre que celui d'expliquer comment les victimes de la maladie à Islande ne
sont pas plus nombreuses. Leur alimentation consistera en lard salé embarqué
dans des tonnes et en pommes de terre. Lorsqu'il y aura du poisson pêché, les
têtes de morue bouillies viendront varier l'ordinaire, et l'huile de foie de
morue aidera à l'assaisonnement. La boisson se compose surtout de l'eau
embarquée avant le départ, et qui perd vite sa qualité. Toutefois le thé,
c'est-à-dire, une infusion d'une plante quelconque, tilleul, thé noir, voire
même cannelle a toutes les faveurs de l'équipage, et ayant nécessité
l'ébullition de l'eau, met les hommes à l'abri de bien des misères. La bière
embarquée, déjà peu désirable au départ, ne tente bientôt plus l'équipage, et
le vin n'est distribué que d'une façon exceptionnelle. Il y a encore l'alcool.
Ici, je vais peut-être soulever les récriminations des ligueurs de
l'antialcoolisme, mais je dois à la vérité de dire que si l'islandais boit de
l'alcool, grâce sans doute à la rigueur du climat et au labeur pénible, il le
brûle si bien que depuis seize ans que je vis au milieu de ces matelots, je
n'observe guère de lésions dues aux méfaits de cette boisson. Le café sans
alcool a peu de charme pour ces rudes travailleurs de la mer, car, et c'est
mon avis, le café sans alcool ne leur donne pas le coup de fouet nécessaire à
leur grand surmenage, et si quelques méfaits sont dus à cette boisson qu'on
appelle, le plus souvent à juste titre, le fléau du siècle, cela vient sans
doute d'une mauvaise répartition. Il peut y avoir des ivrognes parmi les
matelots islandais de notre région, mais ils constituent une rare exception, et
ce malheureux boujaron ( c'est la mesure qui sert à la distribution. Il en est
délivré 3 par jour en temps normal. Il correspond à 6 cl, soit un verre à
liqueur ) chargé de tous les péchés d'Israël deviendrait inoffensif, je crois,
si les hommes pouvaient n'avoir à bord que l'alcool qu'on leur distribue, et
étaient forcés de le consommer au moment opportun. En effet, il y en a,
paraît-il, qui accumulent chaque jour une petite portion de leur ration pour,
en un grand jour de fête, se livrer à une grande beuverie. Cela ne devrait pas
être, car c'est une des causes pouvant amener des accidents dus à l'alcool non
plus aliment passager ou stimulant utile, mais poison à haute dose.
Finissons-en avec l'alcool en nous demandant si une surveillance étroite de la
qualité de celui-ci, lorsqu'on l'embarque, ne contribuerait pas, elle aussi, à
en faire un stimulant utile dans les moments de surmenage et de froid excessif,
et peu dangereux du moment où il ne renferme plus d'éléments aussi toxiques
qu'étrangers à sa nature même. Sans
s'inscrire en faux contre le boujaron, le Docteur Lancry a demandé la permission
au cours de la séance de nous faire remarquer que, d'après ses observations
personnelles, les islandais consomment journellement et à grands bols l'huile
de foie de morue et que c'est à cette pratique qu'ils doivent de supporter si
facilement et les rigueurs du froid et celles de certains excès alcooliques. Cela
concorde exactement avec mes observations personnelles et je suis tout à fait
de l'avis de mon confrère qui, dans nos régions humides et froides conseille,
systématiquement, l'huile de foie de morue nature
pendant l'hiver et à tous les enfants lymphatiques. J'ajouterai
que le Docteur Lancry a profité de l'occasion pour rappeler a nouveau ce qu'il
considère comme la condition nécessaire et indispensable pour la conservation
de toutes ces populations de matelots du littoral, à savoir le don en propriété
collective d'un certain lot de territoire sur le type de ce qu'a fait Louis XIV
à Fort Mardyck. J'ai été
heureux de lui faire savoir qu'on s'occupait depuis quelques temps déjà de ce
sujet à propos des laisses de mer du gros banc. ) Tant que
tout l'équipage est en bonne santé, l'aération qui se fait pendant le labeur
sur le pont compense le manque d'air du logement et si le matelot ne dort dans
l'armoire qui lui sert de lit et dans laquelle il pénètre par une ouverture
trop étroite, que par une congestion toxique du cerveau, il se réoxygène bien
vite quand vient son tour de remonter sur le pont. Quelque
désagréables que soient les odeurs du capot avec ses relents de cuisine et
d'huile de foie de morue, de vêtements qui sèchent et d'exhalations de toutes
sortes, l'équipage s'y fait, et la santé des hommes ne semble pas trop en
souffrir, puisqu'on compte à Gravelines nombre de vieux marins ayant 25 à 30
campagnes d'Islande et étonnant ceux qui les voient par la verdeur de leur
vieillesse et l'intégrité de leurs organes. Mais
lorsqu'il y a un malade, à bord, le tableau change. Si ce malheureux arrive à
ne plus pouvoir monter sur le pont, le milieu de la chambre le met vite en
mauvais état de résistance. Est-on près de la côte, on le débarque dans un
hôpital, à moins qu'un heureux hasard n'amène le bateau de l'État envoyé en
station ou celui des Ouvres de Mer croisant dans ces parages? Si les vents sont
contraires, il se passera plusieurs jours avant que le malade puisse être
débarqué, et si le malheureux a une maladie à courte évolution, il sera mort ou
mourant à l'heure où il eût guéri si les secours lui fussent arrivés à temps,
ou si un logement plus sain lui eût permis d'attendre le moment des secours
sans que son organisme s'épuisât dans un milieu épouvantable au point de vue
hygiénique. Et si
l'affection dont souffre le malade est contagieuse, conçoit-on les terribles
conséquences qui en résultent ? On se rappelle les équipages décimés par la
fièvre typhoïde et par le scorbut. Certes
l'instruction des capitaines s'est développée beaucoup à ce point de vue, et
les rapports signalent de nombreux cas où les soins nécessaires ont été donnés
aux malades ou aux blessés d'une façon remarquablement intelligente par celui
qui, à bord est seul maître après Dieu. Voulez-vous
me permettre de vous citer un fait authentique ? Durant
une campagne d'Islande, il y a 17 ou 18 ans, un homme se plaint d'une grosseur
dans le pli de l'aine à droite. Le capitaine lui donne quelques soins, le met
au repos. Mais le mal augmente rapidement. Impossible de songer à gagner un
point de la côte où l'on puisse trouver les secours médicaux nécessaires. La
fièvre s'allume et le délire rend la situation plus inquiétante encore. Le
bouton prend une teinte noire. Il semble de toute évidence que le malade va
succomber. Le capitaine réunit alors une espèce de conseil d'équipage et propose
à ses hommes d'ouvrir ce bouton qui semble la cause de tout le mal. Le malade
consent. On l'étend sur le pont et avec le flegmesch bien nettoyé et bien
aiguisé, le capitaine enlève toute la partie noire. Aussitôt les matières
fécales prennent leur cours par cette ouverture; l'opération de la hernie
étranglée avec anus artificiel était faite et réussie, puisque le malade guérit
et que, bien lavée et tamponnée avec de la charpie enduite d'huile camphrée, la
plaie se cicatrisa sans laisser d'infirmité. L'opérateur et l'opéré sont encore
de ce monde. Des hommes de cette trempe et de cette décision sont
exceptionnels, mais avec un peu d'organisation, par l'instruction médicale des
capitaines, avec la multiplication des postes de secours le long de la côte
d'Islande et la bonne volonté du stationnaire de l'État et du bateau des Ouvres
de Mer, on arrivera à réduire au minimum les risques de mortalité par des affections
aiguës. Je dis
affections aiguës, car il en est d'autres plus terribles dans leurs conséquences
pour lesquelles il semble que jusqu'ici on n'ait rien fait. Il est nécessaire
de drainer jusqu'à nos matelots islandais les principes de l'hygiène moderne,
et si la construction des navires ne permet pas de les mieux loger, il faut en
fermer la porte étroite aux germes de deux terribles ennemis : la tuberculose
et la syphilis. Voila des
hommes qui vivent dans une promiscuité qui va jusqu'à partager la même
couchette dont chacun à son tour essuie les parois, des hommes qui forcément
boiront au même verre, des hommes qui, pendant de longues heures, seront serrés
si près les uns des autres qu'ils vont être presque bouche à bouche et avant de
leur imposer cette communauté en tout dans la vie on ne s'est pas préoccupé de
savoir si le camarade de lit de cet homme jeune, sain, vigoureux, qui a laissé
chez lui toute une bande d'enfants à élever, ne va pas lui cracher une
tuberculose ou lui inoculer, en lui passant son verre, une syphilis qu'il n'eût
jamais dû contracter ainsi ! Certes on
arrive aujourd'hui à guérir un tuberculeux. La très intéressante communication
faite dans cette même séance à la Société Dunkerquoise par le Président, notre
excellent confrère le Docteur Duriau prouve surabondamment que le sanatorium de
fortune peut être installé partout, donner des résultats et ne plus être
l'apanage que des riches. Cependant
ce n'est pas au moment où on engage pied à pied une lutte si justifiée contre
la tuberculose qu'il est permis de passer ces faits sous silence et de compter
sur le grand air du pont pour compenser les dangers de la chambre, quand cet
air parfois excessif peut engendrer un rhume qui, grâce au tuberculeux qui
partage la couchette deviendra plus tard une bronchite fatalement mortelle. Depuis
bien des années je vois revenir de la pêche d'Islande des hommes vigoureux
minés par la tuberculose qui les emporte un ou deux ans plus tard. Après avoir
été contaminés eux-mêmes, ils sont parfois retournés à bord en contaminer
d'autres. En mettant au jour cette plaie, en signalant à ceux qui réglementent
le sort de nos pêcheurs islandais, derniers champions de la repopulation en
France, cette source aussi puissante que terrible du mal qui les ronge,
n'arrivera-t-on pas à disputer, à arracher à la maladie les victimes que la mer
aura épargnées ? Je veux
le croire. Oui, il y
a beaucoup à faire pour ces rudes travailleurs de la mer : surveillance des
vivres, secours médicaux, hygiène à bord, élimination des foyers humains de
contagion en attendant l'assainissement des logements. Serai-je parvenu à éveiller
l'intérêt public pour cette catégorie d'ouvriers dont la vie est si dure et qui
repeuplent néanmoins vaillamment nos côtes ? Mon but sera atteint si j'ai pu
susciter quelques bonnes volontés pour protéger ces marins qui, pionniers de
notre commerce dans les mers de glace, seront demain les vaillants défenseurs
de nos côtes, remplissant avec autant d'abnégation et de dévouement leur devoir
de fils de France, qu'ils mettent de courage et d'énergie à lutter contre la
mort pour élever leur nombreuse
famille.
Appendice. À la
suite de cette communication faite à la Société Dunkerquoise pour l'encouragement
des Lettres, des Sciences et des Arts, on me demande quels sont les remèdes à
la situation. Je crois
pouvoir résumer les principales mesures à prendre dans le quatre suivantes. 1.-
Surveillance de la qualité des vivres et boissons embarqués à bord; 2.-
Développement de l'instruction des capitaines par des conférences médicales
pratiques; 3.-
Multiplication des postes de secours le long de la côte d'Islande afin de
permettre le débarquement hâtif des malades ou blessés sans nuire au travail de
la pêche; 4.-
Visite médicale des hommes avant le départ, comme cela se fait pour les
long-courriers. Ces
mesures qui seraient utiles d'une façon indéniable aux marins islandais,
seraient loin de nuire aux intérêts de l'armement. Chaque année le rapatriement
de nombreux marins est nécessaire et constitue pour l'armement une très grosse
dépense. Ma statistique personnelle me permet d'affirmer que ces mesures
éviteraient les frais de retour des trois cinquièmes des rapatriés et avec une
dépense minime, épargneraient plusieurs milliers de francs pour les seuls
équipages recrutés dans le quartier de Gravelines. L'intérêt
de la santé des marins, l'intérêt de l'armement s'unissent pour les réclamer.
|

Copyright (c) 1996-2000 Namo Interactive Inc. Tous droits réservés.
specqueux@free.fr