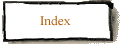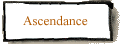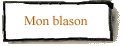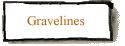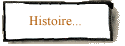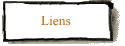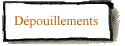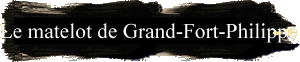
| Titre |
|---|
|
.LE MATELOT de GRAND-FORT-PHILIPPE
par
Le Docteur DELBECQ
Mémoires de la Société
Dunkerquoise 36e Volume 1902 Nous
avons eu l'occasion de faire une excursion à Grand-Fort-Philippe avec
grand-mère Vière. Nous allons, si vous le voulez bien, y retourner pour y
étudier le matelot pêcheur se livrant à la pêche fraîche. Choisissons un bel
après-midi de juin, par un jeudi, et prenons le canot qui nous mènera à Petit
et Grand-Fort-Philippe. Nous
sommes à mi-marée, nous descendons les marches de l'escalier, et nous avons
quelque peine à y arriver, car elles sont encombrées d'enfants de 7 à 12 ans
qui profitent du congé hebdomadaire pour se livrer au plaisir du bain. Oh, nous
ne sommes pas bien difficiles pour la tenue. Les uns, ceux qui font du luxe,
ont un caleçon, les autres, ceux qui en vrai fils d'Adam ne tiennent qu'à la
feuille de vigne qui orne les portraits de notre premier père, ont un mouchoir
lié autour des reins. Et ils sont là bondissant du bord des canots, des
dernières marches de l'escalier dans cette mer qui a nourri les leurs et à
laquelle ils demanderont plus tard le pain souvent amer du foyer qu'ils auront
fondé. En canot,
gare aux abordages ! Les mousses que le calme d'une belle journée a laissé dans
le port, deviennent des amiraux d'embarcation dont la voile faite d'un fragment
de mauvaise toile fixée à un débris d'aviron, est manouvrée par des matelots,
bambins de moins de 10 ans, que leur âge force à fréquenter, oh ! bien malgré
eux, croyez-moi, l'école communale. Voilà 15 ans que je me pose gravement cette
question : « Comment chaque journée de congé n'y a-t-il pas une demi-douzaine
d'enfants noyés dans le chenal ? » Et plus
ça va, plus je me redis que s'il y a un bon Dieu pour les ivrognes, il y
en a au moins deux pour ces imprudents enfants qui prennent vraiment souvent un
bain, mais qui ne se noient pas. Après une
esquisse rapide du matelot du berceau à la tombe, nous le verrons dans sa vie
intérieure et dans son travail, et, comme nous l'avons fait pour les
matelottes, nous essayeront de calculer le maigre salaire de ces hommes de la
mer. Le matelot. Oh !
Dame, il ne l'a pas belle le matelot enfant. Dans les « Matelottes de
Gravelines », nous avons vu que la mère, si elle ne se dérobait pas aux devoirs
de la maternité, ne se faisait pas faute de promener le petit matelot encore en
espérance, des plages de Zuydcoote où elle va chercher le ver, aux flots
alternativement tièdes ou glacés, auxquels elle réclame sa part de crevettes.
Cette rude éducation avec la naissance, loin de nuire à nos jeunes marins
encore au chou, semble au contraire développer chez eux la vigueur et l'attache
à la vie. Et il
faut, croyez-le bien, que ces galoubis y mettent de la ténacité pour vivre. La
mère leur offrira parfois un sein trop dur que l'attente prolongée a distendu,
d'autres fois un garde-manger à peu près vide, ravagé par la fatigue. Et on
sera fier, si à quatre semaines, le moutard, dans un « heu ! heu ! » plus ou
moins harmonieux aura en essayant de tendre les mains vers l'assiette de son
père, affirmé qu'il voulait goûter la pomme de terre qui y nage, à moins qu'il
n'ait une préférence marquée par le même procédé pour un morceau de merlan, ou
pour une « oreille de morue. » Malheureusement
bon nombre succombent à ce régime. Dans les 10 dernières années la moyenne
effrayante de 38 % sur la totalité des décès se dégage des chiffres que j'ai recueillis
à l'état civil. Mais ceux qui survivent sont vigoureux et portent haut le
drapeau de la race. Lorsque
la toute première enfance se sera passée à errer de garderie en garderie, en
trottant pieds nus et le reste à peu près de même, sur le sable des rues ou de
la plage, au milieu des débris de poisson ou des coquilles de coque vidées
pour amorcer les lignes, ils iront à l'école. Qu'y
feront-ils ? Ils ne cherchent pas à devenir grands clercs, mais ils attendront
impatiemment l'âge auquel l'inscription maritime les autorise à embarquer
comme mousse. La grande marâtre, la mangeuse d'hommes, la mer a ses amants. Cet
amour naît avec celui qui en sort, l'étreint enfant dans ses jeux, l'entraîne
comme mousse loin de l'école où il pourrait se chauffer tranquillement vers la
brise âpre et mordante qui lui gèlera les doigts et le visage. Mousse !
Il est mousse ! Il a des bottes, un ciré, un suroît ! Mais il est presqu'un
homme ! Est-ce un attrait spécial pour la mer ? ou la gloriole de porter cet
uniforme, abri de tant de misères, qui anime ces enfants ? Non, c'est
l'hérédité, une hérédité fatale que n'entame aucun malheur, que ne dévoie
aucune misère. Fils de
matelot, tu iras à la mer comme le poisson, à peine sorti du frai, cherche les
fonds où il doit vivre. Ton père est mort dans un naufrage ? Qu'importe ! Un
frère aîné, un oncle te prendra en tutelle et tu seras mousse à son bord. Mais
pauvre enfant, il te faudra dans la nuit noire quitter ton lit pour aller au
canot. Il te faudra godiller péniblement pour conduire l'équipage à bord. Il te
faudra, sur le pont, balayé par le flot et le vent, souffrir du froid et de
l'eau ! Qu'importe ! Fils de matelot, je serai matelot, et pour y arriver, je
serai mousse. Et puis ma mère a besoin de mon gain. Ne faut-il pas mon quart de
part à la fin de la semaine pour nourrir les plus petits ? Et puis, je veux
être matelot ! Et l'enfant part. Il quitte ses jeux, les gâteries du foyer, et
il va prendre la mer. Savez-vous
ce qu'est un mousse à bord ! Non sans doute. Enthousiasmé par Pierre Loti,
j'avais vu autrefois les choses de la mer à travers le mirage du style charmant
et enchanteur. Laissons le poète et descendons dans la brutale réalité. Le
mousse c'est le petit esclave du bord. C'est lui qui, dans la nuit sombre,
traîne péniblement le long aviron qui, manié par ses membres frêles encore,
pousse en godillant le lourd canot de l'escalier de la jetée au bord du bateau.
Cette corvée finie, une autre recommence : mousse, ohé ! Tiens ce bout ! Mousse
va au feu ! Mousse va allumer ma pipe ! Mousse par-ci, mousse par-là, mousse
toujours. Et l'enfant trotte, recevant parfois une caresse, souvent une
taloche. Et pourtant il ne lâchera pas le métier. Il se sent fort, et bientôt
il sera le novice qui à son tour commandera au mousse. Car, à notre honte, il
faut bien l'avouer, la nature humaine est ainsi faite, qu'elle consentira à
obéir aujourd'hui, pourvu qu'elle ait l'espoir de commander demain. Enfin, il
n'est plus mousse. Il a grandi et l'appoint de ses muscles lorsqu'il s'agit de
haler l'ancre ou la traille de hisser la grande voile ou de prendre un ris, est
tel qu'il mérite trois quarts de part. Il a 15 ou 16 ans et la mer le connaît
comme il connaît la mer. Sa capacité est suffisante pour absorber lui aussi les
chopes du commun et le fourneau de sa pipe est aussi noir que celui des pipes
des hommes. Mais il n'est pas homme encore, il n'est que novice. Vienne à
manquer le mousse, c'est lui qui le remplacera et si sa dignité ne lui permet
plus d'aller en bas allumer les pipes des hommes, il restera le domestique du
bord chargé des soins intérieurs. Si l'équipage est au complet, il prend son
quart comme les hommes. Mais cet état n'est que transitoire et vous le voyez si
son développement physique le permet, devenir matelot à 17 ans. En
attendant qu'il parte au service de l'État, lorsque ses 20 ans sonneront, le
grand-fort-philippois navigue. Son gain ne lui appartient pas encore, il le
rend à ses parents qui lui donnent une grosse pièce pour s'amuser le dimanche.
Et cette situation se prolongera jusqu'à ce que, revenu du service militaire,
il fonde à son tour un foyer, à moins qu'il ne l'ait fondé avant de partir. Le
matelot navigue pour gagner sa demi-solde ou invalides, maigre pension que leur
sert l'État en retour de l'abandon d'une somme de 15 F par an. À cette
époque, il a 50 ans et commence à naviguer un peu moins. S'il
n'est pas forcé de gagner sa vie, il restera à terre pendant les quelques mois
les plus froids, et les plus chauds, et c'est la bande des vieux que vous
pouvez voir au « Cap des Blagueurs » discutant sur la couleur des moustaches du
bateau qu'on vient de repeindre, ou sur la force relative du treuil vertical et
du treuil horizontal, à moins que quelque lettré de la compagnie ne tienne tous
les auditeurs sous le charme du récit d'exploits de mer. Peu à
peu, le vieux restera plus souvent près du feu, à la maison. Son auditoire va
changer. Ce ne sont plus les camarades, qui, comme lui, ont bravé la mer qui
écouteront ses récits; il narrera ses hauts faits d'autrefois à ses petits
enfants, aux galoubis, qui essaieront jeudi prochain de refaire avec un canot,
sous le commandement d'un mousse, la grande manouvre que fit la corvette de
l'aïeul sous le commandement de l'amiral. Et puis,
il se taira. Et puis, ses yeux se fermeront, et il ira dormir son dernier
sommeil, dans ce champ de repos enclos par des débris de bateaux, et dont le
silence ne sera troublé que par les sanglots des siens et par les pleurs de la
brise de mer gémissant sur celui qu'elle a tant bercé jadis. Vie intérieure. Lorsqu'il
s'échappe des brassières, lorsqu'il commence à voler de ses propres ailes, le
jeune matelot de Grand-Fort-Philippe a un genre de vie qui n'est pas celui
d'enfants de son âge. Les dangers de la mer l'ont mûri physiquement : les
conversations du capot de l'avant l'ont malheureusement trop mûri moralement. À
un âge où dorment encore dans le nuage d'un rêve des passions qui n'éclosent
que trop tôt, le novice trouve dans les bals, dans le vagabondage à travers
les rues sans lumière, l'occasion, le moyen de faire ce que font ses aînés. Et
cela semble si naturel, que vous étonneriez les meilleurs esprits du pays, en
leur prouvant que cela ne se passe pas partout comme chez eux. Il faudrait, je
le répète, le leur prouver, car c'est en vain que vous leur affirmez le fait.
Ils ne vous croient pas, pas plus que si vous leur disiez qu'on achète une
paire de bottes neuves sans l'avoir essayée. Le novice
trouve facilement à qui parler d'ailleurs. Quand la
fillette a 14 ans, elle va au bal avec le père et la mère, tous les dimanches.
Elle a bientôt distingué celui qui lui plaît et auquel elle sent qu'elle plaît,
et, sans curé ni maire, en vertu des usages du pays, le garçon est uni à la
fille. Ils danseront ensemble, ils sortiront manger des bonbons chez Suzanne,
ou ailleurs ensemble, et le bal fini, le garçon reconduira la fille chez elle.
Dame ! Je ne jurerai pas qu'ils prennent la ligne droite, et c'est vraiment
malheureux que ce bal se termine si tard, il ne fait plus clair. Impossible de
savoir s'il y a un quart d'heure ou deux heures qu'on est sorti et la lune est
si discrète ! Il y a toujours quelque nuage pour lui voiler la face sur cette
grande plage. Mais il
est des conséquences matérielles auxquelles on ne peut échapper, et voilà
pourquoi, avant qu'il ne parte au service, le matelot aura dû passer par les
bureaux de M. le Maire pour lui annoncer qu'un garçon ou une fille, à moins que
ce ne soient l'un et l'autre, ensemble ou successivement, sont venus augmenter
la population. Quand son
bon ami est parti, la jeune mère restera avec sa suite chez ses parents ou chez
ceux de l'absent. Elle sera aidée par les uns et par les autres et par le père
de ses enfants qui, prélevant sur sa solde, lui enverra, lui déléguera, pour
employer le terme technique, un secours de 10 ou 15 F par mois. Il
reviendra en permission avec son grand col, son béret, son coquet uniforme, le
beau matelot de l'État. Que de joies à l'arrivée, que de pleurs au départ ! Et
puis la permission aura peut-être aussi de ces conséquences à longue portée
que, quand revenu pour la bonne fois, le matelot convolera en justes noces, en
donnant son nom à la femme qu'il aime, il donnera la vie civile à deux ou trois
jeunes citoyens, qui, ma foi, s'étaient bien élevés jusque-là sans ça. Cette
première partie de la vie de l'homme à Grand-Fort-Philippe est réellement typique.
La fidélité du garçon à la fille et de la fille au garçon est une loi si
respectée et à laquelle tous tiennent avec une telle ténacité qu'on serait
tenté, si on n'en arrivait à admettre l'union libre, de leur pardonner leur
situation immorale, en somme, et illégale, à cause même de cette fidélité qui
fait que la faute actuelle n'est pour ainsi dire commise que parce que tous
savent, et les intéressés les premiers, qu'elle sera vite réparée. Il me souvient qu'un jeune homme qui, fils de marin,
s'étant lancé dans une autre carrière, abandonna l'amie de ses premières années
pour se jeter dans les bras de la fille
d'un capitaine plus riche et mieux apparentée. Savez-vous
ce qu'il advint ? Eh bien ! il fallut que le mariage fut célébré le soir, avec
déploiement de police et de gendarmerie. Et encore je ne puis assurer que M. le
Maire entendit le « je le veux » quelque peu rageur du mari, et fort ennuyé de
l'épouse, tant était grand le hululement des gosiers et des casseroles de toute
la population ameutée. Les vitres de la mairie, celles des maisons des parents
des mariés volèrent en éclats. Ces intrus, bien qu'enfants du pays, le
quittèrent bientôt et ce n'est que plusieurs années après qu'ils osèrent y revenir. Lorsque
son foyer est fondé, le matelot travaille pour y assurer quelque aisance. S'il
est actif, entreprenant, il sera choisi par l'armateur pour commander un
bateau, ce commandement ne réclamant aucun diplôme. Plus tard il achètera,
s'il le peut, une petite maison. Nous l'avons vue cette maison qui ressemble
par son dispositif et ses dimensions au bateau sur lequel le matelot navigue.
Eh bien ! si la famille grandit, qu'un enfant se marie, on bâtira dans
l'échantillon de cour un réduit qu'on dénommera cuisine, et, serrant le
cantonnement, on mettra deux ménages sur l'emplacement qu'occupait un seul
autrefois. Nous
avons vu comment les enfants étaient pour la famille une source de revenus dès
l'âge de 12 ans pour les garçons. Voilà ce qui explique pourquoi tant que la
navigation a prospéré à Grand-Fort-Philippe, les familles s'y développèrent.
Aujourd'hui le nombre de bateaux diminue. Des revers ont abattu quelques
grandes maisons d'armement. Des naufrages ont détruit de nombreux bateaux, l'activité des chantiers
de construction qui autrefois faisait merveille n'est plus aujourd'hui qu'un
souvenir. De 125, le nombre de bateaux naviguant à la pêche fraîche est tombé au-dessous
de 100. Les grand-fort-philippois émigrant à Islande et ne pouvant plus
naviguer en dehors de cette campagne, cherchent à s'embaucher comme ouvriers :
c'est un malheur, car cela détruit l'originalité, j'allais dire la virginité
d'une race d'hommes forts et bons marins, en attendant que cela ne les détourne
du recrutement de notre flotte. Savez-vous que le quartier de Gravelines compte
à lui seul autant, si pas plus d'inscrits maritimes que Dunkerque et Calais
réunis ? Ce qui
décourage aussi le matelot, ce sont les conditions pénibles exigées pour avoir
une demi-solde trop peu élevée pour assurer l'existence. 300 mois de mer, c'est
long, et 50 ans, quand on vit un rude métier de matelot, c'est tard. Tout cela
pour n'avoir pas 1 F par jour. Qu'en
pensent les mineurs qui bien moins exposés que le matelot ont un gain plus
élevé que le sien. Et c'est
cette demi-solde, réversible par moitié sur la veuve, qui permettra plus tard
au vieux matelot d'aller mourir sa vieillesse au foyer d'un de ses enfants,
sans lui être trop à charge, mais sans pouvoir espérer aucune douceur, à moins
qu'il ne puisse, comme bonne d'enfants ou en travaillant à haquer, donner à ses
hôtes un appoint sérieux de travail. Le
matelot de Grand-Fort-Philippe n'aime pas quitter sa maison, aussi ne va-t-il à
Islande que poussé par le besoin. Il aime la pêche côtière et ces retours
fréquents au foyer, cette nourriture saine de poisson frais à la mer, peuvent compter, eux aussi, comme
causes du développement de la famille. Un point
curieux de son caractère est la superstition. Il y a chez lui plutôt de la
religiosité que de la religion, et, si on ne manque pas de faire la prière à
bord lorsqu'on franchit l'extrémité des jetées, on se passera facilement de la
messe du dimanche, même si l'on est à terre ce jour-là. Toutefois, les
cérémonies du culte catholique leur tiennent fort à cour. À l'entrée de la vie,
comme au seuil de l'éternité, on trouve le prêtre, et on le trouve partout, du
berceau à la tombe. Le
matelot ira bien chercher quelque sorcier pour demander l'amulette qui lui fera
réussir sa saison, mais il ne négligera jamais de faire chanter une messe pour
les absents vivants ou morts. Ne
trouvez-vous pas qu'il est temps de quitter la maison pour se rendre à bord.
Allons donc voir quelles sont les diverses modalités du travail et quel est le
salaire qui reviendra au matelot. Le travail du
matelot. On peut
le diviser en deux parties : le travail à terre et le travail à la mer. Le
travail à terre comprend l'entretien du bateau. Ce sont les hommes de
l'équipage qui frottent le bateau, mis à sec, et préparent le travail au
charpentier ou au calfat, au voilier ou au forgeron. On peut les voir parfois
dans l'eau jusqu'aux genoux, gratter les flancs du bateau et les laver ensuite
à grands coups de balai. Plus tard, ils viendront le coaltarer soigneusement,
tandis que l'artiste du bord peindra gravement le numéro et refera
l'inscription du tableau. Puis le
travail à terre comprend l'embarquement et le débarquement des engins de pêche,
le débarquement du poisson, son étalage sur le quai et ensuite son transport
dans la cour du mareyeur qui l'achète. Ces manipulations du poisson se font
dans de petites mannes, et c'est un curieux défilé que celui de ces hommes
portant une manne de poisson sous chaque bras, ou poussant une brouette, sur
laquelle est posé un grand panier de merlans ou de maquereaux. Les uns ont
encore leurs grosses bottes de mer, leur alourdissant la démarche. Les autres,
chaussés de galoches ou légers sabots, cuir et bois, étalent leurs mollets dans
des bas de couleurs vives. Celui-ci a son suroît encore, celui-là n'a qu'une
blouse de grosse toile cachou, ou un maillot de laine épaisse. À la mer,
le travail varie suivant le genre de pêche auquel se livre le bateau. Nous allons,
si vous le voulez bien, passer rapidement en revue les principaux genres de
pêche, après avoir fait rapidement connaissance avec le type le plus répandu de
bateau. Le bateau. Le type
est le gros sloop comprenant un équipage qui peut varier de 5 à 10 hommes avec
1 ou 2 mousses. Depuis quelques années, nos constructeurs gravelinois en ont
amélioré singulièrement la forme. Plus légers d'aspect, plus fins, plus
élancés, avec une voilure plus grande et plus élevée, ces bateaux sont bons
marcheurs et tiennent bien la mer. Une flottille de 75 à 80 bateaux part chaque
année pêcher la morue dans les mers du Nord, et cette campagne de 3 mois est
bien supportée par ces navires. Le logement de l'équipage est en avant. Le
patron loge tantôt avec l'équipage, tantôt à l'arrière. L'alimentation se fait
en commun. Elle se compose surtout de pain, de pommes de terre et de poisson. La traille. Ce genre
de pêche s'adresse à toutes espèces de poissons. Le bateau qui s'y livre est armé, comme engin, d'un
bâton aussi grand que le bateau, et terminé à chaque extrémité par un rectangle
en fer placé perpendiculairement à lui, et destiné à tenir ouverte l'extrémité
du filet qui y est attachée. Ce bâton est maintenu à bord par 2 câbles qu'on
manouvre au moyen d'un treuil. Lorsque le bateau veut pêcher, il marche contre le vent puis lorsqu'il a gagné une
distance qui lui paraît suffisante, il vire de bord, réduit la voilure pour se
laisser dériver et jette sa traille à l'eau. Ce lourd filet traîné par lui, le
fait dériver lentement. Au bout d'un laps de temps plus ou moins long, la
traille est hissée à bord puis, s'il y a lieu, rejetée à l'eau après en avoir
retiré les poissons capturés. Il faut,
vous le voyez, le concours du vent, et, celui du courant pour pouvoir trailler. Cette
pêche dure toute l'année pour certains bateaux, quelques mois séparant 2
saisons pour d'autres. Elle exige en général un équipage de 5 à 6 hommes et un
mousse. Pêches de saison. Le
hareng. Le maquereau. Le merlan. La morue. Les
pêches de saison diffèrent entre elles par l'époque à laquelle elles se font,
par la nature des engins employés, par leur durée. Tandis
que le hareng et le maquereau se pêchent avec des filets à mailles plus ou
moins grandes qu'on laisse flotter au moyen de bouées, le merlan lui se pêche
avec des lignes flottantes aussi, et la morue avec une ligne garnie de 1 ou 2
hameçons et manouvrée par un homme. Les
filets qui servent au maquereau et au hareng sont en général la propriété du
matelot. Je dis « en général », car il arrive qu'une veuve ou un infirme
trouve suivant l'expression du pays à « faire naviguer ses filets »,
c'est-à-dire à confier ses filets à un homme du bord qui prélèvera une part du
produit de la pêche pour son labeur, l'autre étant destinée à rétribuer le
capital ici représenté par les filets. Il en
sera de même pour les cordes à merlan. La saison
du maquereau comprend la période du 20 août environ au 1er novembre. Les
harengs viennent immédiatement après avec les brouillards de novembre et ne
durent guère que 3 à 4 semaines. Le merlan, qui commence à donner en même temps
que le hareng continuera à occuper ceux qui le pêchent jusqu'au mois de mars. Les
sloops qui se livrent à la pêche fraîche vont chercher un gain plus fort en
allant pêcher la morue dans la Mer du Nord sur les côtes norvégiennes ou sur
les côtes anglaises. Ils partent au nombre de 75 à 80 à la fin avril, pour
revenir en juillet avant le retour des bateaux d'Islande. Le salaire. Quel que
soit le genre de pêche auquel se livre le matelot, son gain lui est attribué
suivant deux types distincts : par moitié ou à la part. En effet,
les marins de Grand-Fort-Philippe ne naviguent pas au mois, sauf à bord de 3
petits vapeurs qui ne sont attachés à notre port que depuis trop peu de temps
pour que l'on puisse pronostiquer leur avenir. La
navigation à la moitié se fait d'après les règles suivantes : l'armement
prélève la moitié des produits de la pêche, l'autre moitié est partagée par
l'équipage, une part un quart ou une part et demie pour le patron, un quart ou
une demi-part pour le mousse ou le novice, une part par homme. Dans ces
conditions le bateau supporte à lui seul tous les frais d'avaries, perte de
gréement, etc... et entre pour moitié dans le commun. Qu'entend-on
par commun ? C'est la dépense faite par l'ensemble, la communauté, soit le
charbon, les pommes de terre, la lumière, pétrole ou chandelles, les
allumettes. Chaque homme n'apporte à bord que son pain. De plus, le matelot a
droit à un demi-litre d'alcool et à un certain nombre de chopes à boire sur le
commun, c'est-à-dire dont le bateau paiera la moitié. Cette institution de
commun est mauvaise, car, outre qu'elle impose tel ou tel fournisseur qui, s'il
n'est pas l'armateur lui-même, est une de ses créatures. J'entends ne parler
ici comme armement ou autre chose que de ce qui se passe à Grand-Fort-Philippe. Si
l'armateur est cabaretier, c'est chez lui que l'équipage devra consommer la
boisson du commun, et il livrera les fournitures d'épicerie de son bateau à un
collègue, qui en retour lui enverra les chopes et l'eau-de-vie d'un autre
commun. Dès lors la porte est grande ouverte aux abus. Vous entendrez donc que
l'on paie sur le commun, les boîtes d'allumettes plus que leur prix, le
charbon, les pommes de terre, le pétrole un tiers ou une moitié de plus
qu'ailleurs, que la mesure n'est pas toujours complète, etc ... J'ai pour
ma part entendu la fille d'un armateur répondre à un matelot réclamant son
compte de charbon. « Avec quoi nous chaufferons-nous, nous autres, si on te
donne ton compte ! » Tous les armateurs, n'ont pas la naïveté d'avouer ainsi
tout haut que le matelot ne gagnera que quand lui-même sera largement rétribué. Tous les armateurs
heureusement n'agissent pas ainsi, mais nombreux sont ceux qui le font et il
est fort à craindre que la moitié du commun que doit payer le bateau ne soit,
le plus souvent calculée de telle manière que ce soit l'équipage qui paie tout
en fin de compte. Aussi
l'administration de la marine, qui a pour le matelot la plus vive sollicitude,
est-elle arrivée à empêcher ce mode de navigation refusant à l'Assurance
qu'elle a organisée, les bateaux armés sous ce régime et en décidant les
équipages à naviguer à la part. Dans ce
dernier mode de procéder, le bateau prend pour lui deux parts et demie et entre
dans les frais proportionnellement à ses deux parts et demie, tant frais
d'avaries, perte d'agrès, que frais de commun, épicerie, pétrole, pommes de
terre, chopes et eau-de-vie. Ici, le matelot constitue, avec l'armateur, une
sorte de société pour l'exploitation du bateau et il est plus encouragé à
travailler à la mer, et à se garer de toute avarie, puisqu'il a aussi sa part à
payer. Si le
bateau pêche à la traille, le prix du commun est retenu d'abord sur le produit
de la semaine. S'il fait une pêche de saison, le commun ne se règle qu'à la fin
de la saison. Pour la
pêche à la morue, le commun se trouve très grossi, car il faut des provisions
d'avance pour 3 mois, et il comprend le sel, les tonnes, tout ce qui est
nécessaire à la pêche et s'appelle alors armement. Un industriel quelconque
avance le prix de l'armement moyennant intérêt. Cette somme, qui varie de 1 500
F à 2 000 F est garantie par la pêche et par l'assurance du bateau en cas de
perte, de sorte que le prêteur n'a rien à perdre et a encore le bénéfice qu'il
peut retirer en envoyant, moyennant remise convenue, l'équipage prendre ses
fournitures chez un tel ou chez tel autre. Et il
arrive, qu'au retour de la Mer du Nord, ou à la fin d'une saison de maquereaux,
le bénéfice est si maigre qu'il ne suffit pas à payer le commun et que le
matelot, au lieu de toucher une part de bénéfice, est obligé de reconnaître sur
papier une part de dette. Il est malaisé dans ces conditions de pouvoir
apprécier le gain d'un matelot. Il change de métier si je puis parler ainsi plusieurs
fois dans l'année. En prenant un homme qui a moyennement réussi, nous lui
verrons attribuer 250 F pour sa campagne du Nord. Il a été nourri pendant 3
mois, mais l'armement a pris trois semaines avant le départ, et il n'a rien
gagné pendant ce temps-là, et le désarmement prendra lui aussi ce même temps. À
peine désarmé de la pêche à la morue, 15 jours vont se passer à armer pour le
maquereau. Si le poisson donne, le 1er novembre le bateau sera désarmé et
l'homme aura touché une fois encore 250 F. Voilà donc un matelot qui aura reçu
500 F pour 7 mois de travail, et aura été nourri pendant 5 mois. Soyons
généreux, attribuons-lui pour ces 5 mois un gain égal à celui des 7 autres, ce
qui est trop certainement, et le matelot aura gagné 1 000 F pour une année de
travail, 1 000 F pour nourrir et élever toute sa petite famille : ne vous
semble-t-il pas que c'est peu, beaucoup trop peu ? L'homme a été nourri
pendant 9 mois à bord, sauf le pain qui
a été fourni par lui; mais les autres bouches, il leur faut de la nourriture à
elles aussi. Le prix
du poisson, la quantité de poisson pêché restent sensiblement les mêmes, et
cependant on constate par des faits patents que le Grand-Fort-Philippe décroît.
De bonnes maisons d'armement ont disparu, et les bateaux vendus ou perdus ne
sont pas remplacés. Il y avait 125 bateaux il y a 10 ans, il n'en reste plus
100 aujourd'hui. À quoi cela tient-il ? Je crois
l'avoir montré, c'est à un défaut d'organisation dans la répartition du gain.Il
y a des mours qu'il faut réformer, car, laisser disparaître un pays comme
Grand-Fort-Philippe, serait porter un préjudice grave à la Marine Française. Nous
avons vu en commençant, que nous étions en face d'une race forte, de familles
de marins ayant l'amour héréditaire et fatal de la mer, se multipliant comme
toutes les races qui trouvent dans le nombre des enfants une source de
richesse. Eh bien ! cette race reste forte, mais elle commence à s'éloigner de
la mer, et sa force prolifique subit un temps d'arrêt. Il y avait en 1898, 143
naissances; en 1902 il n'y en a jusqu'ici que 89, ce qui fera pour les 12 mois,
97 environ soit une diminution de 46. Pourquoi
les pouvoirs publics compétents n'iraient-ils pas aux matelots pour organiser
sur une nouvelle base cette classe d'humbles travailleurs trop disciplinés pour
demander à la grève ou à la révolte, leur petite part de bien-être dans ce
monde ? La France
a besoin d'eux plus que de qui que ce soit. On crée un soldat, on forme en
quelques mois un ouvrier; on n'improvise pas un marin. Puissé-je,
Messieurs, vous avoir intéressés à une population pauvre et travailleuse.
Puisse mon appel être entendu. Le temps
fait souvent de terribles vides dans cette population de Grand-Fort-Philippe.
Que les marins se sentent donc soutenus par une sympathie effective pour
combler ces vides. Et toujours le chenal bercera sur ses flots des légions de
jeunes mousses s'ébattant joyeusement sous les yeux des vieillards qui
attendent, en regardant cette mer qu'ils regrettent encore, l'heure, retardée
pour eux de l'éternel repos.
|

Copyright (c) 1996-2000 Namo Interactive Inc. Tous droits réservés.
specqueux@free.fr