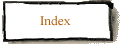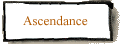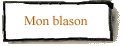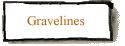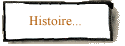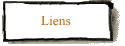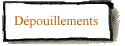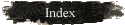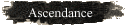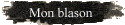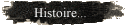|
IDEES,
MOEURS & INSTITUTIONS A SAINT-OMER AU XVeme SIECLE, ETUDIEES DANS LES
DIVERSES EPISODES D'UNE SEDITION BOURGEOISE EN 1467 :
Il y avait deux mois que la ville de
Saint-Omer obéissait au duc Charles, qui venait de former une seconde ligue du
Bien-Public contre Louis XI après s'être assuré l'alliance de son beau-frère,
Edouard IV d'Angleterre. Depuis 20 ans
le Grand-Bailli et Gouverneur pour Monseigneur le duc de Bourgogne était Messire
Alain de Rabodingue, dont le père avait exercé le même office plus longtemps
encore. Les gouverneurs des villes d'Artois commençaient ainsi la féodalité des
offices, qui devait bientôt remplacer dans tout le royaume de france la
féodalité des offices, qui devait bientôt remplacer dans tout le royaume de
france la féodalité des apanages, comme celle-ci s'était lentement substitué à
la féodalité des Comtes. Le Mayeur était Messire Jehan de Dieppe, depuis le 5
/01/1467, qui était le jour marqué par les plus anciennes ordonnances des
souverains de l'Artois pour le renouvellement de la "Loy
Echevinale".
Or, à la date où commence ce récit, des
mécontentements, provoqués tant par le gouvernenement dur et hautain du nouveau
duc que par l'administration abusive des échevins eux-mêmes, irritaient la ville
et communauté de Saint-Omer, partagée alors, comme aujourd'hui, en deux
populations fort différentes, l'une wallone et marchande, sur la rive gauche de
l'Aa, l'autre suburbaine, sur la rive droite, parlant la langue flamande et
vivant du produit des cultures maraîchères.
Par deçà le Haut-Pont qui faisait la
séparation, on en voulait à la fois et au duc et aux échevins : au duc, parce
qu'il avait frappé d'une maille ou obole chaque chaque lot de cervoise, pour
couvrir les frais d'un beau port qu'il eût voulu posséder sur la mer du Nord, à
côté de celui de Calais cédé à ses alliés ; aux échevins parce qu' ils n'avaient
rien fait pour conjurer ou faire cesser cette taxe extraordianire, perçue avec
une rigueur excessive, et pace qu'ils refusaient de modifier, malgré une
défectuosité devenue intolérable, les statuts des trois métiers, " tissage,
foulonnage et tondage " de la draperie audomaroise.
Par delà, autres griefs :
Une crue extraordinaire de l'Aa avait causé
dans les cultures de Lyzel, du Haut-Pont et de la Fraîche-Poissonnerie, de
grands dégâts et l'on voulait que ce désastre provint d'une incurie de Messieurs
de la ville ayant négligé la "widige" de la rivière.
Des pâtures et des champs situés au bac de
l'Aa, et qui jadis étaient affectés au commun usage des habitants du faubourg,
avaient été affermés par l'échevinage, en vertue d'ordonnance du souvearin de
l'Artois, et l'on se plaignait que, dans cette opération, les patriciens de
Saint-Omer, eussent imité en tous points ceux de l'ancienne Rome.
En un mot, à Saint-Omer comme dans la plupart
des villes du Nord, on trouvait que les "mayeurs et échevins gouvernaient, et
disposaient de toutes choses selon leurs souhaits, sans presque suivre des
règles, " en d'autres termes que tout n'était pas pour le mieux sous le régime
de l'autonomie, ou, pour mieux dire, de la dictature communale, et l'on n'avait
point tort ; car, sous ce régime, comme les mayeurs et les échevins pouvaient
presque s'éternisaient dans leur office, puisque de concert avec neuf électeurs
de leur choix ils renouvelaient la " Loy Echevinale, " ces gouverneurs indigènes
faisaient trop souvent peser sur leurs concitoyens une tyrannie domestique
beaucoup pire, à tout prendre, que la sujétion dont il est aujourd'hui de mode
et même de bon goût de se plaindre : à
preuve, entre une foule d'autres témoignages, ces ordonnaces sévères de 1447,
par lesquelles le duc de Bourgogne prescrit " aux mayeurs et aux échevins de ne
faires disner ou conviver aux dépens de la ville, sauf au renouvellement de la
Loy, " de ne recevoir " dons et
gratification de personne " et, " quand ils sont en jugement, d'abréger les
querelles tant que faire se pouldra ".
Ce dont tout le monde conviendra, c'est que
l'échevinage de Saint-Omer de l'an 1467, était bien peu diligent ; car, soit
insouciance, soit persuasion qu'il en avait fini avec tous les mécontents par le
bannissement ou l'emprisonnement récent de quelques mutins, il s'applaudissait
avec une entière sécurité de la tranquillité qu'il avait ramenée dans la ville,
quan déjà la Halle Echevinale était au pouvoir d'une bande de factieux, par qui
mayeur et échevins étaient sommés de se réunir au plus tôt.
Les portes du Haut-Pont et de Lyzel avaient
été soudainement saisies ; le mot du guet, pris ; les clefs des deux portes,
enlevées ; et, la petite troupe s'étant rapidement grossie, non seulement
l'Hôtel de Ville, mais encore le château avaient été assaillis en même temps.
Cette dernière attaque avait échoué ; mais l'Hôtel de Ville était resté aux
séditieux, qui s'étaient bientôt trouvés au nombre de 6.000 et, sans plus
tarder, avaient fait ouvrir les portes de prisons à Jean Bart, à Pierre Sarrazin
et à quelques autres bourgeois, détenus en vertu d'un jugement récent de
l'Echevinage.
Ainsi se faisait la police de nos villes,
lorsque celles-ci possédaient le beau privilége de s'administrer
elles-mêmes.
Le mayeur et les échevins de la communauté
n'ont garde, comme on pense bien, de tenir tête à une si redoutable sédition
qu'ils n'ont même pas prévue ; et le lieutenant de Sa Hauteur et Seigneurie, le
duc de Bourgogne, Messire Allard de Rabodingue, ne comptant point la
capitainerie urbaine parmi ses "prééminences," n'a que faire d'intervenir dans
les querelles intestines de la ville et communauté de Saint-Omer. Qui sait ?
Peut-être le Grand-Bailli devra-t-il à cette "émotion" qui met une fois de plus
en évidence l'insuffisance du mayeur à maintenir une bonne police dans sa ville,
d'être investi d'une nouvelle prérogative qui pourra le consoler d'avoir dû
céder à son lieutenant ses attributations judiciaires. On ne peut affirmer que
Messire de Rabodingue ait fait ce calcul ; mais il a pu le faire. Il ne l'eût
point fait d'ailleurs que, le peut de troupes laissé à disposition à cause de la
reprise des hostilités contre le roi de France, l'eût contraint de s'abstenir
d'une intervention armée dans ces troubles de la commune
audomaroise.
Messieurs de la Ville se rendent donc en
Halle.
Là, les deux chefs de l'émeute, prenant tour
à tour la parole, exposent, l'un les griefs des bourgeois, l'autre, ceux des
habitants des faubourgs. Jehan le Panetier demande que la taxe d'une maille sur
la cervoise soit abolie ; que les experts ou "égards" des "trois-métiers" ne
puissents plus à l'avenir entrer ès
domicile des bourgeois sans être accompagnés d'un officier de la commune ; que
les statuts de la corporation de la draperie soient d'ailleurs revisés, et que
l' Echevinage intercède en faveur des bannis. Jacques Tawmaker requiert
"Messieurs" de dédommager les maraichers des pertes que leur ont fait subir les
inondations de l' Aa ; de pourvoir dorénavant à une "widige" suffisante de la
rivière ; de restituer au commun usage des habitants les terres publiques du Bac
et de laisser aux faubourgs la faculté de nommer eux-mêmes leurs connétables.
L'un et l'autre exigent que l'Echevinage montre les priviléges anciennement
octroyés aux habitants de Saint-Omer par les comtes d'Artois, comme si la Charte
communale eût été violée par "Messieurs de la ville," et, pour première
satisfaction, ils veulent que le conseiller pensionnaire de la ville, Guilbert
d'Ausque, envoyé l'année précédente de Montreuil à Saint-Omer pour remplacer
Jacques de Pardieu, "devenu lépreux et très pauvre après quatorze ou quinze ans
d'exercice" ne puisse plus remplir aucune charge.
Comme on le voit , les "seigneurs mayeurs et
échevins" de nos villes du XVe siècle ne pouvaient se passer d'un conseiller
pour le léal acquittement de leur charge : c'est qu'en effet, comme l'attestent
maints documents de la chronique officielle, ils n'étaient pas tous même quelque
peu clercs, plusieurs d'entre-eux, en imitateurs de certains gentilhommes
d'antan, devant sceller leurs actes administratifs de la barre d'ignorance
graphique.
Mais pour l'heure présente, maître Guilbert
ne peut conseiller Messieurs de la Ville, et l'Echevinage, enfermé dans le
cercle de Popilius, capitule : il fera voir la charte des priviléges octroyès
aux habitants de Saint-Omer par les comtes d'Artois, si les réclamants veulent
lui désigner quelques-uns des plus notables d'entre-eux avec qui il puisse
conférer à ce sujet ;
Il indemnisera les maraîchers et avisera aux
moyens d'empêcher le débordement de la rivière ;
il examinera les titre relatifs aux pâtures et
autres terres communes du Bac, et, s'il y a lieu, il corrigera les
abus.
Il autorisera les habitants des faubourgs à
nommer leurs connétables, ce qui était pourtant un commencement d'autonomie pour
"Messieurs du Haut-Pont, de Lyzel et de la Fraîche Poissonnerie"
Sur deux points seulement il se montre
intraitable : il ne révoquera point maître Guilbert, parce que le conseiller de
la ville tient sa charge du duc de Bourgogne, ce qui, soit dit en passant, est
une première invasion de date récente du souverain de l'Artois pour le
gouvernement de ses villes, et il n'écrira pas à sa Hauteur en faveur des
bannis, comme il ne prendra non plus de résolution ni à l'égard des experts de
la daperie, qui n'ont pas outrepassé leurs droits, ni au sujet de la maille, si
désagréable qu'il puisse être aux bourgeois de Saint-Omer d'être un peu sevrés
de leur nectar, pour donner à sa Hauteur un hâvre de convenable apparence, à
côté du port de son beau-frère d'Outre-Manche.
Mais les factieux n'étant qu'à
demi-satisfaits, les désordres continuent ce jour-là et les jours suivants, au
milieu sans soute de libation de cervoise, qui, en dépit de la maille, troublent
davantage encore les têtes ; et, le samedi venu, qui était jour de marché, dès
le matin, Jehan le Panetier et Jacques Tawmaker somment de nouveau Messieurs de
la Ville de se rendre en Halle pour là, en présence du Grand-Bailli mandé
également, faire publier à la Bretèque les engagements pris et recevoir un écrit
tendant à obtenir de sa Hauteur le redressement de tous les griefs.
C'étaient les Fourches-Caudines.
L'Echevinage cède encore cependant, et, en
présence de la foule rassemblée sur le Grand-Marché, lecture est donnée par le
héraut de la ville des promesses faites en Halle quelques jours auparavant, ce
qui apaise enfin tous les troubles...
Mais cinq mois environ s'écoulent, pendant
lesquels le Grand-Conseil de Malines peur examiner tout à loisir la requête des
habitants de Saint-Omer, et le Prince, attendre que la "Loy Echevinale" soit
renouvelée, et le 10 Janvier 1468, lorsque la "Loy" est faite, une ordonnance du
duc de Bourgogne arrive.
L'Echevinage sera représenté par le Mayeur,
deux Echevins et le Procureur de la Ville ;
Les habitants par six des plus
notables.
Devant sa Hauteur, l'attitude des uns et des
autres députés est naturellement très embarrassée. La "Loy," si bon choix
qu'elle ait pu faire des six notables, n'ose, en leur présence, incriminer
autant que son intérêt l'y porte, la révolte des habitants, et les six notables,
fermiers peut-être des pâtures communes, ne se sentent pas d'humeur à desavouer
les actes de l'echevinage. Aussi, première sentence de la Cour du Prince, qui
commande des excuses pour les attentats contre l'autorité de sa Hauteur et
seigneurie le duc de Bourgogne.
Les excuses sont présentées le 7 Février :
elles sont rejetées.
Le 18 Avril, conformémént aux prescriptions
de Sa Hauteur, des députés de l'Echevinage, des corps de métiers et des
connétables, désignés le 15 Mars précédent, sont en cour pour recevoir, selon
l'expression même de l'ordonance, la condamnation qu'il a plu au duc de
Bourgogne de prononcer contre les coupables ; et quelle est la
peine?...
Nous avons assisté aux méfaits, voyons
l'expiation, dont le duc Charles a fixé l'époque au dimanche de
Quasimodo.
Le dimanche de Quasimodo, de l'année 1468,
après la messe chantée, un foule nombreuse se presse sur le grand-Marché de
Saint-Omer en face de l'Hôtel de Ville. A l'une des fenêtres, Messire Philippe
de Crevecoeur, Sire d'Esquerdes, commissaire du Duc, le Grand-Bailli et
gouverneur de la ville, et le nouveau Mayeur, Messire Nicolas de
Sainte-Aldegonde, paraissent accompagnés des Echevins des Deux-Années, et des 10
jurés de la communauté.
A un signal, trois cents habitants de
Saint-Omer sont amenés.
Ce ne sont pas les coupables, mais deux cents
manants de " pardeçà " et cent de " pardelà, " qu'à désignès une commission
compsée des connétables et de trois hommes de chaque métier, nos pères du XVé
siécle, entendant la jurisprudence à leur manière, et n'en étant pas encore venu
à comprendre qu'en bonne justice, l'expiation des délits, comme leur
responsabilité, ne suarit être que personnelle.
Tous tiennent à la main un cierge pesant
trois livres.
Les deux cents habitants de pardeçà ouvrent
le cortége : ils ont dépouillé leurs ceintures et ils marchent nu
tête.
Viennent ensuite cinquante de ceux de
pardelà, nu tête et nu pieds.
Puis cinquante autres maraîchers, nu tête, nu
pieds et en chemise.
La lugubre procession défile sur le
Grand-Marché même, pour passer devant le commissaire du Duc, le Grand-Bailli et
messieurs de la Ville.
Lorsqu'elle est devant la balustrade où se
trouve le sire d'Esquerdes, un des bourgeois prenant la parole, tandis que tous
fléchissent le genou, dit à haute voix : - " Nous reconnaissons et confessons,
avoir commis offenses et forfaits envers sa Hauteur et seigneurie par nos
assemblées, séditions et commotions, et requérons et prions merci pour lesdites
offennses dont il nous déplaît grandement à cette heure."
Mais si nos pères du XVé siècle ont leur
législation criminelle, ils ont aussi leur code pénal, et, comme, à leurs yeux,
qui offense le Prince, offense Dieu, l'amende honorable du Grand-marché terminée
, une autre commence;
Les deux cents bourgeois s'en vont distribuer
leurs cierges entre les églises des cinq paroisses que les commissaires du Duc
leur ont désignées.
Les cent maraîchers portent les leurs à
Notre-Dame de Boulogne, d'où ils reviennent, suivant l'ordonnance du Prince,
avec un certificat du curé de cette église attestant qu'ils ont accompli leur
pèlerinage expiatoire.
Alors il est fait justice des émeutiers les
plus compromis.
Lepanetier et Tawmaker sont exécutés " par
l'épée. "
Le bourgeois Wuillaume Crimbout et douze
autres sont bannis ; leurs biens confisqués, et eux-mêmes déclarés en sus
passibles de la hart, s'ils sont repris sur les terres du Duc de
Bourgogne.
Plusieurs, qui avaient fui, avaient été
arrêtés à Lille : un jugement rendu dans cette ville le 2 Juillet, les renvoie à
Saint-Omer, en leur infligeant le pèlerinage à Notre-Dame de
Boulogne.
Jean Bart et Pierre Sarrazin avaient gagné
Bruxelles, il y sont appréhendés, puis ramenés dans les prisons de saint-Omer
pour attendre avec Jehan Staês, raux, Denis de Wissocq et plusieurs autres, le
procès extraordinaire qui va leur être intenté.
Quant à la ville et communauté de Saint-Omer,
le Grand-Conseil de Malines n'avaient pas été moins sévère pour elle que pour
les particuliers : il avait été déclaré ses " privilèges, usages et bonne
coutumes " confisqués, et statué qu'à l'avenir elle n'en jouit plus qu'autant
qu'il plairait à sa Hauteur d'adoucir la rigueur de la sentance, outre qu'elle
dvait payer au Prince, à des termes marqués, une amende de vingt mille ridders.
la sentence est rapportée en ce qui concerne les priviléges. Mais la chronique
officeille ne nous montre plus, de 1467 à 1483, les grands-baillis venant en
Halle, à leur entrée en fonction, jurer, comme l'avaient fait jusque là leurs
prédécesseurs, qu'ils " sauveront, " en
même tempsque les " droicts de la sainte-Eglise et de Monseigneur le
comte d'artois, le droict de la Ville, les franchises, libertés, priviléges et
bonnes coutumes de le Ville ; " et dix-sept ans à peine se sont écoulés, depuis
que le Grand-bailli, Messire de Lannoy, est venu en 1483, inaugurer le retour à
l'ancienne bonne coutume, par la prestation en halle du serment de fidélité à la
ville, qu'une lettrede l'Archiduc Philippe le Beau, peu de jours avant le
renouvellement de la " Loy ", mande " à ses très-chers et bien-aimés " les
écheviins de Saint-Omer que " vu l'appauvrissement et la diminution de jour en
jour croissante de leur ville, certains statuts concernant la conduite des
affaires vont leur être expédiés dans un bref délai, et, qu'en raisondu
renouvellement prochain de le Loy, il lui a plu de continuer chacun des
officiers dans l'exercice de son office, jusqu'à ce qu'il soit autrement pourvu.
" deux mois plus tard tous les nuages sont dissipés : un des maîtres des
requêtes de sa hauteur, arrivé à Saint-Omer, avec ordre de " passer outre les
difficultés, " après avoir rassemblé Messieurs de la Ville pour l'élection de la
Loy d'après les nouveaux statuts destinés à arrêter " l'appauvrissement, la ruine et la
désolation de la ville de Saint-Omer, " leur notifie en termes assez peu
agréables :
Que dorénavant les quatre premiers échevins
seront " faits et créés " par le Grand-Bailli, lieutenant de Sa hauteur dans la
ville ;
Que le Mayeur sera pris parmi les quatre
premiers échevins at que le bailli sera consulté pour ce choix ;
Que le Bailli partagera avec le Mayeur la
capitainerie urbaine ;
Que l'Echevinage ne pourra plus faire aucune
dépense de cent livres, pour quelque affaire que ce soit, sans le " sce, advis
et consentement du Bailli. "
Que les appointements et les épices alloués
aux officiers municipaux seront d'ailleurs réduits à un chiffre moins
considérable ;
Qu'enfin il est urgent que l'on " s'emploie
diligemment à ce que l'Echevinage soit pourvu des plus gens de bien que l'on
saura trouver. "
L'Archiduc Philippe justifiait-il lui même
par ces ordonnaces de l'an 1500 les griefs, sinon la révolte des bourgeois de
Saint-Omer contre la dictature communale de l'an 1467 ?
On est fort tenté de le croire.
M.
L. DE LAUWEREYNS DE ROOSENDAELE.
Membre
titulaire de la Société des Antiquaires de la Morinie,
Conservateur des Archives municipales de Saint-Omer,
Professeur d'histoire au lycée de Saint-Omer,
Officier d'Académie.
|